Société
Penser le Coran : le Livre sacré appréhendé comme un dialogue entre Ciel et Terre
Bahgat El Nadi et Adel Rifaat, les «Mahmoud Hussein» ont tenté de relire le Coran à travers le vécu du Prophète et de ses contemporains.
Une approche selon les différents type de versets et les circonstances de leur révélation.
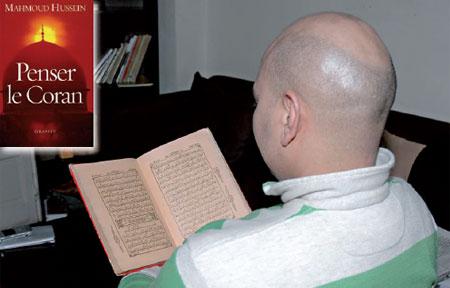
Pendant 10 ans, ils ont lu le Coran comme si le message divin leur avait été adressé personnellement, sans a priori. Ils ont vécu la Révélation comme elle a été entendue par les premiers musulmans. Ils se sont interrogés, ont interrogé les textes… Ils, ce sont les «Mahmoud Hussein», un pseudonyme pour désigner Bahgat El Nadi et Adel Rifaat, deux intellectuels et politologues français d’origine égyptienne. Nous avons rencontré les Mahmoud Hussein (voir entretien exclusif en page suivante) en marge de la XVIe édition du salon de l’édition et du livre et au cours de laquelle ils ont présenté la traduction en arabe de leur ouvrage Penser le Coran.
Les deux chercheurs ont abordé la vie intime du Prophète, l’ont accompagné dans les rues de la Mecque et de Médine avec Abou Bakr, Omar Bnou Al Khattab et Ali Bnou Abi Taleb… pour tenter, à travers ces vécus, d’apporter une autre lecture du Coran, de dépasser la version littérale du texte sacré.
Résultat :«On ne peut pas fréquenter ces gens-là pendant dix ans sans avoir le sentiment de les connaître intimement…», avoue Bahgat El Nadi. La démarche des deux chercheurs s’inscrit dans la tradition réformiste de Taha Hussein, de Mohamed Iqbal et de l’imam Mohamed Abdou. Cependant, ils nuancent : «Nous ne sommes pas des exégètes. Nous avons travaillé sur les textes des exégètes les plus traditionnels». Ils ont puisé leurs connaissances historiques dans les textes d’Ibn Ishâq, d’Al-Tabarî ou encore d’Ibn Sa’d.
Déjà à partir du IXe siècle les tentatives de rationalisation étaient combattues
Mais alors si les sources sont traditionnelles, connues, qu’apportent de plus les Mahmoud Hussein ? «Après avoir lu des centaines et des centaines de versets, cela devenait évident… comme une révélation dans la Révélation ! Nous sommes arrivés à des conclusions auxquelles nos prédécesseurs n’ont pas voulu arriver. Notre démonstration entière tend à dire la chose suivante : Dieu s’adresse aux humains. La parole de Dieu est inscrite dans l’histoire, tissée dans le moment où Dieu a décidé de la livrer». Alors finalement intemporel le Coran ?
«Il y a une série de versets qui sont intemporels, métaphysiques, rituels, qui ne sont pas refermés sur des moments et qui peuvent être pris tels quels, indépendamment du contexte. Mais il y a aussi des centaines de versets proprement circonstanciels voulus comme tels, c’est-à-dire que le verset ne peut être compris s’il n’est pas lié à l’événement qui a donné lieu à sa révélation. Par ailleurs, il y a des versets nés de la circonstance et qui ouvrent sur une perspective plus générale». Il s’agit donc de «contextualiser». Mais d’autres avant les Mahmoud Hussein avaient déjà défini ces fameux asbab al nouzoul, c’est-à-dire des circonstances de la Révélation. Cependant, «même si les chroniqueurs reconnaissaient les circonstances de la révélation des versets, ils ne reconnaissaient pas le rapport de cause à effet. Or, le rapport entre le texte et le contexte est nécessaire», insistent-ils. De ces recherches et réflexions est né un livre, un grand livre : Penser le Coran (Grasset et Fasquelle, 2009).
«Ce qui nous est paru frappant, c’est le rapport vivant qu’il y a entre Dieu et les hommes, ce dialogue entre le Ciel et la Terre». Le texte coranique a traversé les siècles et a été l’objet de tant de réflexions, de méditations et de commentaires de tous genres, scientifiques tout autant que philosophiques ou théologiques.
Mais petit à petit, la théologie musulmane classique a commencé à se refermer, on n’admettait plus de discuter les préceptes divins. Cela avait commencé au IXe siècle à Bagdad où Ibn Hanbal refusait déjà de débattre tout argument rationaliste face aux Mu’tazilites. «La thèse littéraliste a fermé toutes les issues de la rationalité. Ibn Hanbal ne disait pas tel est votre argument et voici le mien…Il disait foutaise est tout cela, Dieu est tout puissant…».
Le dialogue vertical s’est figé et, en essayant de se conformer le plus possible au texte, on a fini par le déformer. La notion de temps a été abolie, présent et passé se sont confondus. «Le texte doit nous ouvrir des perspectives. Ce n’est pas un ensemble d’obligations et d’interdits. On perd la chaire vivante de ce qui a été la Révélation». La thèse traditionnaliste qui réfute toute réflexion sinon l’application des préceptes sans aucune distinction a prévalu jusqu’à nos jours.
«La victoire des thèses traditionnalistes, dans leur formulation la plus étroitement littéraliste, est consommée pour de longs siècles avec les enseignements d’un Ibn Taymiyya au XIVe siècle, que viendront prolonger, au XVIIIe siècle, ceux d’un Ahmad ibn ‘Abd al-Wahab (auquel se réfère le wahabisme aujourd’hui)», soutiennent les deux auteurs dans Penser le Coran.
Leur pensée intègre, réinterprète, ou rompt avec celle de leurs prédécesseurs. Elle a sa propre dynamique et s’inscrit dans le XXIe siècle, avec les besoins et les incompréhensions d’une époque. Leur démarche est scientifique et repose sur de minutieuses recherches et recoupements. S’ils ont repris dans leurs livres Penser le Coran et Al-Sîra des textes connus, ils leur ont donné une nouvelle portée et une dimension pendant longtemps occultée.
La particularité de leur analyse est de «décortiquer le texte en lui donnant sa logique vivante». Ils restituent à la religion son essence première, celle d’une préoccupation intime. «Si chacun de nous est responsable devant Dieu, chacun de nous est capable de réfléchir et de donner un sens à ses actes». Dans une œuvre méthodique, lisible et compréhensible, les Mahmoud Hussein proposent un véritable parcours de réflexion pour établir le lien entre l’homme et son créateur. Une lecture qui permet de prendre les distances nécessaires face aux questions de notre siècle.
