Influences
Maladies rares : Des problèmes à foison et des solutions envisageables
Définies comme toute maladie touchant moins d’une personne sur 2.000, les maladies rares avoisinent les 8.000 et on en recense de nouvelles chaque année. Au Maroc, le nombre de patients souffrants serait de l’ordre d’au moins 1,5 million, voire 1,8 million.
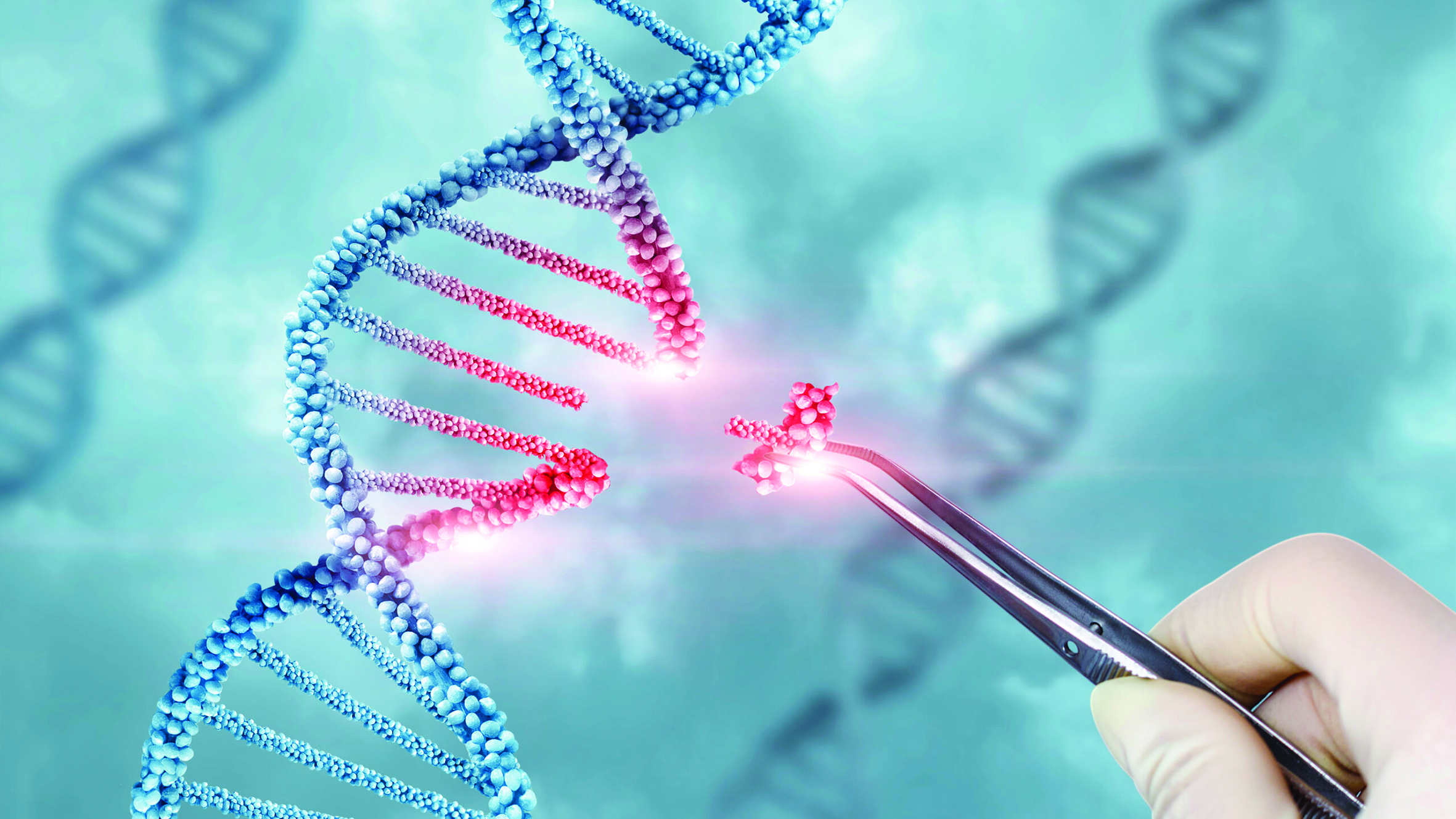
Prises chacune individuellement, les maladies rares «souffrent» d’une légion de problèmes, de défaillances du système de santé à leur égard, des tares qui n’en finissent tout simplement pas. Mais comme il faut bien commencer quelque part, ne seront traités ici que les principaux problèmes et défaillances concernant les maladies rares en tant que telles, c’est-à-dire en tant que groupe de pathologies. Nous parlerons donc principalement de l’errance diagnostique, de la couverture médicale qui laisse à désirer, du dépistage néonatal nécessaire et du statut de «médicament orphelin» qui se fait toujours attendre.
Pour Khadija Moussayer, présidente de l’Alliance des maladies rares au Maroc, ce qui est le plus urgent à mettre en place, ce sont des solutions pour contrer l’errance diagnostique. Elle explique que la couverture médicale est défaillante, que le dépistage néonatal systématique est à instaurer et, enfin, elle nous informe qu’il s’avère nécessaire de mettre en place un statut de «médicament orphelin» pour accélérer la mise sur le marché de médicaments salutaires pour les patients.
L’errance diagnostique, une fatalité !
La période entre les premiers symptômes d’une maladie et son diagnostic confirmé s’avère être une véritable souffrance pour les malades et leurs familles. Et très peu y échappent. Le docteur Moussayer explique: «Aujourd’hui, il faut souligner que l’information est encore fragmentaire pour les patients comme pour les médecins. Les maladies rares représentent pour le patient et sa famille un véritable parcours du combattant au Maroc fait de nombreuses consultations chez plusieurs médecins. Il faut souvent de nombreuses années pour qu’un diagnostic soit établi et les traitements administrés». Même son de cloche chez le docteur Tayeb Hamdi, médecin et chercheur en politiques de santé : «Les maladies rares nous confrontent à divers problèmes, dont celui du diagnostic.
Généralement, ni la population, ni le patient, ni le médecin, ni le professionnel de la santé ne connaissent la maladie et ses symptômes. Et cela conduit à ce qu’on appelle une errance de diagnostic. Les gens souffrent de symptômes, ils consultent, mais en moyenne il faut attendre, en Europe, 5 ans pour avoir un diagnostic». Tayeb Hamdi énonce également les problèmes engendrés par cette errance diagnostique: «L’errance diagnostique veut dire un retard de prise en charge adaptée, oui, mais ça veut aussi dire qu’on prend des traitements et des médicaments inadaptés. Le patient souffre de la maladie, qui évolue, et simultanément prend des traitements qui, peut-être, ont des effets indésirables, puisque ces médicaments et traitements ne sont pas adaptés à son cas».
Des traitements qui aggravent peut-être le cas… Et inutile même de parler de l’impact psychologique de pareil retard, qui dure des années et des années, quand on ne sait même pas ce que nous, ou nos enfants, «couvons». Ou cet espoir de guérir après un faux diagnostic suivi du désespoir qui va de soi en voyant la situation ne faire que se dégrader. D’ailleurs, au lieu de parler de solution à ce problème, Khadija Moussayer affirme que ce problème lui-même est issu de l’inexistence de ce qui le résoudrait. Incompréhensible ? «Cette errance diagnostique est due notamment à l’absence d’un dossier médical unique et d’un médecin référent qui centralise les informations et coordonne les soins comme cela se fait en Europe.
Bien que des efforts aient été accomplis ces dernières années dans les CHU au Maroc, le manque d’informations sur ces maladies est par ailleurs toujours patent, aussi bien pour les professionnels que pour les autorités», explique-t-elle. Tayeb Hamdi est du même avis : «Il faut qu’on ait des parcours maladies rares, des médecins référents, des experts référents dans telle ou telle maladie rare, pour que les médecins dans leur cabinet ou à l’hôpital ou autre peuvent avoir des spécialistes à qui s’adresser, à des fins d’orientation de leur prise en charge. C’est très important les parcours maladies rares. Il faut des parcours pour l’hémophilie, pour la sarcoïdose, pour toutes les maladies rares. Généralement, ce sont des parcours pour un ensemble de maladies rares qui vont ensemble».
Un ou plusieurs centres spécialisés dans les maladies rares, avec en leur sein des médecins référents disponibles aux autres médecins dans le Royaume, ne semble en effet pas être un simple luxe. «Parfois, le diagnostic est simple, comme pour le cas de la sarcoïdose, de la drépanocytose ou de la thalassémie. Il suffit de pousser un peu pour les diagnostiquer. Mais il y a des maladies qui sont vraiment rares, et même ultrarares, peut-être un cas sur un million, ou sur cinquante millions, quand on a seulement 80 ou 100 cas dans le monde, là ce n’est pas facile», relève Dr Hamdi.
Couverture médicale et dépistage néonatal
Il faut ici savoir que de nombreuses maladies rares ne disposent pas du statut d’affection de longue durée (ALD), un statut qui leur garantirait pourtant une prise en charge et un remboursement automatique des soins, chose dont les malades ont très souvent un besoin vital. Khadija Moussayer s’exclame : «En l’absence de ce statut, le patient ou sa famille est souvent confronté à des problèmes financiers insolubles, car il ne peut bénéficier que d’un remboursement dérogatoire, devant être renouvelé continuellement et avec le risque d’une suspension à tout moment ! De surcroît, la Sécurité sociale ne couvrant que très rarement l’intégralité des soins, le reste à payer, appelé “ticket modérateur”, est à la charge de l’assuré !» C’est certes extrêmement problématique. Et des mesures s’imposent impérativement en ce sens.
Les maladies rares n’arrivent pas qu’aux gens aisés… C’est même loin d’être le cas, selon de nombreux témoignages que nous avons recueillis. L’aspect financier est l’un des aspects les plus pénibles qu’ont à vivre de très nombreux patients atteints de maladies rares. Pour ce qui est du dépistage néonatal, il n’est malheureusement toujours pas généralisé à l’ensemble de la population marocaine. Or, «le dépistage systématique permettrait d’éviter les handicaps mentaux lourds que certaines maladies rares engendrent faute d’avoir été détectées dès la naissance. Il en est ainsi de l’hypothyroïdie congénitale et de la phénylcétonurie qui peuvent être soignées facilement, respectivement par un traitement peu onéreux (la lévothyroxine, une hormone thyroïdienne) et par un régime alimentaire spécifique (un régime pauvre en phénylalanine, un acide aminé)», affirme Dr Moussayer. Effrayant, quand on sait ce qu’est l’errance diagnostique, cette fatalité… Sans dépistage néonatal systématique, il serait donc, la plupart du temps… trop tard ?
Pas de statut «médicament orphelin» !
Comme si cela ne suffisait pas, même les traitements existants ailleurs peinent à être acceptés au Maroc. Le docteur Khadija Moussayer ne mâche pas ses mots quand on aborde ce sujet sensible, et on la sent offusquée par toute cette pénibilité administrative dangereuse : «Il paraît urgent de mettre en place un statut de «médicament orphelin» pour les thérapeutiques employées dans les maladies rares en offrant notamment un accès plus rapide au marché par un raccourcissement des délais d’autorisation de mise sur le marché (AMM), à l’exemple de ce qui se fait déjà dans beaucoup de pays en Europe ou en Amérique. Actuellement, un certain nombre de médicaments, même peu coûteux, pouvant sauver les malades de la mort, n’existent pas au Maroc !» Cette dernière nous donne des exemples : «Il s’agit par exemple de beaucoup de traitements utilisés contre l’angiœdème héréditaire, une maladie rare qui se manifeste par des gonflements au niveau du visage, des extrémités ou des organes génitaux, qui provoque souvent des douleurs abdominales atroces et où il existe un risque de décès par asphyxie».
À savoir que l’extrême majorité des maladies rares n’ont pas de traitement. Les propos du docteur Tayeb Hamdi sont sans équivoque : «Même avec le bon diagnostic, les thérapies et médicaments ne sont pas toujours accessibles et 95% de ces maladies restent sans traitement. Cela nécessite de la recherche, du réseautage des professionnels de santé, des patients, pour s’épauler, échanger et communiquer. C’est très important». Mais s’il n’y a pas de traitement, que fait donc le médecin ? Et le Docteur Hamdi de répondre : «Il y a beaucoup de maladies rares pour lesquelles on a des moyens de suivi, d’accompagnement, mais aucun moyen de traitement, comme c’est le cas pour la drépanocytose. Il y a certes un traitement coûtant 2 millions de dollars pour traiter la thalassémie, un traitement qui vient d’être approuvé il y a quelques semaines pour traiter la drépanocytose, mais on n’a pas accès à ces traitements». Un médicament coûtant 2 millions de dollars ! Un médicament existant, mais inaccessible financièrement (sauf pour les gens aisés)… Mais le docteur Hamdi ne baisse jamais les bras: «Il n’empêche que nous suivons les patients atteints de ces maladies, pour leur permettre une meilleure qualité de vie, d’espérance de vie, et le moins de souffrances et de problèmes possible. Mais sur les 8.000 maladies rares, 95% n’ont pas de traitement. On a des traitements que pour 5% de ces maladies rares, et qui sont généralement des maladies infectieuses, virales, cancéreuses. Pour les maladies génétiques, on n’a généralement pas beaucoup de solutions».
La question devient : l’industrie pharmaceutique est-elle donc à blâmer ? D’ailleurs, c’est une question que tout le monde se pose sans faute, à chaque fois qu’on parle de maladies rares. Ce qui est humain. On se demande si l’industrie pharmaceutique se soucie ou non de ces pathologies. Et cette question mérite un article à part entière.













