Société
La chaîne de la solidarité s’est rompue dans les grandes villes
Les valeurs de solidarité caractéristiques de la société traditionnelle au Maroc, qui disposaient de leurs propres institutions (telle «dar solh») subissent une érosion inéluctable.
Les lieux modernes de rencontre – associations, clubs,… – s’ils sont lieux de partage, ne peuvent, selon les sociologues, rivaliser avec les structures traditionnelles (famille, voisinage), ni, surtout, apporter la même chaleur dans les relations humaines.
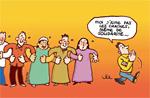
La solidarité et l’entraide, valeurs ancestrales, sont-elles en train de perdre du terrain, au profit de l’individualisme, inhérent à la montée en puissance du libéralisme ? C’est une question que l’on peut se poser.
Naguère, il n’était pas rare de faire allaiter son bébé par la voisine
Naguère, il était courant de laisser son bébé chez la voisine et partir faire ses courses. Cette grand-mère que nous avons interrogée se rappelle, en poussant un long soupir, que ses enfants ne lui appartenaient pas à elle toute seule. Ils étaient ceux de toute la famille, des voisins du quartier, et tout le monde en prenait soin, sans attendre la moindre contrepartie. Mieux, raconte-t-elle sur un ton nostalgique, «plusieurs de mes bébés n’ont pas tété uniquement mes seins, mais aussi ceux de leurs tantes paternelles et maternelles. Et même des voisines qui avaient encore du lait, sans la moindre gêne. J’ai enfanté dix fois, la maison comme vous voyez est maintenant vide, j’y habite toute seule alors qu’il y a cinquante ans, elle grouillait de monde et bourdonnait comme une ruche.»
Cette octogénaire a du mal à s’accommoder de sa solitude et à ravaler son chagrin. Ses dix rejetons se sont dispersés comme poussière à travers la ville, le pays ou le monde. Quatre sont en Europe, deux aux Etats-Unis, deux à Rabat. Les deux autres habitent à Casablanca. Tous mariés, avec des enfants. Viennent-ils la voir et va-t-elle chez eux ? Oui, évidemment, répond-elle. «Mais chacun s’est frayé son chemin. Nous ne nous sommes plus réunis au grand complet que lors de l’enterrement de leur père, il y a dix ans».
Les liens familiaux et de voisinage se sont-ils distendus aujourd’hui ? La famille, lieu de joie et de peine, havre d’affection et de paix, réceptacle de toutes les tensions et conflits (de génération) s’est-elle dissoute ? Les valeurs traditionnelles incrustées dans l’inconscient collectif des Marocains et qui régissaient la famille : chaleur humaine, soutien au plus vulnérable, solidarité avec les proches frappés par le malheur, se sont-elles effondrées ?
La solidarité est d’abord une affaire de famille
Ce qui est indéniable, c’est que les liens de voisinage en ont pris un sacré coup. «Je ne rencontre mon voisin de palier que dans l’ascenseur, et c’est tant mieux comme ça. Avec mes soucis et mes préoccupations quotidiens, si j’arrive à consacrer un moment le soir et le week-end à ma femme et à mes enfants, je m’estime heureux», avoue ce cadre bancaire qui vit dans un immeuble en copropriété.
Les spécialistes de la famille s’accordent à dire que les valeurs de solidarité et d’entraide existent encore dans l’inconscient culturel des Marocains. Toutefois, elles sont en train de subir une érosion irréversible. Mohamed Elmarjane, professeur de sociologie de la famille à la faculté des lettres de Rabat, pose ce postulat : la solidarité et l’entraide, deux valeurs fondamentales dans la société traditionnelle marocaine, imprègnent d’abord et avant tout l’espace familial. «Elles découlent de la culture générale qui gouvernait les familles, or un individu n’a de respect que pour cette culture». Pourquoi ? Parce que «la famille, répond-il, est un espace de confiance et de générosité, c’est un espace où les calculs mesquins n’ont pas lieu d’être. Rendre visite à un parent était un devoir, et l’on n’attendait rien en retour. Laisser un enfant ou un bébé chez une voisine ou chez un parent pour les garder pendant son absence était un geste banal. La voisine ne demandait pas de récompense. L’esprit du marché n’existait pas».
Autrefois, la solidarité était une règle de conduite, conclut ce professeur. Et il donne deux exemples pour étayer son propos : lors de l’emprisonnement d’un membre de la famille, d’un voisin, ou d’un proche, une «cellule» se constituait spontanément, regroupant tous ceux qui connaissaient le prisonnier, appelée «cellule de soutien et d’aide au prisonnier» (cellule sadaqa, charité, ou haq assajine, droit du prisonnier). C’était un acte naturel.
L’autre exemple concerne la vie du couple. Une institution de veille existait dans la société traditionnelle, appelée dar solh (maison de réconciliation) : une scène de ménage éclatait-elle ? Ladite cellule, composée de gens connus pour leur impartialité et leur probité, intervenait pour départager le couple et circonscrire rapidement le contentieux, avant que les institutions officielles ne s’en emparent. «Cette solidarité et cette entraide disposaient donc d’institutions ad hoc qui les confortaient. Ces institutions sont mortes depuis longtemps».
Ahmed Motamassik, professeur de philo à l’Ecole normale supérieure de Casablanca, insiste, lui, sur le fait que la solidarité qui caractérisait la société traditionnelle n’est pas morte avec l’émergence de la société moderne. Seulement elle se traduit aujourd’hui à des degrés et des formes qui diffèrent, eu égard à l’importance des relations qu’entretiennent les gens les uns avec les autres: famille, quartier, tribu, ville, région. Et de souligner un détail, qui a son importance : au-delà de la forme matérielle, la solidarité est aussi et surtout morale, sociale et psychologique. «Le social, soutient-il, est très important : un individu peut ne pas avoir besoin de soutien matériel, ce qu’il cherche, surtout, c’est le soutien moral et social. Ce qu’il cherche c’est être reconnu par le groupe auquel il appartient et par la société dans laquelle il vit (j’ai plus de valeur si je suis reconnu, apprécié, considéré autour de moi )».
Mais le soutien matériel n’est-il pas, lui aussi, une forme de reconnaissance et de considération de l’individu par le groupe auquel il appartient ? «Rien n’est plus sûr», répond-il. Et il cite cet exemple qui en dit long sur le rôle du côté matériel dans la solidarité. Un cadeau, n’est-il pas, aussi, une forme symbolique, de solidarité ? Pourtant, le bénéficiaire de ce cadeau sera plus satisfait, se sentira plus valorisé si sa valeur vénale est importante.
L’élan de solidarité, pour Moutamassik, existe encore, mais la gestion de cette solidarité au quotidien diffère selon le milieu social. «Et c’est tout à fait normal puisque, à l’époque moderne, chacun gère et organise son temps en fonction de ses contraintes. L’ouvrier gère son temps différemment d’un patron, le premier peut manifester sa solidarité rapidement et physiquement, l’autre ne le fait pas sur le champ, mais il le fera peut-être par téléphone ou par fax».
«La générosité des MRE ? elle n’est qu’apparente»
Quand on demande à M. Moutamassik si la générosité des Marocains résidents à l’étranger (MRE) à l’égard de leurs parents vivant dans le pays peut être considérée comme une forme de solidarité, le professeur de philo reste dubitatif. Elle ne serait qu’apparente, rétorque-t-il. «Il y a chez eux ce qu’on appelle en sociologie “traditionalisation par excès de modernité” : ils vivent dans la société occidentale, mais restent attachés à des réflexes traditionnels par obligation morale. Ils continuent à vivre la société traditionnelle par procuration. Ils peuvent tout abandonner, sauf ridat al walidine (la bénédiction des parents). S’ils envoient de l’argent ou achètent des biens immobiliers à leurs parents, c’est, en quelque sorte, pour garder des liens au plan affectif. Pour preuve, ceux qui sont loin et qui se sont entièrement intégrés dans la société occidentale, conservent de moins en moins cette relation.»
L’essoufflement de l’élan solidaire dans la société marocaine moderne n’est pas à démontrer. Les actes solidaires à l’égard des plus vulnérables matériellement, des personnes sinistrées, en deuil ou en proie à une affliction ne courent plus les rues comme auparavant. Preuve en est, le nombre de divorces traités par les tribunaux de famille, l’échange des visites familiales qui va en se réduisant au strict minimum. Normal, disent les sociologues, la société industrielle gagne du terrain, la générosité n’est plus ce qu’elle était. Des moyens technologiques comme la télé, l’ordinateur, l’internet, ou les jeux vidéo ont assené un coup fatal au sens du partage et de la convivialité.
Mais il y a une raison de taille, celle-là, qui a précipité dans l’abîme le sens de solidarité chez les Marocains: la quasi-disparition de la grande famille. Cette famille élargie qui hébergeait plusieurs générations, est supplantée désormais par la famille nucléaire. Cette «nucléarisation» s’observe à tous les niveaux, «jusqu’au niveau architectural», précise Mohamed Elmarjane.
Une maison est constituée désormais d’une chambre à coucher (celle des parents), une chambre (ou plusieurs) pour les enfants, un salon, une cuisine et une salle de bains. Cette structure architecturale étouffe la convivialité. Elle tue cette chaleur humaine qui dominait les relations d’antan entre enfants, parents et grands parents. Pis : dans les milieux aisés, chaque enfant exige sa propre chambre à coucher.
Les associations civiles et les clubs ne sont-ils pas également des structures de rencontre, de partage et de solidarité qui peuvent prendre le relais de la famille ? «Ces espaces sont incapables de remplacer la chaleur des relations familiales, et de voisinage», qui constituent une «solidarité organique», comme dirait Durkheim, affirme Mohamed Elmarjane.
Autre constat affligeant : les occasions de rencontres (mariages, fêtes ou funérailles) existent toujours, certes, mais elles seraient devenues, selon notre interlocuteur, «des occasions d’exhibition à outrance de la richesse, toutes classes sociales confondues.» Le rôle fonctionnel même de la famille aurait subi un changement profond. C’était un rôle d’abord éducatif. Il est légué, désormais, à l’école. Les rôles se seraient inversés : c’est l’enfant qui éduque désormais les parents ; il parle anglais, manie l’outil informatique et le portable mieux que sa mère ou son père.
Cependant, la solidarité et l’entraide n’ont pas totalement disparu, puisque la culture qui les nourrit perdure encore, soutient Elmarjane : la disparition d’un système culturel n’est pas une affaire de quelques années, mais de dizaines, dit-il, sinon de siècles. «Il y a des résidus qui se manifestent encore». Mais la famille, diraient d’autres, n’a pas que des vertus comme la solidarité et l’entraide, elle est aussi envahissante, elle brime la liberté et l’épanouissement de l’individu qui aspire à voler de ses propres ailes. Mais c’est une autre histoire.
