Société
Abdesselam Aboudrar : «La corruption n’est pas une maladie qu’on traite avec des médicaments»
La nouvelle entité, l’Instance nationale pour la probité, la prévention et la lutte contre la corruption, poursuivra tout le travail de prévention entamé par l’ICPC. Elle aura, en plus, le pouvoir d’autosaisine, d’investigation et celui d’ester en justice.
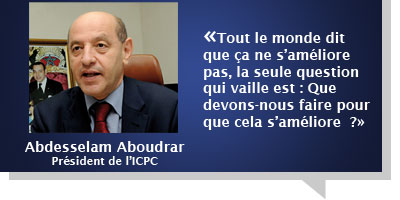
Ce mois de novembre, le mandat des membres de l’assemblée plénière de l’Instance centrale de prévention de la corruption (ICPC) prend fin. Vont-ils être remplacés par d’autres ou faudra-t-il attendre d’abord l’instance créée par la nouvelle Constitution ?
Abdesselam Aboudrar : Il n’est pas nécessaire, à mon sens, de nommer de nouveaux membres. Le plus probable est que ces derniers soient reconduits jusqu’à la création de la nouvelle instance. On s’est déjà mis d’accord sur un projet de loi organisant cette dernière, qui remplacera l’ICPC actuelle, et qui se dénommera, comme le prévoit la nouvelle Constitution, «l’Instance nationale pour la probité, la prévention et la lutte contre la corruption». Le texte est actuellement au SGG, il a été mis en ligne pour un débat public, et il suivra le cheminement normal de tout projet de loi. Si tout se passe bien, l’ICPC ne sera plus dans quelques mois, elle sera remplacée par cette nouvelle institution constitutionnelle.
On a l’impression que l’ICPC n’est plus dans le même enthousiasme des débuts, les membres actuels de la plénière se plaignent d’ailleurs d’une certaine lassitude…
N’exagérons rien. Les membres sortants de l’assemblée plénière ont fait preuve d’un grand dévouement. Au moins les deux tiers ont toujours répondu présent lors des 11 plénières tenues depuis la création de l’instance. Certes, ces derniers temps ont été plutôt consacrés à un travail d’évaluation, mais nous avons tout de même produit cette année deux études sectorielles très importantes, une sur la santé et une autre sur le transport. Nous avons aussi élaboré deux plateformes, une pour l’accès à l’information et une autre sur le conflit d’intérêts, sans parler de nos réunions pour affiner le projet de loi de la nouvelle instance. Sans oublier que les membres de l’ICPC le sont à titre bénévole et prennent même en charge leurs propres déplacements tout en exerçant par ailleurs des responsabilités à plein temps dans leurs structures respectives.
Quelle est la différence entre l’actuelle instance et celle qui va lui succéder ?
La nouvelle instance continuera tout le travail de prévention qui a été celui de l’ICPC, mais avec, en plus, un pouvoir d’autosaisine et un pouvoir d’investigation à définir.
Vous vous sentirez donc plus à l’aise dans l’instance, nouvelle formule, avec plus d’indépendance comme vous le réclamiez ?
Il faut attendre d’abord le verdict du Parlement, mais on aura déjà un acquis par rapport à l’ICPC actuelle : la nouvelle instance est un organe constitutionnel, et jouira en effet de plus d’indépendance. Il reste maintenant à la doter de plus de prérogatives et de plus de moyens humains et financiers à la mesure des attentes et des missions qui lui sont assignées. Concrètement, cela veut dire qu’on aura droit à un accès libre et sans entraves à l’information. Désormais, on est dans la configuration de pouvoir demander cette dernière, à n’importe quelle institution (Cour des comptes, inspection générale des finances, inspection générale de l’administration territoriale…) et de l’obtenir de droit, cela n’existait pas avant. Deuxio : la prochaine instance disposera d’un pouvoir et de moyens d’investigation plus forts, un pouvoir d’investigation pré-judiciaire, dois-je le préciser, car nous ne voulons pas empiéter sur le travail de la justice, dont le fondement premier est la protection des droits des citoyens.
A quoi servira dans ce cas ce travail d’investigation ?
Il faut dire que le délit et le crime de corruption sont très complexes, ils nécessitent une certaine expertise pour relier les fils de ce qui est administratif, politique, financier, économique, social… Nous pensons que nous sommes capables d’apporter cette expertise pour éclairer la justice dans son travail de sanction des délits et des crimes de corruption. Sans compter qu’il y a un volet de protection des victimes et des témoins de corruption auquel nous pourrons contribuer. Nous apporterons, par les dossiers sur lesquels nous aurons enquêté et que nous soumettrons à la justice, un éclairage sur des affaires de corruption, tout en ayant, bien entendu, un regard sur l’application des lois et sur les procédures judiciaires.
L’Instance pourra-t-elle ester en justice?
Oui elle le pourra, du moment qu’elle aura le pouvoir d’autosaisine. Exemple : si un rapport de la Cour des comptes révélait des dysfonctionnements, divers et variés (administratifs, mauvaise gestion, dilapidation des deniers publics…) avec une présomption de corruption, nous pourrions après enquête apporter des éléments de preuve, de nature à corroborer l’acte de corruption, et saisir alors la justice pour qu’elle fasse son travail. Le fait de se porter partie civile peut aussi être une façon de protéger les victimes, les témoins et les dénonciateurs.
Revenons-en maintenant aux ressources matérielles…
Soyons clairs, lorsque l’ICPC a été créée, nous avons eu droit la première année à un budget de 15 MDH pour amorcer notre travail. On nous a signifié que ce n’était qu’une avance, un budget provisoire, en attendant que nous ayons des plans d’actions et une stratégie bien définie. Mais dès la fin de la première année de notre existence, nous avons élaboré des plans d’action qui nécessitaient des ressources, un budget de l’ordre de 35 MDH (sans parler du budget d’équipement). Mais, à notre grand étonnement, nous avons constaté que la somme de 15 MDH, qui n’était en fait qu’une avance, devient notre budget annuel, réduite en plus de 10%, vu la politique de rigueur budgétaire suivie par le gouvernement. Nous nous sommes donc trouvés avec un budget de 13 MDH, or il faut comprendre que la lutte contre la corruption est un investissement et non pas une charge, c’est une dépense certes, mais derrière laquelle on doit attendre un retour sur investissement. Nous voudrions qu’on nous dise : «On vous donne tant, à charge pour vous de ramener au budget de l’Etat tant». Comme toutes les agences contre la corruption qui existent de par le monde, on est une instance dotée désormais de pouvoirs importants, mais on a droit aussi à des ressources conséquentes à charge pour nous de récupérer, en partie au moins, les deniers publics détournés d’une façon ou d’une autre.
A combien estimez-vous ce budget ?
Trois ou quatre fois plus que ce qui nous est alloué maintenant, pour mener à bien notre travail, d’autant que le décret de l’ICPC prévoit déjà la création de commissions régionales de lutte contre la corruption pour faire un travail de proximité et de terrain. Nous avons présenté un programme dans ce sens, que nous avons abandonné faute de moyens. Un autre volet qui demande aussi des ressources : approfondir la connaissance du phénomène de la corruption, autrement dit mener des enquêtes pour mieux l’attaquer. Des enquêtes et des études dans tous les secteurs connus par l’ampleur de la corruption qui y sévit s’imposent ; une ou deux par an, chose que nous faisons actuellement, ne suffisent pas. Nous avons commencé par la santé et le transport, il nous faudra nous attaquer aux autres secteurs névralgiques où cette corruption est endémique, mais il nous faut les moyens pour cela. Comme nous sommes maintenant un organe indépendant, il serait normal que nous défendions notre budget nous-mêmes devant le Parlement.
Vous faites partie ès qualité de l’autorité pour la réforme de la justice, quel serait votre apport ?
Apporter notre expertise et des propositions concrètes concernant le volet dit moralisation de la justice, et sur la manière dont la justice peut jouer un rôle majeur dans la lutte contre la corruption. Nous avons présenté dans ce sens un mémorandum contenant ces propositions, dont une synthèse a été présentée lors d’un des dialogues thématiques qu’a organisés cette autorité.
Considérez-vous la réforme de la justice comme un préalable à toute lutte contre la corruption ?
Je n’aime pas le terme préalable, car il signifie que nous ne devrons rien faire avant que tout soit prêt. Plus nous essayons de trouver, dans le concret (et non dans une approche de simple dénonciation) des solutions pour lutter contre la corruption, plus nous prenons conscience de l’ampleur de la tâche qui nous est assignée en tant qu’instance. La corruption n’est pas comme une maladie qu’on peut traiter par des médicaments et par la prévention, c’est plus complexe que cela. Nous insistons toujours au sein de l’ICPC sur la nécessité de mettre en place un système national d’intégrité, et cela recouvre des réformes majeures (économiques, administratives, judiciaires…), et des plans d’action menés main dans la main avec tous les autres acteurs. Nous savons qu’il faut choisir des angles d’attaque, mais nous savons aussi qu’il faut commencer à tous les niveaux, sans attendre au préalable que cela mûrisse quelque part. Pour lutter contre la corruption, nous n’allons pas attendre le jour où les monopoles économiques seront supprimés, les procédures administratives simplifiées, la justice réformée… et j’en passe. C’est pour cela que nous sommes en train de travailler sur plusieurs fronts en même temps : gouvernance des entreprises publiques, réforme de la justice, concurrence ouverte et loyale, administration électronique…Et nous travaillons pour établir une cartographie des risques dans le secteur de la santé, pour mettre en place des plans d’action ciblés, nous ferons la même chose dans le transport et dans les autres secteurs. C’est un travail multiforme et de longue haleine, les chaînons se tiennent, et c’est ce qui rend difficile l’évaluation des résultats. Tout le monde dit que ça ne s’améliore pas, la seule question qui vaille est : que devons-nous faire pour que cela s’améliore ?
Ce sont les résultats qui comptent, et pour les citoyens et pour les organismes internationaux de notation…
Une évaluation objective ne peut se faire tant qu’on n’a pas mis en place la stratégie dont j’ai parlé. Si on clarifie les objectifs, les responsabilités des uns et des autres, si on alloue les ressources dont on a besoin, si on fixe des délais de réalisation de ces objectifs, l’évaluation sera facile, et elle sera positive.
Au lieu de mesurer la perception de la corruption comme fait l’indice de Transparency International, les experts proposent désormais de mesurer les efforts et les progrès en matière de lutte contre la corruption. La corruption, comme la criminalité et la drogue, est un phénomène social, il faudra toute une politique impliquant tous les acteurs pour la faire reculer. La corruption baisse ou augmente selon la stratégie mise en place, les moyens mobilisés, et les approches novatrices adoptées. Décrire le phénomène, le décrier, le dénoncer est certes utile mais ne fait pas avancer les choses, ce qui compte ce sont les solutions que l’on peut préparer et mener à bien pour l’enrayer.
Comment est le climat de travail avec le gouvernement guidé par le PJD ?
Nos relations sont bonnes. Nous lui avons remis un premier rapport dès son investiture, un résumé de toutes nos propositions qui s’articulent autour de dix axes, puis plus récemment le rapport de 2010-2011. Mais dans l’immédiat, on n’a pas encore défini une stratégie contre la corruption, or c’est la porte d’entrée.
Des affaires sont devant la justice, celle de Benalou, Alioua…, quel regard portez-vous là-dessus?
Nous n’avons pas à interférer dans l’action de la justice. Nous espérons un traitement sérieux respectant la présomption d’innocence, les droits de la défense et des procès équitables.
Et vos relations avec les autres instances : CNDH, CES, le Médiateur… ? On a l’impression que chacun travaille dans son coin et défend sa paroisse…
Nous avons certes des relations de coopération et participons parfois à des actions communes. Exemple : le CNDH travaille sur les droits de l’homme et la corruption et nous y participons en tant qu’instance, de même que nous avons travaillé ensemble lors de l’observation des élections, car il y a la partie utilisation de l’argent. Mais cela ne suffit pas, nous regrettons l’absence de mécanismes institutionnels de coopération et de coordination, et justement nous y travaillons. L’action de l’un verse dans celle de l’autre. Ce que fait la Cour des comptes est important et nous concerne tous, la même chose en ce qui concerne le CNDH, le Conseil national de la concurrence, l’institution du médiateur, la HACA, et j’en passe. Et des autres conseils qui vont voir le jour de par la nouvelle Constitution, il ne faut pas les oublier, celui de la parité, de la jeunesse…
La coordination institutionnelle entre tous ces organes, et la responsabilisation de chacun d’eux, sont indispensables pour les missions que nous menons tous. C’est dire que l’édification d’un système national d’intégrité n’est pas l’affaire de la seule ICPC ou de l’Instance de probité de prévention et de lutte contre la corruption qui va lui succéder.
