Culture
Voyage au siècle de Moulay Hassan Ier
«Le voyage du sultan Moulay Hassan au Tafilalt» relate le périple
de Hassan Ier, à la tête de trente mille hommes, de Fès au
Tafilalt, et du Tafilalt à Marrakech, de juin à décembre
1893. Quelques mois plus tard, le sultan rendait l’âme à Dar
Ould Zidouh. Une belle histoire, qui pourrait inspirer nos cinéastes.
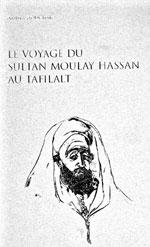
Lorsqu’une historienne rigoureuse, un photographe perspicace et une éditrice aguerrie conjuguent leurs talents, le fruit de leur labeur ne peut être que superbe. En publiant Le Voyage du Sultan Moulay Hassan au Tafilalt, les éditions Senso Unico ont donné une âme à un sujet d’histoire. Le texte de l’historienne Amina Aouchar n’est nullement académique. Son style, quasi romanesque, peut être considéré comme une nouvelle manière d’aborder l’histoire et surtout de la faire partager ; et par là-même de la faire aimer. La narration est en parfaite harmonie avec l’iconographie et les photographies de Franco d’Alessandro. Ainsi, documents d’archives (lettres officielles, manuscrits, carnets des topographes, dessins et aquarelles, photographies anciennes) côtoient les clichés contemporains.
C’est l’époque où l’expansion européenne se confirme
Passé et présent sont ainsi réunis. La mémoire se fait offrande. Un thème qui aurait pu paraître ardu et fastidieux devient accessible et plaisant. C’est comme si le lecteur se métamorphosait en voyageur, convié qu’il est à une aventure dans l’espace et le temps, durant laquelle il ira de surprise en surprise.
Ce périple royal a plusieurs buts, rappelle l’auteur: «Le Sultan appelle les populations du Maroc intérieur à oublier leurs dissensions. Il est aussi l’occasion pour le Souverain d’affirmer la souveraineté marocaine sur le Sud-est. Il est enfin un pèlerinage aux tombeaux des ancêtres de la dynastie alaouite, la démarche d’un homme pieux qui s’en remet à Dieu face à la situation tragique que connaît son Royaume». Il faut dire qu’à cette époque (seconde moitié de l’an1893), l’expansion européenne en Afrique du Nord se confirme. Malgré les réformes clairvoyantes, voire audacieuses décidées par Moulay Hassan Ier, le pays subit encore les affres des sécheresses consécutives, et le poids d’indemnités de guerre exorbitantes imposées suite à la défaite contre l’Espagne, en 1860. «Les instructeurs étrangers voyageaient librement à travers le pays, se livraient à des activités inquiétantes, rassemblaient des informations sur la population, dressaient des cartes. Le Royaume n’était pas en mesure de repousser les offres de service des puissances coloniales dont l’influence ne faisait que s’étendre».
Il était convaincu que le salut de son pays ne pouvait venir que de la fidélité aux traditions
Par ailleurs, d’anciens traités (système des capitulations) accordaient des privilèges fiscaux et juridictionnels aux étrangers et à certains autochtones spéculateurs. «Le début des années quatre-vingt, qui inaugurait un nouveau siècle de l’hégire, s’annonçait donc sous de bien sombres augures, d’autant plus qu’à l’est, l’Egypte et la Tunisie, qui avaient pourtant adopté plus tôt un programme de réformes, succombaient à la colonisation. A l’orée du XIVe siècle de l’hégire, le Sultan fit lire dans toutes les mosquées un long mandement de morale politique, dont l’inspiration et la formulation constituaient une sorte de réponse et de défi à cette histoire profane qui de toutes parts assaillait le Maroc. Et peu à peu il délaissa ces réformes, entreprises sans trop de conviction, sans véritable plan d’ensemble, tant il était convaincu que le salut de son pays ne pouvait venir que de la fidélité aux traditions», souligne l’auteur.
Le temps passe, mais l’essentiel doit demeurer immuable. A l’instar du rythme hebdomadaire du sultan. Ce dernier rendait la justice le dimanche et le mardi. Le lundi et le mercredi étaient consacrés à l’inspection des troupes. Le jeudi était réservé à ses proches. Et bien sûr, le vendredi, le Commandeur des Croyants présidait la grande prière hebdomadaire et distribuait l’aumône. «Tout est donc éphémère, rien n’est appelé à durer, l’éternité n’appartient qu’à Dieu». Une impression saisie avec une acuité particulière par le photographe Franco d’Alessandro, lequel a patienté plus de quarante huit heures pour capturer le superbe cliché des pages 178 et 179 (ruines de Sijilmassa).
Certes, durant le long périple de 1893, bien d’autres préoccupations prédominaient. Le lecteur qui suit la trame narrative rejoint ainsi le cortège royal. En cinq chapitres, l’auteur met en branle des univers défunts. Paysages et personnages renaissent sous sa plume. L’iconographie comme les photographies les rendent encore plus réalistes. Si vous avez l’imagination fertile, vous les verrez presque apparaître au fil des pages !
On fait revivre des personnages importants comme le rekkas, les kuttab ou les topographes
Ainsi, de Fès au Moyen Atlas, en passant par la haute Moulouya, le Haut Atlas oriental, le Tafilalt, pour finalement atteindre Marrakech, on a plaisir à côtoyer une multitude de personnages, connus ou anonymes, mais dont le rôle fait à chaque fois sens.
Au gré des étapes de la mhalla (campement et aussi grande armée) du sultan, diverses tribus font acte d’allégeance, tandis que d’autres sont punies en raison de leur comportement anarchique. Reqqâs (facteur de l’époque, à pied ou à cheval), kuttâb (scribes), topographes partant en reconnaissance et esclaves ont une importance insoupçonnée.
Des étrangers, comme le médecin-major Linarés, font aussi partie du cortège royal. Ce dernier comptabilisera cinquante six étapes de Fès à Marrakech. Cela dit, la suspicion règne souvent à leur égard: «Qu’ont-ils tous, ces chrétiens, à vouloir accompagner la mhalla au Tafilalt ?» s’interroge un jeune fonctionnaire qui se souvient de la «mauvaise humeur affichée par les instructeurs français, anglais et espagnols lorsqu’ils durent quitter le camp à Mezdou». «Ils se préparent à faire ici ce qu’ils ont fait à Alger, ils veulent nous soumettre», répond tristement un vieux fqih enroulé dans son burnous, «et nous, au lieu de nous serrer autour de notre Sultan, de nous entraider, de nous rassembler, à la campagne nous nous livrons à des guerres tribales comme du temps de la jâhiliya, et à la ville nous commerçons avec l’ennemi». Et l’auteur d’ajouter : «Les conflits larvés entres membres de la cour s’exacerbent: le chambellan et le premier ministre se disputent sournoisement leurs prérogatives». Au cours de cette pérégrination, on apprend aussi que des troubles ont éclaté entre des Rifains et un détachement militaire espagnol basé à Melilla. Madrid va envoyer des troupes en renfort.
Malgré cette situation préoccupante, le sultan, dont la santé est chancelante, continue de remplir son rôle. «Il a prévu de visiter les tombeaux des saints de la région. Les topographes dressent l’itinéraire de ce pèlerinage : de Dar Beida à Sidi Ali Ben Abdallah près de Tabou’ssamt : trois heures, de Sidi Ali Ben Abdellah à Sidi al Ghazi Ben Belqacem : cinquante minutes… à Sidi al Ghazi al Arbi : trente minutes…à Sidi Ahmed al Habib : vingt-cinq minutes».
Pouvoir temporel et autorité spirituelle sont en osmose. Il faut dire que la dynastie alaouite bénéficie d’une aura singulière. En effet, au VIIe siècle de l’hégire (XIIIe siècle de l’ère chrétienne), après avoir effectué le pèlerinage à la Mecque, des pèlerins originaires du Tafilalt demandèrent à un shrif (descendant du Prophète) qui vivait à Yanbu, dans la péninsule arabique, de venir s’installer parmi eux, afin qu’ils bénéficient de sa baraka. Il accepta. Au Tafilalt, il fonda une famille, laquelle s’affirma dans la province.
Ce sont les descendants de Hassan al-Dâkhil qui entreprirent, voici plus de trois siècles, de restaurer l’unité du pays, suite à la décadence de la dynastie saâdienne : Moulay Ali Shrif fut le premier à être proclamé sultan
