Culture
Maladie d’amour, maladie de la vieillesse
La disparition de Gabriel Garcàa Mà¡rquez (Nobel de littérature en 1982) nous donne furieusement envie de relire «L’Amour aux temps du choléra» (1985), son roman le plus populaire et le plus accessible, une des plus flamboyantes odes aux sentiments amoureux.
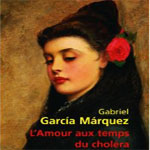
Et si Henri Salvador se trompait ? Et si l’amour était plus une affection chronique qu’une brève et banale maladie sexuellement transmissible? Dans L’Amour aux temps du choléra, le diagnostic de Gabriel García Márquez est sans appel : c’est un mal incurable, la hantise de toute une vie.
Ses personnages, Florentino Ariza et Fermina Daza, l’attrapent très vite, très tôt, dès l’adolescence. Les premiers symptômes sont tout aussi fulgurants : insomnies, fébrilité et exaltation, le tout attisé par des lettres à n’en pas finir et un platonisme des plus irréprochables. Car en ce dix-neuvième siècle finissant, les Caraïbes sont très à cheval sur les convenances, et les pères peuvent s’avérer redoutables.
Mais revenons à nos amours, à celui de Florentino pour Fermina, qui est immense et dévorant : «Elle lui semblait si belle, si séduisante, si différente des gens du commun qu’il ne comprenait pas pourquoi personne n’était comme lui bouleversé par le chant de castagnettes de ses talons sur les pavés de la rue, ni pourquoi les cœurs ne battaient pas la chamade aux soupirs de ses volants, ni pourquoi personne ne devenait fou d’amour sous la caresse de ses cheveux, l’envol de ses mains, l’or de son rire».
Une verve torrentielle, flamboyante
Hélas, après trois années d’une ardente idylle, tout s’arrête. Si la fièvre de Florentino ne cesse de croître, de le consumer, celle de Fermina tombe d’un coup lorsque arrive Juvenal Urbino, un jeune et brillant médecin, rejeton d’une illustre famille.
La belle éconduit alors le petit télégraphiste, à qui elle rappelle cruellement que «l’amour est un royaume inclément et mesquin, et que les femmes ne se donnent qu’aux hommes de caractère car ils leur communiquent la sécurité dont elles ont tant besoin pour affronter la vie».
Fermina, devenue Madame Urbino, expérimente alors, pendant plus de cinquante ans, l’amour conjugal calme et redondant auprès d’un «mari parfait» qui «ne ramassait jamais rien, n’éteignait jamais la lumière, ne fermait jamais une porte». Un lien qui malaxe les époux, jusqu’à les réduire en «un seul être divisé en deux» et qui «meurt toutes les nuits après l’amour et qu’il faut reconstruire tous les matins avant le petit-déjeuner».
Florentino, quant à lui, passera ce demi-siècle à enchaîner les conquêtes, des dizaines de femmes auprès desquelles il se console bien médiocrement de la perte de son amour de jeunesse, son amour de vieillesse, car à plus de soixante-dix ans, il espère toujours le reconquérir.
L’histoire peut sembler mièvre, désuète, peut-être même usée jusqu’à la corde.
Mais, sous la plume de Gabriel García Márquez, elle se fait époustouflante, et ce n’est guère pour flatter un écrivain disparu. L’auteur de Cent ans de solitude y déploie un récit dense, parfois étouffant, mais on lui pardonne volontiers au regard des délices qu’il nous offre ; une verve torrentielle et flamboyante, à l’image des contrées tropicales où se déroule le récit, pour décrire la condition humaine et, à travers elle, le sentiment amoureux, dans toute sa complexité, dans toute sa beauté: haletant, chaste, charnel, déçu, comblé, monocorde, ambigu, impérissable.

