Culture
Les jeunes lisent toujours, mais autrement
Depuis longtemps déjà, les spécialistes, s’inquiètent
du peu de goût de nos jeunes pour la lecture. Plus optimistes, d’autres
parlent plutôt aujourd’hui de désacralisation de l’écrit,
appelé
à coexister désormais avec l’image et le son, et affirment
que, s’il lit moins,
le jeune lit quand même, différemment.
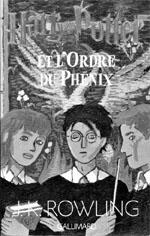
Autres temps, autres mœurs. Le soir, l’adolescent des sixties dévorait, sous les couvertures, des livres peu convenables. Myriam, professeur retraitée, se souvient de cette plaisante manie. «Je ne m’endormais jamais sans un roman. Et pas n’importe lequel. Essentiellement, ceux qui racontaient des choses qu’on taisait, à l’époque, à une jeune fille pubère, tels que L’Amant de lady Chatterley ou L’Education sentimentale. Et comme mes parents étaient très vigilants, je lisais sous les draps, à l’aide d’une lampe de poche». Aujourd’hui, les adolescents zappent, surfent et rappent entre clips, sites et mags. Il leur arrive même de lire. Mais seulement des brèves, des programmes de télé, des modes d’emploi,… Et quand ils le font, c’est assis devant «Friends», le walkman à l’oreille et la console de jeu à portée de main. L’affaire est entendue. Enseignants, parents et sociologues s’en désolent : la lecture est «un chef-d’œuvre en péril», et les lecteurs, une espèce en voie de disparition.
On jette souvent la pierre aux pouvoirs publics
On jette souvent la pierre aux pouvoirs publics. A tort, il faut en convenir. Dès sa nomination, Mohamed Achaâri avait parlé de la nécessité de «mettre le livre à la portée du lecteur pour que la lecture devienne un sujet national» et de faire en sorte que «cette question soit élevée au rang des questions majeures qui intéressent l’école, les associations, les médias, les instances gouvernementales, les professeurs, les écrivains et les intellectuels». Ces propositions ne sont pas restées lettre morte, ainsi que l’atteste le soutien substantiel apporté, depuis trois ans, au secteur éditorial. Pour autant, les jeunes ne prennent pas le chemin des librairies et des bibliothèques. Rachid, lycéen, a une passion, le football, et un culte, Jawad Zaïri ; le reste n’est que littérature. «Bien sûr que je lis, mais pas n’importe quoi. Tout ce qui concerne le football. Je ne rate jamais un numéro de Al Mountakhab et de France Football. Les romans, c’est prise de tête, c’est naze. Même ceux qui sont au programme, je ne les lis pas. Je me fais raconter l’histoire, c’est tout.» Et pan !
Tous les enfants ont des prédispositions pour la lecture
«Faites-les lire !». De savantes études, des montagnes de recommandations et des colloques à la pelle s’acharnent à étayer, depuis deux décennies, cette vertueuse injonction. Sans effet tangible. Et ce n’est pas «Le temps du livre», la campagne impulsée par le secrétariat d’Etat à la Jeunesse, consistant, entre autres, à collecter des livres pour les offrir, qui infléchira de manière significative le mauvais cours des choses, tant nos jeunes sont brouillés avec la lecture. Pourtant, celle-ci est censée être un besoin vital.
Pour l’écrivain japonais Kenzaburo Oe, par exemple, la vie s’identifie au récit. «Vivre, c’est raconter, raconter, c’est vivre», clame-t-il. Nul doute que si cette équation est concevable dans le cas d’une existence vouée à l’écriture, elle ne saurait s’appliquer au commun, englué dans son quotidien prosaïque. Il n’en est pas moins vrai que l’activité narrative forme un invariant de l’humaine condition. D’une part, toutes les civilisations forgent des récits destinés à éclairer les énigmes et percer les mystères. D’autre part, les êtres, pour s’évader du corset journalier, ménagent des plages de temps où prennent place les relations d’événements, les histoires de vie ou les derniers potins.
Que la faculté de narration relève d’une disposition innée, trouve sa confirmation dans l’aptitude précoce des enfants à tisser des histoires qui mettent en scène leur entourage immédiat. Se raconter des histoires ne peut être regardé comme un simple acte ludique, il répond souvent au besoin de pallier l’absence physique des parents. En les représentant, l’enfant les rend présents, et, de ce fait, apaise l’angoisse induite par sa solitude temporaire. Par ailleurs, un autre phénomène a été établi par les psychologues : bien avant d’accéder à l’école, les enfants se rendent compte que l’écrit recèle un sens. Mais ce sens, comment le saisir quand on ne dispose pas encore des clés nécessaires ? De constater qu’il ne suffit pas de posséder le contenant pour jouir du contenu, l’enfant se sent désemparé, comme le décrit si bien Jean-Paul Sartre, dans Les Mots : «Je voulus commencer les cérémonies d’appropriation. Je pris les deux petits volumes, je les flairai, je les palpai, les ouvris négligemment “à la bonne page” en les faisant craquer. En vain, je n’avais pas le sentiment de les posséder. J’essayai sans plus de succès de les traiter en poupées, de les bercer, de les embrasser, de les battre. Au bord des larmes, je finis par les poser sur les genoux de ma mère».
C’est à l’adolescence que les choses se gâtent
Rebuté par la sarabande de signes ésotériques qui s’enchaînent, se chevauchent, se séparent mystérieusement, l’enfant se résout à confier la tâche de leur élucidation aux grandes personnes. Cependant, il ne dépose pas les armes et revient opiniâtrement à la charge. Mais les mots se drapent toujours dans leur mutisme. Alors, l’enfant invente ou recrée une histoire tout en suivant scrupuleusement le fil des lignes et des pages. Il se contente d’un succédané, le vrai plaisir est reporté à plus tard.
L’entrée à l’école est accueillie comme une promesse de jouissance. L’enfant apprendra à lire, et donc à apprivoiser les lettres, à s’immerger dans ces mondes engloutis qui s’étaient longtemps refusés à lui. Mais le chemin à parcourir est arpenté. Ecoutons Sartre : «Les phrases me résistaient à la manière des choses. Il fallait les observer, en faire le tour, feindre de m’éloigner et revenir sur elles pour les surprendre hors de leur garde. La plupart du temps, elles gardaient leur secret.»
Une fois que les mots rétifs auront diffusé leurs saveurs, il ne reste plus qu’à se délecter des plaisirs qu’ils concoctent. La lecture est une faveur insigne dont on n’apprécie la juste valeur que lorsqu’on en est lésé, et les livres s’auréolent de vertus cardinales, que devine l’enfant. D’où son besoin de posséder son propre livre : «Le livre n’est pas seulement le support technique d’une histoire, comme une bande vidéo : le début de la transmission culturelle passe par le besoin de posséder son exemplaire personnel exprimant ainsi, de façon étrange, la passion de conquête de l’histoire qu’on peut lire et relire sans que rien n’y soit changé, ce qui est probablement une des mille façons de diminuer l’angoisse qui naît chez tout enfant dès qu’il découvre que sa vie et celle de ceux qui l’aiment ont un commencement et une fin. La lecture se substitue alors, et pour toute sa vie, à l’expérience douloureuse de la séparation», commentent René Diaktine et Jacqueline Roy, spécialistes en la matière, dans Le Monde du 11 décembre 1992. Aujourd’hui, malgré la télévision, les Pokemon et autres play-stations, le comportement des enfants n’a pas changé. C’est après le stade de l’enfance que ça se gâte. Mais dans quel sens ?
Le livre n’est plus le temple du savoir et de la culture
De nombreux discours proclament la fin de la lecture. Nombre d’experts se penchent sur la crise de la lecture. Expression doublement inadéquate. D’une part, elle laisse entendre que les générations précédentes étaient des passionnées du livre, ce qui n’est pas prouvé (on manque en effet dramatiquement d’études statistiques). D’autre part, la lecture, du moins pour les jeunes, n’est pas une pratique morte. Ils ne lisent pas énormément, mais ils lisent quant même, de différentes façons. Pour s’en convaincre, il suffit de visiter ces braderies de livres qui, à la différence des librairies, boudées en raison de la cherté des livres, font, à longueur de journée, salle comble. Que vient-on y chercher ? Essentiellement des traités scientifiques, des ouvrages d’information, et parfois des récits de science-fiction ou des polars. A la librairie «Carrefour des livres», on nous confirme cette tendance : les usuels sont très demandés par les jeunes, qui s’offrent, à l’occasion, des livres. Avec des archétypes. La science-fiction est presque exclusivement réservée aux garçons, et les témoignages douloureux ou romanesques de femmes battues, violées, vendues ou droguées aux filles.
Les jeunes ont des livres chez eux, s’en prêtent et parlent de leurs lectures avec leurs amis. Ils lisent, mais surtout des auteurs qui n’ont pas de valeur aux yeux de la culture légitime. Rowling plutôt que Mohamed Choukri, Tolkien plutôt que Abdelhak Serhane, Betty Mahmoody plutôt que Soumaya Naâman Guessous… Il n’y a qu’à voir à quelle vitesse s’envolent les Harry Potter, Le Seigneur des anneaux ou Jamais sans ma fille. Pendant que le dernier recueil de nouvelles de Ahmed Bouzfour n’a pas trouvé plus de 260 preneurs, en deux ans. Les jeunes lisent, mais sur un mode différent de celui qui fait de la lecture l’alpha et l’oméga de la formation intellectuelle. Pour eux, le livre n’est plus le temple du savoir et de la culture, et la lecture n’est pas non plus ressentie comme un besoin vital. Elle est désacralisée, démystifiée, considérée comme un acte ordinaire, qui fait partie d’un univers où cœxistent l’image, le son et l’écrit.
Aujourd’hui, on zappe autant qu’on lit. L’informatique, internet, obligent beaucoup à lire. Loin de la hiérarchie littéraire véhiculée par l’école. De préférence des bandes dessinées, jusqu’à l’adolescence. Ensuite des magazines. Quant aux «grands lecteurs», parmi les jeunes, ils jettent leur dévolu sur la science-fiction et le roman noir ; les filles, elles, privilégient les récits à l’eau de rose. Tous sont persuadés que la lecture n’est plus la seule voie de la connaissance et du plaisir. Donc, plutôt qu’à un désintérêt coupable envers la lecture, nous assistons à une mutation du modèle de lecture. Autres temps, autres mœurs
