Culture
L’art porté à bout de bras par les entreprises
Création de musées privés, restauration de merveilles architecturales,
soutien à des ouvrages somptueux, les fondations d’entreprises contribuent
de plus en plus au rayonnement de la culture au Maroc, compensant ainsi le désengagement
progressif de l’Etat.
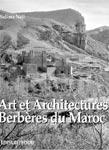
La parution d’un beau-livre abondamment illustré et minutieusement rédigé (Voyage du sultan Moulay Hassan au Tafilalet), la mise en lumière d’un art – la sculpture – outrageusement délaissé (Sculpture plurielle), ou encore l’exposition passionnante des œuvres d’un artiste singulier, Mustapha Boujemaâoui, sont les événements marquants de cette fin d’année culturellement profuse. Distincts, à première vue, ces événements ont en commun d’être l’émanation non pas d’organismes culturels mais de fondations d’entreprises. Opposant ainsi un démenti au credo qui tient que les deux mondes, celui des affaires, avec son appétit de profit, et celui de la culture, fondé sur la gratuité et le plaisir, sont inconciliables.
Banques et grosses entreprises restent les principaux mécènes
Reste que ce type de mécénat, c’est le mot qui convient, est loin de constituer une spécificité marocaine. Pratiqué depuis fort longtemps en Occident comme au Japon, il est devenu, si l’on ose dire, monnaie courante, en ces contrées. Pendant qu’au Maroc, en raison de son jeune âge, il est encore balbutiant. Rares sont les entreprises qui dédient leur argent aux activités de l’esprit. La protection de celles-ci, destinées forcément à une élite, sert moins l’image du mécène que les actions sociales, humanitaires ou écologiques. Aussi convient-il de mettre en exergue les entreprises qui, contre vents et marées, se consacrent au mécénat culturel.
A tout seigneur tout honneur : la Banque commerciale du Maroc (BCM). La préséance ici est historique. Dirigée par un esthète et un poète, Abdelaziz Alami, elle a été la première entreprise, souligne Farid Britel dans son ouvrage, Le mécénat au Maroc, à opter franchement pour une action culturelle. Dans une note de présentation éditée par la BCM, on peut lire : «A une époque où la culture est plus que jamais universelle, les entreprises ont une responsabilité morale, celle du développement culturel».
La BCM possède plus de 800 toiles et la SGMB ratisse large
Forte d’une collection picturale excèdant 800 toiles, c’est sur l’art que la BCM concentre son intérêt. Il donne tout son decorum à son siège ainsi qu’en s’en réjouit le critique d’art Khalil M’Rabet, dans Peinture et mécénat : «L’ensemble pictural de la BCM n’est pas cantonné dans un espace spécialisé et la présence, à tous les niveaux, de l’Art, frappe le visiteur du siège. La peinture épouse les lieux de travail ; elle ponctue et valorise l’espace de la banque, au point que plusieurs salles de réunion, de délibération s’appellent désormais salle Fatima Hassan ou Farid Belkahia, Houssein Miloudi, Hassan El Glaoui, Jacques Majorelle ou Alejandro Reino. Ces pièces sont des repères spatiaux qui contribuent à la répartition équilibrée d’autres œuvres de plus d’une soixantaine d’artistes, dans les bureaux, lieux de passage et de rencontre». Depuis la création de l’Espace Actua, la BCM ne se contente plus de faire veiller l’art sur les transactions prosaïques, elle le donne à voir au plus grand nombre, sous des aspects thématiques souvent délectables. Tel est le cas de Peintres étrangers au Maroc, Le Maroc dans le regard de l’Autre, La Méditerranée a du talent.
La Société générale marocaine de banques (SGMB) a, elle aussi, mis le cap sur la création esthétique. Naguère, elle se limitait à une prestation annuelle, la restriction étant toutefois compensée par la qualité et l’originalité. Qu’on se souvienne de Regards immortels, ce flamboyant hommage aux peintres qui ont tenu l’art marocain sur les fonts baptismaux, de Six artistes de Tétouan exposent, qui nous a permis d’admirer le talent foisonnant du Nord marocain, ou encore de «Peintres au féminin pluriel», exposition pétrie de grâce féconde. «La mémoire me tient à cœur. Et j’ai toujours veillé à ce que la banque que je dirige se préoccupe de la préservation du patrimoine marocain, qu’elle le soutienne et qu’elle l’enrichisse», affirmait Abdelaziz Tazi, président-directeur général de la SGMB. A juste raison. Le patrimoine recueilli par la banque n’est pas constitué des seules œuvres picturales. Il recèle aussi une estimable collection numismatique, un florilège de tapis et un grand nombre de poteries. Autant de somptueux trésors qui furent donnés en partage au public, par le truchement des expositions «Secrets des signes», «De terre et de feu», «De soie, d’or et d’argent.»
Les riches collections de la SGMB n’avaient pas de port d’attache. La construction d’un nouveau siège donna l’occasion à la banque de les arracher à cet inconfort, en leur aménageant un écrin digne de leur beauté. Depuis, les visiteurs peuvent les contempler à satiété. Sporadiquement, des expositions viennent meubler l’espace. Elles sont souvent de facture appréciable, pour ne pas dire exceptionnelle. Qu’on songe à «Figures», à «Graines de peintres», «Rétrospective Meki Megara», ou encore à «Sculpture plurielle».
Le patrimoine restauré grâce aux fondations d’entreprise
A Saïda Star Auto, on doit essentiellement la création du premier musée privé. C’est sur les ruines de Dar Menebhi, à Marrakech, qu’il fut planté. Sept millions de dirhams étaient nécessaires. La Fondation Omar Benjelloun mit la main à la poche. Et c’est ainsi que l’ancienne demeure délabrée se couvrit d’habits dignes de sa vocation, celle de centre artistique vivant, abritant à la fois les fabuleuses collections du patron de Saïda Star Auto et des expositions picturales d’envergure. Stimulé par cette expérience muséale heureuse, la Fondation Omar Benjelloun transforma deux villas jumelles, à Casablanca, bâtis dans le plus pur style art déco par les frères Sablon, puis tombées en décrépitude à force d’être désaffectées, en un musée, répondant au nom de Tourelles des arts. Mais médiocrement tenu, il n’attirait pas les foules et finit par fermer ses portes.
Toujours à Casablanca, sur le boulevard Roudani, une demeure art déco des années trente en impose par ses gracieuses colonnes, ses marbres de Carrare et ses ferronneries. C’est la Villa des Arts, que la Fondation ONA avait choisie, en juin 1999, comme musée, de préférence au Twin Center. «La perspective d’un petit espace que l’on pourrait agrandir au fil du temps était plus à mon goût», nous confie Sylvie Belhassan. C’est à cette ancienne galeriste qu’échoit la responsabilité du lieu. Un petit tour du propriétaire dans son village pour se rendre compte que les deux salles du rez-de-chaussée sont vouées aux expositions temporaires, tandis que l’étage abrite les pièces exposées en permanence. Elles proviennent de la collection de la Fondation. Près de sept cents œuvres représentant le paysage pictural marocain, des années cinquante à nos jours. Pas tout le paysage, convenons-en. Cherkaoui et Miloud brillent par leur absence ; idem pour les artistes emblématiques de la fameuse école de Casablanca. Pour autant, nul besoin de faire la fine bouche. Car il y a abondance. «Pour combler ces manques, nous devons poursuivre une politique d’achat sérieuse, c’est-à-dire impliquant un comité constitué notamment d’artistes, d’historiens de l’art, de galeries et d’intellectuels», souhaitait Sylvie Belhassan lors de l’ouverture du musée. Vœu inexaucé, en raison de coupes sombres dans le budget. En revanche, la Villa des Arts continue d’honorer vaillamment tous ses engagements : exhiber les diverses facettes de l’art marocain ; établir le dialogue entre les artistes et les visiteurs ; montrer ce qui se fait sous d’autres cieux ; sensibiliser la jeunesse à la chose artistique.
La restauration du patrimoine est l’autre centre d’intérêt du mécénat culturel. Sur ce plan, la Fondation ONA fit œuvre première, en remettant à neuf un monument almohade du XIIe siècle: la Mosquée de Tinmel. «Jamais, fût-ce aux plus magnifiques sanctuaires, on n’avait vu tant d’impeccable logique, tant de clarté. Timmel est parfait», s’émerveillait l’historien français Henri Terrasse. Il eût été malheureux qu’un tel joyau fût enseveli sous le sable de la mémoire. L’ONA le sauva de ce sort fatal. Après quatre années de coûteux travaux, il peut être admiré dans l’état où il se trouvait il y a huit siècles. Un autre superbe pan du patrimoine s’effritait, le Fondouk Nejjarine, à Fès. Construit au XVIIIe siècle pour abriter les marchandises précieuses du makhzen et des riches négociants, ce magnifique édifice arborait les indélébiles cicatrices du temps. La Fondation Mohamed Karim Amrani lui rendit jouvence, pour un coût de 23 millions de dirhams. A Marrakech, la médersa Ben Youssef, la Qobba almoravide et la place Ben Youssef, vouées à une mort certaine, reprirent vie grâce à la Fondation Omar Benjelloun.
La BMCI se démarque : beaux livres et musique classique
Ajoutant à la sinistrose qui embrume le paysage éditorial, les entreprises ne semblent pas attacher une grande importance au livre. A cet égard, la BMCI fait figure d’heureuse exception. Coup sur coup, quatre beaux-livres ont pu voir le jour par ses soins substantiellement pécuniaires : le nostalgique Casablanca, portrait d’une ville, de Jean-Michel Zurflüh; l’historique Casablanca et la France, de Jean-Luc Pierre; l’éblouissant Art et Architectures berbères du Maroc, de Salima Naji, et l’érudit Voyage du sultan Moulay Hassan au Tafilalet.
Non seulement la BMCI aime le livre, mais elle apprécie également la musique. Quand, il y a huit ans, le musicien Farid Bensaïd créa l’Orchestre philharmonique du Maroc, personne n’osait miser un bouton de guêtre sur le destin de cet ensemble. D’entrée de jeu, il a failli sombrer, sans le concours sonnant et trébuchant de la BMCI. Elle ne s’arrêta pas là. A l’automne 2000, Farid Bensaïd lança l’Ecole internationale de musique de Casablanca. Il lui fallait pas moins de 5 MDH.
Sollicitée, la BMCI apporta volontiers son écot.
Le mécénat d’entreprise est pain bénit pour notre culture. Il compense perceptiblement le désengagement graduel de l’Etat. Mais savez-vous que le terme «fondation» n’est pas, au Maroc, défini juridiquement, et de fait, ne se trouve pas protégé ?
