Culture
Abdallah Laroui entre philosophie et histoire
Vient de paraître aux Editions La Croisée des Chemins, «Philosophie et histoire», dernier essai de l’historien et essayiste Abdallah Laroui. L’ouvrage traite de l’éternelle dualité entre la philosophie et l’histoire, dans le but de démontrer la pertinence de l’historicisme. L’auteur y a recours au retour sur soi et à l’uchronie pour asseoir sa thèse.
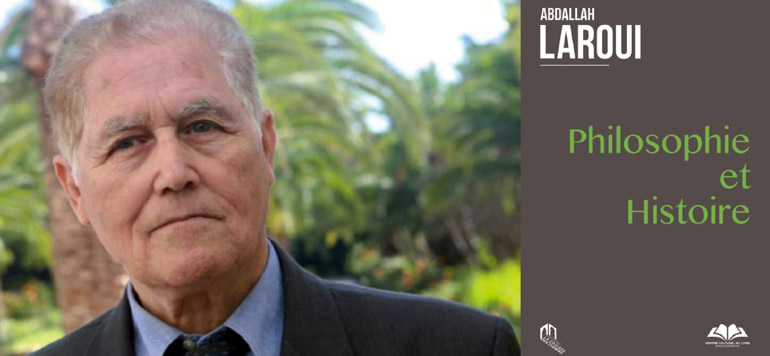
La pensée est-elle une entité libre, ou est-elle déterminée par le fait historique ? Serait-ce l’esprit humain qui oriente l’histoire, ou le contexte historique qui en détermine les idées ? A ces questions, le philosophe, glorifiant la raison et méprisant l’histoire, s’indignera ouvertement, rejetant l’influence du lieu et du moment sur la pensée. Car, pour lui, reconnaître ce relativisme reviendrait à abdiquer au fatalisme de l’historien, qu’il perçoit comme défaitisme. L’historien essaiera, quant à lui, de théoriser la cyclicité de l’histoire, afin d’en démontrer l’impact sur l’action et/ou la réflexion humaine que le philosophe croit transcendante.
Il va sans dire qu’Abdallah Laroui se range du côté de l’histoire, non par loyauté pour sa spécialité ou par aversion pour la philosophie, mais par le simple exercice de la logique. Il y va moyennant des exemples réels et réalistes, tirés de l’histoire occidentale ainsi que du reste du monde, en focalisant sur celle du monde arabe.
Le mot de l’histoire
Si la pensée n’est en rien liée au contexte historique dans lequel elle naît, c’est que l’être humain est constamment frappé d’amnésie. C’est en mots simples ce qui ressort du livre Philosophie et histoire qui affirme que «l’historicisme constate, souligne, théorise ce fait réel et évident que depuis que l’homme est né à l’histoire,… il s’est constamment mis à l’école de l’histoire, pas celle de la morale, de la religion ou de la philosophie, sauf quand celle-ci descend sur terre et devient justement historiciste», explique l’auteur.
Abdallah Laroui appuie sa thèse en se basant, entre autres, sur ses travaux sur le nationalisme arabe et marocain en particulier. En effet, à l’aube de l’Indépendance, les nationalistes se sont tournés vers des modèles de sociétés qui dégageaient la même dynamique que la leur, en s’éloignant du modèle du Protectorat. Car créer un nouveau modèle demande un temps dont le réformiste ne dispose pas… Mais ce n’est là qu’un seul exemple parmi la pléthore dont regorge le livre.
Pour contrer les allégations de défaitisme assénées par les philosophes, Abdallah Laroui assure que «l’historicisme est une forme de réalisme et celui-ci est une découverte progressive, une acquisition lente, un apprentissage ardu. Il peut être ressenti comme un défaitisme, mais uniquement dans le cadre de l’inaction, du pessimisme généralisé, du désespoir fataliste».
Ce qui aurait été
Qu’aurait été la pensée de Laroui, s’il avait embrassé la philosophie au lieu de se dédier à l’histoire ? Tout au long du livre, l’auteur prend exemple sur son vécu, en essayant d’imaginer ce qu’une orientation différente aurait pu avoir comme conséquence sur sa pensée. Il procède alors à une analyse rationnelle des alternatives qui se présentaient à lui à l’époque.
On découvre déjà toutes les circonstances «historiques» qui ont dirigé Abdallah Laroui vers l’histoire plutôt que vers la philosophie. Circonstances purement politiques, puisqu’à la fin du Protectorat, le jeune Laroui ne pouvait plus convoiter l’Ecole normale d’administration. Il ne peut ensuite prétendre à l’agrégation en histoire en raison de sa méconnaissance du latin, raison pour laquelle il se tourne vers la langue arabe.
Il s’emploie à étaler toutes les possibilités qui s’offraient à lui à l’époque, qui ne lui laissaient d’ailleurs pas beaucoup le choix de l’érudition dans la France d’alors. On entrevoit dans cet exercice ce qu’aurait été la nature de sa réflexion aujourd’hui si les circonstances «historiques» étaient différentes. Ce recours à l’uchronie, tout en étant à but démonstratif, a quelque chose d’émouvant, n’en déplaise au grand rationalisme de l’auteur.
