Idées
Vraies et fausses classes moyennes
Le paysage qui ressort des chiffres des nomenclatures de la statistique est plus complexe que certains veulent bien le laisser penser. Passer du critère de la dépense ou des revenus à la nomenclature des catégories socioprofessionnelles reste un exercice périlleux :
les critères de la statistique divergent de ceux
de l’analyse sociologique.
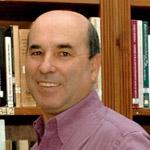
On a fini par les trouver, ces classes moyennes ! En fait, ce n’était pas si complexe de les débusquer dans cette nébuleuse sociale. Il fallait tout juste tracer une médiane dans ce maquis de la statistique des dépenses des ménages et définir des bornes en multiple de cette médiane. Oui des bornes : 0,75 en bas et 2,25 en haut. Le résultat est impressionnant : 53% de la population appartiennent désormais à cette catégorie si courtisée, si fuyante. C’est du volume, de l’épaisseur. On est bien loin de cette représentation restrictive des «classes moyennes» inventées par certains médias. En termes de dépense, il suffit de disposer d’un revenu moyen mensuel de 2 800 dirhams par ménage, soit 540 dirhams par personne, et vous pouvez considérer que vous faites partie de cet univers social convoité par plus d’un. Le ticket d’entrée n’est pas cher. Encore un effort et les pauvres sortiront de leur trappe de pauvreté. Notre pyramide sociale semble avoir bien changé. Elle serait devenue un modèle de société en montgolfière où la base des classes populaires serait restreinte, les classes moyennes plus importantes et la classe aisée serait une minorité. Ceux qui spéculaient sur la paupérisation des classes au Maroc en ont eu pour leur verbiage idéologique. La statistique, arme de l’objectivité des temps modernes, s’est prononcée. Vous pouvez vous déclarer membre de cette catégorie, mais avec une capacité de dépense moindre, la statistique vous ramènera sans état d’âme à votre appartenance sociale. Question de borne à ne pas dépasser. Oui, mais si on déplaçait ces bornes, surtout l’inférieure, juste pour bousculer cette photographie par trop iconoclaste. Si on s’amusait à ce petit jeu, il nous réserverait bien des surprises : les classes moyennes ne fonderaient pas comme neige mais leur corpulence serait bien amaigrie.
Les chiffres, en fait, ne suffisent pas à faire une catégorie. Science des grands nombres, la statistique doit, cette fois-ci, chausser d’autres lunettes ou inviter d’autres sciences à la table d’analyse. Les mutations sociales bousculent le réductionnisme quantitatif et conduisent les sciences sociales à forger de nouveaux outils. Il est certain que toute tentative de regroupement d’individus, selon un nombre limité de critères, est par définition réductrice. Il faudrait, par exemple, tenir compte également de facteurs géographiques : on ne vit pas de la même façon, à la campagne et en ville. Le type des responsabilités exercées, le genre de vie, le milieu introduisent des différences autrement importantes. Ce sont elles qui fondent le statut de l’individu, dans la société économique. Pourtant, sauf à s’empêcher toute synthèse, il est nécessaire d’utiliser un nombre limité d’indicateurs ou de catégories. La direction de la Statistique s’y est essayée en «positionnant» ces classes moyennes hétérogènes dans le schéma de classification sociale. On découvre, entre autres, que 40,2% des exploitants agricoles font partie des classes moyennes. A rapprocher des données du recensement agricole qui révèlent que 75% des exploitants ont une superficie inférieure à 2,5 hectares ! Le paysage qui ressort des chiffres des nomenclatures de la statistique est plus complexe que certains veulent bien le laisser penser. Passer du critère de la dépense ou des revenus à la nomenclature des catégories socioprofessionnelles reste un exercice périlleux : les critères de la statistique divergent de ceux de l’analyse sociologique. Un travail de reclassement est nécessaire. Ceci est d’autant plus vrai que les classes moyennes recrutent dans plusieurs des CSP de la direction de la Statistique. On peut remarquer à ce propos que l’on ne parle pas d’une classe moyenne, mais des classes moyennes. On y trouve pêle-mêle, confondus par les chiffres, l’ingénieur travailleur et efficace, l’ouvrier ou l’employé, que les efforts et les dons intellectuels ont hissé jusqu’à cette barre des «53 %». Orgueil de ses parents, il se donne lui-même en exemple à ses enfants. Le «commercial» qui a bien réussi, et décroché la responsabilité d’un produit ou d’un service, au bout d’un combat quotidien et répété. Le comptable entré depuis trente ans dans l’entreprise, avec plus de méthode que de diplômes, et qui s’est imposé à la longue comme chef des services comptables. L’économiste bardé de peaux d’ânes, au contraire, qui ne vit pas beaucoup la vie de l’entreprise mais dont les notes brillantes sont appréciées de la direction générale.
Le haut fonctionnaire des finances ou d’ailleurs qui a jugé préférable de «pantoufler» à mi-parcours pour améliorer son niveau de vie, par le prix de son niveau de relations. L’homme jeune et sympathique -pourquoi pas ?- honnêtement diplômé et doué, mais sans plus. Et qui a épousé la fille du principal actionnaire. Vous voyez ! Dès que l’on veut affiner l’étude des classes moyennes, tout se corse. Leur véritable contour est difficile à tracer. Si elles apparaissent comme un phénomène central des sociétés avancées, chez nous, elles se présentent davantage comme une nébuleuse que comme un ensemble structuré. Il y a donc un bon bout de chemin à faire avant de conclure à l’existence de classes moyennes majoritaires, tendant à grignoter les autres. La direction de la Statistique ouvrira-t-elle ses boîtes aux chercheurs pour y voir un peu plus clair ?
