Idées
Vivre ensemble
L’Europe a continué de ranger l’immigration dans les questions sécuritaires en tentant d’associer à cette tà¢che ses voisins du Sud. Tout cela atteste de la grande hypocrisie de la politique européenne d’immigration.
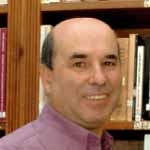
Le dramatique naufrage des migrants au large de la Libye pose de nouveau le sempiternel problème de l’immigration clandestine. Lampedusa n’a rien changé au décor. Pourtant, l’Europe, déjà émue, semblait vouloir prendre à bras le corps le problème. Aujourd’hui, l’UE annonce une série de mesures pour contrecarrer ces flux irréguliers: frappes pour détruire les bateaux des trafiquants ; renforcement des moyens alloués à Frontex, l’agence chargée de la surveillance des frontières ; relance des programmes de «réinstallation» des personnes ayant déjà obtenu le statut de réfugié ; «relocalisation» provisoire dans d’autres pays européens d’une partie des migrants débarqués en Italie, à Malte et en Grèce ; instauration d’un programme de «retours rapides» des migrants irréguliers, nouveaux accords avec les pays voisins de la Libye… Ces mesures d’urgence ne peuvent constituer une politique de gestion à long terme des flux migratoires. Un demi-million de migrants pourrait tenter chaque année de gagner l’Europe dans des conditions inhumaines. Ils sont essentiellement originaires d’Afrique subsaharienne. Depuis quelques années, ils sont rejoints par des milliers d’autres, en provenance du Moyen-Orient, ravagés par les guerres. La plupart embarquent en Libye, en plein chaos. Le risque est grand de voir se multiplier ces drames humains.
L’immigration est vécue comme un traumatisme dans la plupart des pays européens ; une «invasion de pauvres» venant s’installer dans une Europe impuissante à protéger ses frontières. Pourtant, pour compenser son déficit démographique, l’Union européenne va devoir ouvrir ses frontières à une forte immigration. Il faut donc changer de perspective et trouver des solutions pour que la population européenne puisse vivre de façon plus harmonieuse avec une population étrangère.
Le Livre vert européen sur la gestion de l’immigration de janvier 2005 a mis fin à l’objectif d’«immigration zéro» lancé en 1993 et entrouvert les frontières en fonction des besoins de main-d’œuvre. La réponse des pays européens s’est matérialisée dans l’approche de la migration temporaire, qualifiée de «circulaire» et sélective avec des mesures de lutte contre l’immigration illégale, la hiérarchisation des droits des migrants selon les secteurs d’activité ou la qualification, les incitations au retour pour les travailleurs temporaires. Les réponses vont des permis à points («green card» en Allemagne) aux accords bilatéraux de main-d’œuvre (Italie, Espagne, Portugal) en passant par l’immigration «choisie» pour la France. En Europe du Sud, le système des quotas pour introduire des migrants aux permis à court terme, a été d’ampleur réduite et de peu d’effet.
L’Europe a donc été contrainte de revoir les approches restrictives de l’immigration, pour faire face à l’accroissement des flux irréguliers. Tout en reconnaissant que les décisions d’admission de migrants relèvent de la responsabilité des États membres, la Commission a appelé à des règles et critères d’admission communs. Les accords de Partenariat pour la mobilité négociés avec des pays émetteurs postulaient à une meilleure gestion de la circulation des personnes pour des séjours de courte durée, la lutte contre les réseaux de trafic des êtres humains et la promotion d’une politique en matière de retour et de réadmission. Ces accords ont offert une solution aux pénuries d’emploi dans des catégories limitées sans pour autant constituer une politique à long terme de l’immigration. L’Europe a continué de ranger l’immigration dans les questions sécuritaires en tentant d’associer à cette tâche ses voisins du Sud. Tout cela atteste de la grande hypocrisie de la politique européenne d’immigration. Construire des murs ou accroître les patrouilles aux abords de l’Europe ne résout pas le problème.
Les réponses européennes à la question de l’immigration sont frileuses. Elles s’inspirent moins des ruptures que des continuités (approche sécuritaire, dépendance à l’égard de l’opinion publique..). Car l’Europe ne s’est jamais pensée comme un continent d’immigration. Elle a longtemps été, dans le passé, une terre d’émigration et de conquêtes : il suffit d’évoquer les croisades, les grandes découvertes, la colonisation, les missions religieuses, etc. Aussi peine-t-elle à penser son identité comme évolutive, en tenant compte des migrations comme l’a fait le Nouveau monde (États-Unis, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande). Sa définition de l’identité est celle d’une identité construite sur des valeurs communes définies à l’avance et à laquelle les nouveaux arrivants doivent se conformer.
Il est temps de définir, à l’échelon européen, un modèle et des instruments du «vivre-ensemble» plutôt que de consacrer autant d’énergie à la maîtrise des frontières, qui ne trouvera pas de solutions tant que les inégalités dans le monde resteront ce qu’elles sont. L’immigration va se poursuivre, compte tenu des déséquilibres du monde, des transformations démographiques qui s’y jouent et de la très grande inégalité de la répartition des richesses. L’immigration est un atout à saisir pour l’Europe et non un fardeau. La solution consiste à remplacer une attitude défensive où l’immigration est rangée dans le registre de la sécurité par une attitude volontariste à l’égard de la mobilité. La condition est de changer d’approche et d’échelle: une politique d’immigration plus ouverte et plus transparente considérée comme un bien public régional à défendre, à accompagner et à sécuriser pour assurer des retombées positives dans les régions de départ et d’accueil. Chaque Etat, pris isolément, n’est pas en mesure de faire face, seul, à l’enjeu régionalisé de l’immigration.
L’européanisation des politiques d’entrée, d’accueil et d’asile s’impose pour assurer plus de cohérence aux dispositifs communautaires. Il en est de même de la révision des accords de partenariats avec les pays d’origine et de transit afin de mieux réguler les flux d’immigration et favoriser le développement dans les pays concernés.
