Idées
Un débat à bas débit
Le système éducatif marocain et sa faillite sont au centre d’un débat plutôt timoré pour ne pas dire confidentiel ( un débat à bas débit, en quelque sorte)…
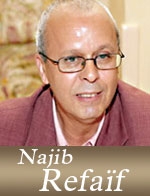
Le système éducatif marocain et sa faillite sont au centre d’un débat plutôt timoré pour ne pas dire confidentiel ( un débat à bas débit, en quelque sorte), même si, et depuis peu, la société civile s’en est emparé afin de mieux communiquer sur le caractère urgent des réformes à entreprendre et alerter sur les lourdes conséquences des atermoiements et de l’attentisme des véritables acteurs du changement. Mais si les uns veulent d’emblée jeter le pavé dans la mare et entamer le débat par les sujets qui fâchent, d’autres, pour des raisons politiques, idéologiques ou autres, anticipent déjà sur ces sujets et avancent leurs arguments sur l’échiquier. Le premier sujet qui fâche est, pourquoi le cacher, celui de la langue d’enseignement. Il est tout à fait primordial de commencer par celui-ci si l’on ne veut pas tourner autour du pot afin de noyer le débat dans les discussions byzantines et sur le sexe des anges. En effet, on ne voit pas comment on peut escamoter la question de la langue lorsqu’on veut réformer un système éducatif quels que soient le pays, la langue, le dialecte ou les langues en usage. Car au-delà du contenu de l’enseignement, des programmes, des méthodes , de la formation et des moyens alloués à ce secteur, la langue, en tant que vecteur de transmission des savoirs et des connaissances, demeure au Maroc le facteur essentiel dans cette équation à plusieurs inconnues.
Inconnue, la langue de l’enseignement l’a toujours été jusqu’au début des années 70 mais ne semblait guère poser de réels problèmes. L’enseignement public se faisait en arabe dit classique ou fos’ha (mais qui est en fait un arabe standard moderne) et le français. L’anglais comme troisième langue étant enseignée, mais insuffisamment, deux années avant le bac. Mais si l’on reconnaissait la troisième langue, on ne savait pas quelle était la première. Le nombre d’heures était, selon les filières, presque identique. On était dans un bilinguisme quasi parfait, et, disait-on, bien plus réussi que celui d’un écolier belge ou québécois. Mais c’était hier et l’on dirait il y a un siècle. Les collèges et les lycées de la Mission française étaient gratuits mais nous n’avions aucune envie de nous y inscrire. Mieux encore, certains établissements faisaient du pied à des élèves marocains de milieux modestes afin de mettre un peu de «couleurs autochtones» et de parité dans les classes, entre un Martinez, un Martin, un Bensimon et un Benchekroun. Les élèves de cet enseignement public qu’on disait de «type marocain» tenaient même la dragée haute à leur vis-à-vis du «type français» dans moult matières, y compris le français, tout en maîtrisant la langue arabe fos’ha, et bien sûr cette fameuse darija dont tout le monde se gargarise et que l’on vante comme la panacée à tous les maux de l’enseignement au Maroc.
Curieusement, chaque fois que l’on met le sujet de l’enseignement ou de la culture sur la table, le mot qui surgit en premier est celui de darija. Bien entendu, l’argument massue qu’on appelle à la rescousse est celui de sa légitimé, voire de sa primauté en tant que langue maternelle. Pour d’autres, en plus d’être la langue d’al walida (comme le couscous du même nom), c’est la langue du plus grand nombre. C’est-à-dire la langue de la foule ? On pourrait entendre un tel argument lorsqu’il s’agit de faire de l’audience à la télévision et que l’on discute le concept d’une émission populaire. Mais n’est-il pas, pour le moins, prématuré de proposer un enseignement en darija ? Comme disait, déjà au XVIIIe siècle, le philosophe allemand Georg Christoph Lichtenberg : «Le perroquet ne fait jamais que parler sa langue maternelle». Certes, les experts en linguistique ou ceux qui s’en mêlent préconisent cet enseignement seulement dans le préscolaire. C’est par exemple ce que conseille Alain Bentolila, professeur de linguistique à l’Université Descartes à Paris, qui a déclaré à un quotidien national : «Il faut d’abord donner une base solide à l’enfant dans sa langue maternelle et après lui permettre d’appliquer ce qu’il a appris pour d’autres langues». Fort bien, mais alors en quoi la langue maternelle, la darija, permettra à l’apprenant d’enrichir ses connaissances pour les appliquer à d’autres langues. Et lesquelles ? L’arabe, dit classique ? Le français ? L’anglais ? Par ailleurs, de quels outils pédagogiques modernes, manuels scolaires, dictionnaires et autres ouvrages usuels dispose-t-on pour prodiguer des connaissances en darija ? Le seul dictionnaire digne de ce nom est celui de Georges Collin, professeur de l’«arabe maghrébin» et de la dialectologie à l’Ecole des Langues orientales de Paris dans les années 20. Il avait élaboré un immense glossaire éparpillé et non achevé qui va donner naissance au premier et unique «Dictionnaire d’arabe dialectal marocain». Cet ouvrage a pu voir le jour grâce aux efforts du regretté Ahmed Lakhdar Ghazal et à l’entêtement et l’abnégation de Mme Zakia Iraqui Sinaceur de l’Institut d’études et de recherches pour l’arabisation de Rabat qui l’a publié aux éditions Al Manahil du ministère des affaires culturelles en 1993.
Aimer et parler sa langue maternelle est un devoir sinon une nécessité. Au Maroc, la langue maternelle est celle que l’on parle chez soi ou dans la rue. En plus du dialecte arabe marocain avec ses variances régionales, il y a l’amazigh dans ses trois déclinaisons, le hassani et un sabir que certains parents, plus ou moins scolarisés en français, utilisent à la maison et ailleurs. Allez donc vous retrouver dans cette tour de Babel. Au point où l’on serait tenté de dire, comme un certain Ulises Drago (qui aurait inventé une langue incompréhensible que lui seul parlait à Babel ) : «La langue maternelle n’existe pas. Nous naissons dans une langue inconnue. Le reste est une lente traduction».
