Idées
Splendeur et misère de l’industrie
il est indéniable que, dans son ensemble, l’industrie marocaine se porte mal pour l’instant. Et que sa situation, déjà difficile avant la crise, s’est fortement dégradée depuis : l’emploi a fondu, les marges se réduisent, les équipements ne sont plus suffisamment renouvelés…
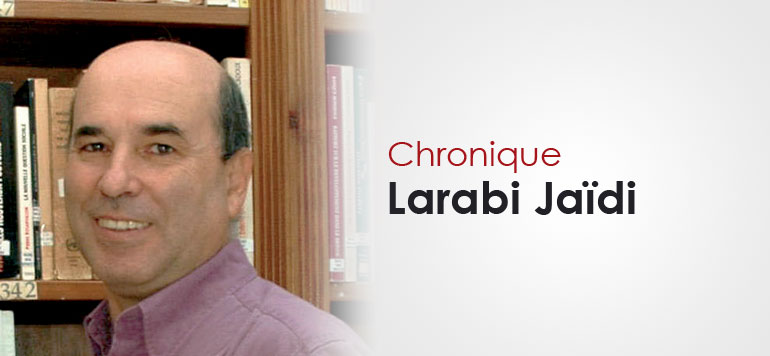
Renault, Peugeot, Bombardier… et la liste peut être plus longue : des grands groupes internationaux choisissent le Maroc pour délocaliser des pans de leur chaîne de valeur dans une mappemonde industrielle où la compétition est rude. Les exemples ne manquent pas, tant dans les secteurs de haute technologie qualifiés de «métiers mondiaux», pour montrer que le Maroc n’est pas inévitablement voué à rester agricole ou à devenir une économie de services. Mais quelques hirondelles ne peuvent à elles seules faire le printemps. Derrière ces champions mondiaux qui réalisent 70 à 80 % de leurs résultats à l’étranger, se cache une myriade de PMI qui, pour de multiples raisons, dégagent des marges trop faibles pour investir, innover, grandir et conquérir de nouveaux marchés, notamment à l’export, et qui sont de ce fait les premières victimes des crises qui ébranlent nos économies. Des PMI qui sont majoritairement positionnées sur les activités de basse et moyenne valeur ajoutée. L’industrie marocaine n’a pas encore pris son envol. Elle ne décolle pas de ses 18-19 % de la valeur ajoutée. Elle ne génère pas plus d’emplois par an, elle en perd même. La balance commerciale des produits manufacturés enchaîne des déficits qui s’aggravent d’année en année. Quelle explication à ce contraste de splendeur et de misère de l’industrie nationale ?
Les facteurs qui expliquent les quelques percées dans certains métiers mondiaux sont très variés, mais ils montrent tous que le pays dispose, en réalité, d’atouts significatifs, qu’il s’agisse de la qualité de ses infrastructures, ou encore du coût de sa main-d’œuvre. La politique des écosystèmes industriels symbolise l’affermissement d’une politique industrielle ambitieuse pour le Maroc inaugurée voici une quinzaine d’années par le Plan émergence. A l’image des clusters (grappes), les écosystèmes sont une combinaison d’entreprises et d’institutions publiques et privées engagées sur une filière autour de projets communs. L’objectif de ce dispositif est de créer une dynamique par un mode d’organisation industriel coopératif dont les vertus ont été mises à l’épreuve par des économies avancées ou émergentes. Une pléiade d’acteurs publics et privés ont adhéré à une dynamique collaborative portée par des conventions entre partenaires sur des axes stratégiques: compensation industrielle, logistique, foncier, compétitivité, amélioration du climat d’affaires, promotion des exportations… La contractualisation a fédéré les adhérents autour d’objectifs partagés. Si elle fait consensus, la dynamique de mise en œuvre reste cependant difficile. L’évaluation des premières phases de la politique des écosystèmes devrait se faire lors des prochaines assises de l’industrie.
Ceci étant, il est indéniable que, dans son ensemble, l’industrie marocaine se porte mal pour l’instant. Et que sa situation, déjà difficile avant la crise, s’est fortement dégradée depuis : l’emploi a fondu, les marges se réduisent, les équipements ne sont plus suffisamment renouvelés… Dans beaucoup de régions et de secteurs d’activité (textiles, agroalimentaire, chimie), le risque est grand qu’un seuil soit franchi qui enclenche un processus de la désindustrialisation prématuré. L’industrie marocaine souffre d’abord de déficits importants du côté de ce qu’on appelle la compétitivité hors-coût : la capacité à mettre sur le marché des produits innovants et de qualité, qui justifient des prix plus élevés que les concurrents. Le diagnostic est fait depuis longtemps et des actions ont été lancées: incitation à l’investissement, à l’amélioration de la productivité, à l’innovation… Mais ce type d’action ne peut avoir d’effets qu’à moyen terme, et encore, à condition qu’elles soient menées avec suffisamment de constance, ce qui n’est pas toujours le cas. Mais il n’y a pas de fatalité au déclin des industries «traditionnelles». Certaines entreprises parviennent à tirer leur épingle du jeu. La règle est l’adaptation au marché.
Dans le panorama désolant de fermetures d’entreprises, il ne faudrait pas conclure trop rapidement que les conditions ne sont plus réunies pour un sursaut de ces secteurs «traditionnels». D’abord parce que la politique des écosystèmes peut être favorable à un tel rebond. Ensuite, les freins qui inhibent la croissance des petites et moyennes entreprises peuvent être levés. Ce n’est pas le coût du travail qui est l’obstacle majeur à leur développement. Une large palette d’aides et d’instruments est aussi mise en place par l’Etat à leur intention : aides à l’exportation, foncier aménagé, formation… En revanche, le financement continue de poser problème pour les PME. Qu’il s’agisse de prêts bancaires à court terme, destinés à financer leur trésorerie, ou de fonds propres pour leur permettre de se développer. Mobiliser l’épargne à des usages productifs reste le véritable enjeu dans ce domaine. L’instabilité de l’environnement fiscal est par ailleurs souvent déplorée par les entreprises, et il reste un long chemin à faire pour atteindre une véritable équité sur ce plan entre PME et grands groupes experts en optimisation fiscale. Dernier défi et non des moindres : l’âge des capitaines de l’industrie. Les dirigeants des PME vieillissent. Faciliter et accélérer les transmissions d’entreprises sont donc des enjeux majeurs, tant pour la pérennité de leurs emplois que pour la dynamique de l’économie. Les PME dont le dirigeant vieillit ont en effet tendance à ne plus investir. Alors que cet investissement est la véritable clé du redressement productif.
