Idées
Sens et contresens des programmes électoraux
L’électeur moyen est intimement convaincu que les partis s’engagent à faire des centaines de choses… mais ne tiennent pas leurs engagements. Il est vrai, par ailleurs, que le registre de l’évaluation n’est pas dans la culture des partis.
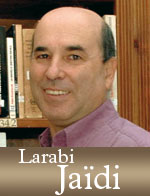
En cette phase de campagne électorale, beaucoup d’électeurs se demandent à quoi exactement servent les programmes des partis, ces documents en général interminables, ennuyeux et compliqués qui contiennent des orientations, justifications, mesures et promesses politiques. A part quelques passionnés de la politique et les journalistes et commentateurs qui doivent en parler, sans doute une partie infinitésimale seulement des électeurs vont les lire. Qui, même parmi ceux qui vont voter islamiste, socialiste, istiqlalien, ou alliance pour la démocratie a-t-il feuilleté un exemplaire de ces programmes? La réaction de l’électeur moyen qui jette ce document que lui tend un militant n’est peut-être pas compréhensible. Mais, l’électeur moyen est intimement convaincu que les partis s’engagent à faire des centaines de choses….mais ne tiennent pas leurs engagements. Il est vrai que le registre de l’évaluation n’est pas dans la culture des partis. Sinon comment expliquer le peu d’entrain à rendre compte à l’opinion de l’état de réalisation des programmes des campagnes précédentes ? D’autre part, les préoccupations des électeurs sont tellement basiques qu’il leur est difficile de juger s’il est préférable de mieux utiliser les ressources disponibles pour améliorer leur bien-être, comme le suggère tel parti, ou s’il ne vaudrait pas mieux instaurer plus d’impôt, comme le suggère tel autre. L’électeur moyen semble convaincu par ailleurs que toutes ces promesses sont autant d’hameçons pour accrocher son vote et qu’il passera beaucoup d’eau sous les ponts avant qu’elles ne soient réalisées, si elles le sont jamais. Sans doute, aux yeux du citoyen, la meilleure illustration de la «futilité» des programmes électoraux vient-elle, dans son esprit, de ce faux débat sur le taux de croissance prévu dans les programmes des uns et des autres : 5% pour être pragmatique et réaliste chez les uns, 7% chez ceux qui veulent vendre du rêve et croire en une mobilisation de ressources qui brise les contraintes de la crise internationale et met le Maroc sur ce sentier inoxydable d’une croissance en or. L’autre illustration non moins futile est celle la création d’emplois projetés sur la législature : 150 000 par an pour les uns, 200 000 pour les autres….Belles promesses, mais on ne précise pas du tout la nature des emplois créés : sont-ils des créations nettes ou brutes ? Publics ou privés ? Quelle part d’informalité prévoit-on dans les emplois créés ? Quelles sont les activités locomotives génératrices d’offres d’emplois ? Autant de questions qui ne trouvent point de référence dans les programmes électoraux.
La question du chiffrage se complique encore plus quand il s’agit d’évaluer correctement l’impact financier d’une mesure sociale ou fiscale. Il y a évidemment des mesures dont le chiffrage ne rencontre aucune difficulté majeure ; elles sont en fait peu nombreuses. La plupart des mesures sont non chiffrables parce que l’exercice est rendu très compliqué par l’insuffisance d’informations précises et fiables sur leur contenu. Si c’est une mesure fiscale, il est besoin de disposer de l’assiette fiscale de prendre en compte les coûts ou les gains non seulement pour le Budget de l’Etat, mais aussi pour les foyers fiscaux ou les organismes et institutions impliqués. Des hypothèses doivent être prises pour établir des estimations fiables. La pertinence de ces hypothèses est aussi importante que le chiffrage qui en résulte.
Alors faut-il accorder une importance au chiffrage des programmes ? Il faut admettre que le chiffrage est une approche plus comptable qu’économique ou politique et que les choix de société sont irréductibles à la seule rationalité des chiffres. Dans certains cas, les propositions n’ont pas ou peu d’impact financier ou ces impacts sont diffus et/ou difficiles à apprécier. S’il est toujours souhaitable d’estimer le coût ou le gain financier des différentes propositions électorales, il est encore plus important de restituer les arguments en faveur ou en défaveur des propositions, de relever leurs impacts à long terme pour l’économie, de les compléter par un éclairage qualitatif sur les choix de société.
Sur ce plan, certains se réjouissent des bienfaits du «consensus» des partis sur les grandes questions de société : l’école, la santé, la dignité du citoyen….. Ils ont tort. D’abord parce que la démocratie, ce n’est pas l’unanimité requise sur l’urgence des traitements de ces questions, mais le débat sur les réponses à ces préoccupations, les visions, les principes et les moyens qui en déterminent les issues. Mais si le consensus fait disparaître le débat lui-même, alors la démocratie disparaît du même coup, parce qu’elle implique par définition, sinon la pluralité des partis, du moins la diversité des opinions et des choix, en même temps que la reconnaissance de la légitimité d’un affrontement entre ces opinions et ces choix. Or, si les partis ne sont plus séparés que par des différences programmatiques insignifiantes, un point de PIB ou un chiffrage de l’emploi, si les factions concurrentes mettent en œuvre fondamentalement les mêmes politiques, si les unes comme les autres ne se distinguent plus ni sur des projets de société ni même sur les moyens de les atteindre, bref, si les citoyens ne se voient plus présenter d’alternatives réelles et de véritables possibilités de choix, alors le débat n’a plus de raison d’être et le cadre institutionnel qui lui permettait d’avoir lieu n’est plus qu’une coquille vide dont on ne peut s’étonner de voir une majorité d’électeurs se détourner.
