Idées
Religion et développement
Nous avons besoin de jeter les bases d’une éthologie comparée du développement économique, social, culturel et politique. Ethologie, c’est-à -dire étude des comportements des différentes communautés humaines, dans la mesure où ils fournissent des facteurs d’activation ou d’inhibition en matière d’échanges, de mobilité intellectuelle et géographique, d’innovation…
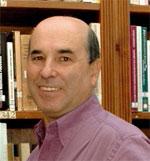
Ces derniers temps, le lien entre religion et développement économique commence à s’imposer dans le débat public. Jusqu’ici, les économistes avaient délaissé ce champ de réflexion. C’est une bonne chose qu’ils l’investissent. La religion est trop sérieuse pour ne la laisser qu’aux doctes connaisseurs de la chose religieuse.
Mais de grâce, ne parlons pas d’économie islamique, de finances islamiques, de produits économiques halal…, autant d’appellations qui laissent penser que les lois économiques, les prescriptions économiques trouvent leur source d’inspiration dans le référentiel religieux. Pourquoi dans ce cas ne parlerait-on pas d’économie chrétienne, juive, confucéenne ou bouddhiste… ?
Dans les paradigmes économiques dominants, les ressources-matières premières, capitaux, main-d’œuvre… – ont été jusqu’ici placées au centre des explications du développement. L’Angleterre s’est industrialisée avant la France et plus qu’elle. Pourquoi ? La houille a fait toute la différence, répondent les manuels. Mais alors, l’essor manufacturier et commercial hollandais, un siècle avant l’Angleterre, à quel facteur l’imputer ? Les polders ne tiennent tout de même pas lieu de charbonnages ? C’est justement, rétorque-t-on, la pauvreté des ressources naturelles qui a contraint les Hollandais à commercer et à produire.
L’explication par les ressources naturelles se retourne comme un gant. Qu’elles abondent, et l’essor va de soi. Qu’elles manquent, et leur carence même est évoquée comme facteur de développement. Les traits les plus immatériels d’une civilisation-religion, attitudes à l’égard de l’autorité, comportements envers le changement, morale de l’individu et du groupe, valeurs sociales – étaient relégués au rang de menus satellites, gravitant péniblement autour de la structure centrale.
En fait, on ne parvenait pas à expliquer comment l’Europe nordique s’est substituée à l’Europe latine comme foyer d’innovation et de modernité. Une explication fut produite : jusqu’au XVIe siècle les pays d’Europe appartenaient à la même chrétienté d’Occident : même race, même culture, même encadrement par l’Eglise, même maillage féodal tempéré par la même éclosion des franchises municipales. En quelques décennies, une distorsion s’opère. Elle oppose en Europe de l’Ouest, à partir de la Renaissance et de la Réforme, pays latins et nations protestantes.
Le paysage bascule. La Hollande, puis l’Angleterre prennent un essor rapide, suivies par les autres pays protestants, tandis que le Portugal, l’Espagne ou l’Italie entrent en décadence et que la France, dont le cas est intermédiaire, lambine. Cependant, il est trop réducteur, pour ne pas dire trop simpliste, d’affirmer que la Réforme protestante serait comme une poule aux œufs d’or, et qu’elle détiendrait en elle-même le secret du développement économique, social, politique et culturel. Le partage entre une Europe «romaine», qui entre en déclin économique, et une Europe de la Réforme protestante, qui prend son essor, ne reflète pas nécessairement une détermination de l’économique par le religieux – ou du religieux par l’économique. Plus on étudie les origines de la révolution économique, plus on en vient à douter qu’il s’agisse d’une rupture brusque, due à une cause unique, et qui puisse être datée à l’année près.
Dans les approches de la relation entre la religion et l’économie, on trouve toutes sortes d’explications. Certaines postulent que la religion dépend des développements que connaît la vie économique et politique.
Ainsi, les variables économiques – niveau de vie ou intervention de l’Etat dans l’économie – influencent certains facteurs comme la pratique ou les croyances religieuses. D’autres approches considèrent, à l’inverse, que la religion a un effet sur les performances économiques, et, éventuellement, les institutions politiques. Elles supposent qu’au fur et à mesure qu’une économie se développe, les individus deviennent «moins religieux». D’autres enfin supposent que la religion a un impact sur l’économie par le biais de comportements individuels. En règle générale, la religiosité, en véhiculant les principes moraux de l’honnêteté et de l’éthique, influence la volonté de travailler et la productivité.
Elle peut tout autant exercer des effets néfastes pour les performances économiques en incitant à la soumission ou à la contemplation. Nous avons besoin, en somme, de jeter les bases d’une éthologie comparée du développement économique, social, culturel, politique. Ethologie, c’est-à-dire étude des comportements et mentalités respectifs des différentes communautés humaines, dans la mesure où ils fournissent des facteurs d’activation ou d’inhibition, en matière d’échanges, de mobilité intellectuelle et géographique, d’innovation. Ethologie, car on ne peut se contenter ni des schémas descriptifs de l’ethnologie ni des recommandations bien pensantes, mais réductrices, de la religion.
