Idées
Réforme des retraites : quand et comment ?
Sans partager une vision négative de l’action de l’Etat ni être un chantre de l’utopie, il faut convenir que la recherche de remèdes ou l’anticipation de solutions à d’éventuels problèmes que rencontrerait la réforme du système des retraites exige d’éviter deux écueils : une trop grande dépendance des retraites par rapport au Budget de l’Etat, et une redistribution excessive qui se traduirait par des promesses intenables à l’égard des futurs retraités.
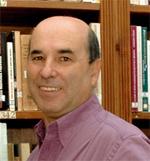
Notre système de retraite devrait connaà®tre à l’avenir des réaménagements importants qui, à terme, en modifieront profondément la nature. Si l’on peut esquisser le sens que prendront ces diverses réorientations, il s’avère plus malaisé d’en déterminer l’ampleur ou le calendrier précis. Comme dans bien d’autres domaines, la réflexion théorique sur les ajustements paramétriques ou les changements systémiques ne fournit aucune solution «clés en main», aucune recette immédiatement applicable.
Au Maroc, la problématique est celle de l’évolution de systèmes complexes élaborés dans une conjoncture spécifique. Il faut en comprendre les insuffisances et les excès, s’inspirer, lorsque cela est utile, de l’expérience de pays étrangers – mais rien n’est directement transposable -, et surtout clarifier les objectifs que ces systèmes sont censés réaliser.
N’oublions pas que, dans les systèmes de protection sociale, la branche retraite est celle qui symbolise au plus haut point une solidarité désintéressée entre les forts et les faibles. En effet, on peut toujours analyser les autres branches de la sécurité sociale sous l’angle utilitariste : il en va de l’intérêt de la société de soigner sa main-d’Å“uvre par un accès aux soins garanti; il est également de son intérêt d’encourager une fécondité suffisante pour permettre le renouvellement de la force de travail.
Il est en revanche, en terme de logique économique froide, moins directement dans son intérêt de garantir le niveau de vie de ses retraités. Est-ce à dire que, dans cette logique matérialiste, individualiste, économiciste, qui tend à prédominer dans le monde d’aujourd’hui, on doit porter moins d’intérêt à la solidarité inter- générationnelle ? Assurément non ! On a d’ailleurs coutume de considérer que le degré de civilisation s’apprécie au sort que l’on réserve aux aà®nés. La façon dont une société traite ses «vieillards» improductifs reflète avant tout une conception du respect de la dignité de la personne humaine, plus qu’elle ne répond à une préoccupation économique. Le développement du système de retraite est également la marque d’une profonde modification de la société, par le passage de solidarités intergénérationnelles purement familiales ou ethniques à des solidarités socioprofessionnelles ou nationales.
Ce passage n’est pas encore parvenu à maturité, mais, déjà , l’extension du salariat et de l’urbanisation est en train de rompre certaines solidarités traditionnelles et de bouleverser le modèle familial traditionnel.
Dans la mesure o๠l’action publique est conduite par des majorités successives préoccupées surtout par des objectifs de court terme, des observateurs soulignent la difficulté pour l’Etat, surtout en matière de retraite, de s’engager sur une politique de long terme. Pourtant, celle-ci s’avère souhaitable en raison de l’inertie des dépenses sociales et de la nécessité de parvenir à une redistribution équilibrée et à une justice minimale entre les générations. L’illustration la plus évidente des impérities gouvernementales concerne les systèmes de prévoyance collective dans certains pays européens. Les déséquilibres à terme de ces régimes engendrés par le vieillissement de la population ont été identifiés dès les années 60 ou 70, et des remèdes ont été alors proposés. Mais les mesures adaptées n’ont pas été prises à temps parce qu’elles n’étaient pas populaires.
Chez nous, un retard ou un manque d’engagement de l’Etat pourrait avoir des conséquences particulièrement dommageables dans la mesure o๠cela contribuerait à nourrir les inquiétudes, fondées ou non, concernant l’avenir d’une protection sociale en difficulté. Comme il pourrait renforcer le sentiment d’une remise en cause du contrat implicite passé entre l’individu et les organismes de prévoyance. Sans partager une vision négative de l’action de l’Etat, ni être un chantre de l’utopie, il faut convenir que la recherche de remèdes ou l’anticipation de solutions à d’éventuels problèmes que rencontrerait la réforme du système des retraites exige d’éviter deux écueils : une trop grande dépendance des retraites par rapport à la situation budgétaire de l’Etat, une redistribution excessive qui se traduirait par des promesses intenables à l’égard des futurs retraités. Il n’y a pas de réponse idéale à ces problèmes.
Mais on peut penser que les effets du risque moral seront plus limités si l’Etat apparaà®t comme le garant de l’intérêt général, mène une gestion rigoureuse, se révèle crédible en prenant et en respectant les engagements sur le long terme, et s’il bénéficie d’un soutien politico-économique et d’un consensus social important.
