Idées
Peut-on faire confiance aux statistiques ?
si la statistique dit une chose et qu’on prétend une autre, c’est l’autre qu’il faut prouver. Et faire une appréciation critique des statistiques sociales ne doit pas pour autant faire croire
à la possibilité de produire
de «bons chiffres», reflets parfaits de la réalité sociale.
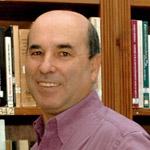
Les statistiques ont mauvaise réputation. En particulier les statistiques économiques et sociales sensibles, comme celles de la croissance, du chômage, de la pauvreté, qui sont l’objet de controverses récurrentes, et qui ont connu un regain de vigueur ces derniers mois, avec les discussions sur l’étendue de la classe moyenne, la profondeur de la crise ou l’ampleur du chômage. Il ne s’agit en rien d’une nouveauté. Qu’on se rappelle cette phrase de Churchill : «Je ne crois aux statistiques que lorsque je les ai moi-même falsifiées…».
Les catégories statistiques, comme les indicateurs, sont le résultat d’une construction méthodologique dont les critères peuvent facilement être manipulés par le pouvoir politique. Des gouvernements tentent d’influencer artificiellement les statistiques diffusées en modifiant l’étalonnage de l’instrument de mesure. L’objectif est en général de manipuler l’opinion publique par la production de chiffres «adaptés» au discours et au message que l’on souhaite transmettre à la société. Si c’est le cas, l’effet d’une telle manœuvre est largement vain. Dans une société ouverte, la médiatisation influence le débat public et la population est d’abord sensible à l’évolution de la situation vécue au quotidien. Modifier l’affichage statistique sans que change la réalité trompe surtout celui qui procède à ce changement…, tenté de croire qu’il a obtenu un vrai résultat.
Si le caractère politique des statistiques sociales est évident, la production statistique est un travail de définition, de mesure et de construction de catégorie, qui permet de préciser ce qui est compté, et comment. Mais ce travail ne s’effectue pas de manière identique pour toutes les statistiques sociales : la diversité des sources conduit à une grande variété de méthodes, relevant de logiques quelques fois différentes. Il existe deux types de sources principales pour les statistiques économiques et sociales : d’une part, les sources administratives, liées à l’activité des différents départements en charge de la gestion du pilotage des politiques économiques et sociales, et, d’autre part, les enquêtes réalisées par l’institution officielle. Sources administratives et enquêtes se distinguent en ce que les premières fournissent une information a priori exhaustive – elles recensent tout ce qui est concerné par la politique économique et sociale en question, sauf problèmes de mesure – alors que les secondes portent sur des échantillons qui ne correspondent qu’à une partie de la population concernée par le phénomène étudié, et à partir desquels sont estimés des résultats pour l’ensemble de cette population. On pourrait se méfier des résultats des enquêtes, qui ne portent que sur des échantillons, et reposent sur les réponses d’enquêtés, dont la bonne foi n’est pas a priori garantie. Néanmoins, les enquêtes présentent un certain nombre d’avantages sur les sources administratives : elles sont plus riches en descripteurs sociaux et démographiques, ce qui permet de mener des analyses socio-économiques plus poussées.
Cette réalité statistique, qu’elle soit saisie par source administrative ou par enquête se présente la plupart du temps sous la forme schématique d’un agrégat ou d’un indicateur. Cette grandeur est comptable, c’est-à-dire exprimée uniquement en chiffres. Ces chiffres et ces ordres de grandeur ne font qu’appréhender la silhouette de notre espace économique et social. Mais l’intérêt et les difficultés commencent lorsqu’on cherche à y pénétrer pour en reconnaître le tissu, la biologie et la signification. Si les statistiques ne peuvent donner un reflet exact de la réalité sociale, elles n’en demeurent pas moins indispensables pour la compréhension des phénomènes sociaux et l’élaboration des politiques publiques. Le langage des chiffres a naturellement de graves défauts….mais en première approximation, il a une vertu irremplaçable : il est la première victoire contre l’ignorance. Il a le mérite d’exister, et de donner aux sociétés le moyen de se connaître et de s’évaluer. Certes, les chiffres ne se suffisent pas – il s’en faut- à fonder en eux-mêmes tout le jugement. Mais sans eux, ou sans référence à eux, il n’y a plus d’opinion soutenable. La statistique a au moins une autre vertu : elle rétablit le bon ordre dans la charge de la preuve. La propagande ou la démagogie peuvent dire n’importe quoi. Désormais, si la statistique dit une chose et qu’on prétend une autre, c’est l’autre qu’il faut prouver. Et faire une appréciation critique des statistiques sociales ne doit pas pour autant faire croire à la possibilité de produire de «bons chiffres», reflets parfaits de la réalité sociale. Pour éviter que l’action publique soit victime d’une manipulation, le mieux est de disposer de statistiques qui «collent» au mieux à cette réalité. Ce qui exige de renouveler constamment les instruments de mesure de la réalité. Beaucoup de travail reste à faire dans ce domaine.
