Idées
Mon bien-être et notre PIB
Le bien-être est une notion subjective, individuelle et surtout relative qui s’oppose à la simple satisfaction des besoins matériels. il est avant tout un état d’esprit qui dépend moins des conditions externes que de la façon dont elles sont interprétées
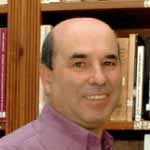
L’argent fait-il notre bonheur? Dans le jargon des économistes l’argent est désigné sous des vocables divers : la richesse, le produit intérieur brut, le revenu, le pouvoir d’achat. Ils laissaient entendre que le bien-être croît avec le revenu réel, tant pour les individus que pour les nations. La réalité est tout autre. La croissance économique, même continue, n’engendre pas nécessairement une «satisfaction de vie» des personnes. L’enquête nationale sur le bien-être du HCP de 2012 nous en fait la démonstration. Presque un Marocain sur deux est insatisfait de sa vie, un peu moins du quart en serait moyennement satisfait et à peine un sur trois en serait satisfait. Pourtant, la croissance de l’économie nationale évolue à un rythme soutenu: 4,7% par an entre 2001 et 2013, contre 2,8% durant les années 1990. La consommation des ménages a amélioré sa part dans le PIB, passant dans la même période de 57,8% à 60,1%. Les politiques publiques ont soutenu le pouvoir d’achat par l’injection de ressources appréciables dans le dialogue social. La solidarité sociale a été renforcée : plus de 50% du budget d’équipement sont affectés aux départements sociaux.
Comment peut-on donc expliquer cette divergence entre la progression des revenus et du PIB par habitant, d’une part, et du bien-être, c’est-à-dire l’évaluation subjective de sa satisfaction personnelle, d’autre part. Cette divergence s’explique par divers facteurs. D’abord, le PIB ne prend pas en compte la répartition de la richesse globale entre les personnes. Il ne s’intéresse pas aux dégâts occasionnés par la production sur le patrimoine collectif (patrimoine des ressources naturelles, patrimoine social, etc.).
Il ne valorise pas les activités non marchandes essentielles à la vie domestique et sociale, comme le temps passé avec les proches, le travail bénévole… Ensuite, la richesse n’est pas tout : la figure de l’homo economicus qui se contente de dépenser son revenu pour l’acquisition de biens et services qui lui procurent satisfaction est réductrice. L’homme n’attribue pas seulement une valeur à la quantité de biens et services qu’il consomme. Il valorise aussi la qualité de son environnement social, politique et naturel. De nombreux éléments, non pris en compte dans le PIB, contribuent à la satisfaction de vie : le sentiment d’appartenir à une société juste, la qualité de son travail et l’insertion sociale, les perceptions d’avenir, la santé, le contentement affectif, le sentiment de sécurité dans sa vie quotidienne, l’environnement politique et institutionnel ou encore la qualité de l’environnement. La qualité de vie de la personne peut donc être aussi importante que la quantité de biens et services disponibles. Certains de ces facteurs de qualité de vie ont fait l’objet d’investigation dans l’enquête HCP.
Enfin, si l’agrégat PIB produit à partir des données de la comptabilité nationale a des lacunes, le concept de bien-être, produit par des enquêtes auprès des personnes reste ambigu et n’a pas encore été synthétisé dans un agrégat conventionnel. Le bien-être est une notion subjective, individuelle et surtout relative qui s’oppose à la simple satisfaction des besoins matériels. Il est avant tout un état d’esprit qui dépend moins des conditions externes que de la façon dont elles sont interprétées. Le besoin croissant de le mesurer est à l’origine de la multiplication du nombre d’indicateurs le concernant. C’est en soit un signe que les individus ne se sentent pas plus heureux en dépit d’une accumulation constante de richesses et qu’ils sont de plus en plus soucieux de leur qualité de vie. C’est pour ces raisons que la question du bien-être intéresse la recherche des milieux académiques et des organismes nationaux – comme le HCP- et internationaux (OCDE, Banque Mondiale…).
Néanmoins, ce foisonnement intellectuel appelle à la prudence dans l’analyse des résultats des enquêtes. Certes, le bien-être subjectif dépend de deux grandes catégories de facteurs. Il y a d’un côté les déterminants objectifs comme les caractéristiques sociodémographiques ou la situation économique. Mais le bien-être exprimé est aussi influencé par des facteurs plus personnels. Les traits de caractère en font partie. Un individu optimiste aura tendance à se déclarer plus heureux qu’un autre se trouvant peu ou prou dans la même situation. Le postulat selon lequel le bien-être croît avec le revenu fait peu de cas d’une évidence: la perception de l’homme change sous l’effet de deux comportements : l’habitude et la comparaison sociale. D’une part, l’individu compare sa richesse à celle dont il disposait dans le passé. Si, à court terme, son bien-être augmente lorsque sa richesse croît, à moyen terme les normes de revenu ou de consommation sur la base desquelles il évalue son bien-être augmentent aussi. D’autre part, l’environnement social influence la satisfaction qu’un individu retire de sa richesse car celle-ci est comparée à celle d’autres membres de la société. L’effet d’habitude et la comparaison sociale produisent donc un relèvement constant des aspirations individuelles par rapport au niveau de vie matérielle. Ainsi, la divergence entre le revenu réel et le bien-être trouve-t-elle un de ses principaux facteurs explicatifs: l’écart entre les aspirations d’une personne et sa situation effective l’empêche d’accroître son bien-être alors même que sa richesse absolue progresse continuellement.
