Idées
Maroc – Mali : La revanche de l’Histoire
Les retrouvailles maroco-maliennes sont riches en enseignements. Elles ont montré notamment que les intrigues contre l’intégrité territoriale du Maroc aux sommets de l’OUA à Monrovia ou à Freetown (FricTown…) par certains régimes à la Moussa Traoré, à la solde des gazo-pétrodollars de certains Etats rentiers du Maghreb, n’ont pas résisté à la profondeur et l’épaisseur historiques des liens multidimensionnels qui unissaient et unissent le Maroc au Mali.
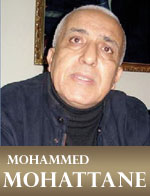
Après un gel de plusieurs décennies dans les relations entre le Maroc et le Mali, la visite historique du Roi Mohammed VI au Mali, pour la cérémonie d’investiture du nouveau chef de l’Etat malien Ibrahim Boubacar Keïta, constitue un évènement politique majeur, non seulement pour les relations bilatérales mais pour toute l’Afrique. Le point d’orgue de ces retrouvailles maroco-maliennes fut la prière à la Grande mosquée à Bamako, où, côte à côte, Amir Al Mouminine et le Président malien ont effectué la prière du vendredi. Un évènement riche de symboliques, que l’Imam, dans son prêche, n’a pas manqué de souligner, en se réjouissant que «Dieu nous a garanti Sa Grâce en ayant le privilège de voir parmi nous Amir Al Mouminine, descendant du Prophète, le Roi Mohammed VI».
Ces heureuses retrouvailles entre le Maroc et le Mali sont également une bonne illustration qui montre que, sous certains aspects, le printemps arabe n’a pas que des désavantages, que d’infortunes tentatives d’atteinte à l’unité nationale et l’intégrité territoriale du Mali, dans la foulée du printemps arabe, a procuré à ce pays l’avantage de retrouver un de ses fidèles amis et l’un de ses meilleurs alliés, le Royaume du Maroc, quelques mois seulement après la dure épreuve qui a failli ébranler l’édifice institutionnel étatique du Mali. Un pays qui a été sauvé in extremis par les forces armées du Mali avec l’appui de la Communauté internationale, des griffes du fanatisme, de l’obscurantisme, du terrorisme, des errances, partout d’ailleurs dans le monde, des radicaux et extrémistes de tous bords; des apprentis sorciers des préceptes de l’Islam, qui ont des franchises lucratives d’Aqmi, de Boko Haram, du Mujoao ou des sectes islamistes d’Ensar Eddine de l’Algérien Mokhtar ben Mokhtar. Une nébuleuse de bandits des grands chemins, contrebandiers de tous les commerces illicites, les drogues fortes, le commerce des enfants, des femmes et des hommes voués à l’émigration clandestine et l’esclavagisme ou le trafic d’armes venant en grande partie de l’arsenal militaire libyen, volées et détournées en pleine déconfiture du régime de Kadhafi. Des réseaux de mafieux dont les tentacules s’étendent de Tindouf à Adrar, des montagnes d’Ifoghas aux marches de la Somalie ; des groupes armés dont les émirs se donnent bonne conscience en brandissant le jihad…comme emblème.
Un destin commun séculaire
Corridor stratégique entre l’Europe et l’Afrique, le Maroc et le Mali ont su, depuis des lustres, en toute intelligence faire de cette rente de situation géographique un trait d’union entre le nord et le sud du Sahara, un moyen d’ouverture sur la Méditerranée. Ils n’ont jamais cherché à être complices pour exploiter ce «monopole naturel» et en faire une carte à jouer pour un chantage mercantile de courte vue, en prélevant d’exorbitantes royalties sur les caravanes commerciales qui transitaient par leurs territoires respectifs.
Cela a permis au Maroc et au Mali de lier conjointement, durant des siècles, leur existence au commerce et aux échanges entre l’Europe et l’Afrique. Du temps des grandes dynasties almoravide, almohade, sâadienne et au plus fort moment des Royaumes de Diarra, de Sosso, de Sundiata Keïta, le Royaume du Maroc et le Mali étaient des pièces maîtresses dans l’ordre économique méditerranéen, à l’époque centre et cœur de l’économie-monde. Ils se ressourçaient dans leurs prolongements extérieurs et puisaient leurs puissances dans leur complémentarité pour le commerce lointain entre l’Afrique et l’Europe. Implicitement ou tacitement, ils ont œuvré à construire et à sécuriser les routes caravanières et les voies de communication transsahariennes, contribuant ainsi à tracer les contours du monde méditerranéen, à articuler le sud et le nord du Sahara à l’Andalousie à l’époque du miracle andalou.
Sur les grands axes commerciaux entre le nord et le sud du Sahara, les caravanes sous «pavillons» marocain et malien convergeaient vers Sijilmassa, Gao, Tombouctou, Chinguett, Marrakech, les ports marocains de Salé, Mogador, Larache, Mazagan ou Sebta, en transportant sel, cuivre, or et autres métaux précieux, armes et poudre, quincaillerie, mercerie, laine, textile, cire, fruits séchés ou tout autre produit exotique.
Cette vocation maroco-malienne de corridor commercial transcontinental entre l’Afrique et l’Europe a résisté aux contingences de l’Histoire, à la découverte de l’Amérique et ses conséquences sur le déplacement du centre de l’économie-monde de la Méditerranée vers l’Atlantique, à la révolution industrielle et le moteur à vapeur et tous leurs effets sur l’essor de la navigation maritime.
Ainsi, jusqu’aux indépendances africaines, le commerce caravanier entre les villes-Nations du Mali et du Maroc a continué à prospérer et à remplir sa mission, comme le montre le témoignage de ce Malien de Tombouctou. Conducteur de caravanes, il racontait, lors d’une rencontre amicale en 2006 à Bamako, entre des Marocains et un groupe de notables maliens de Tombouctou, comment il a conduit en 1958…l’une des dernières caravanes commerciales entre Tombouctou et Marrakech. Une histoire qu’il relatait avec beaucoup de fierté, d’exaltation et de nostalgie, en rappelant avec détail et précision les différentes péripéties du périple, les gîtes d’étapes à Tindouf…, M’hamid, Ourika, Aghmat ; tout en mentionnant avec un peu d’humour que la Grande Ourse était le seul GPS à bord pour naviguer dans l’immensité du désert !
Les intrigues du régime de Moussa Traoré, l’éphémère pomme de discorde
Ces retrouvailles maroco-maliennes sont riches en enseignements au moins à deux titres : elles ont montré que les intrigues contre l’intégrité territoriale du Maroc aux sommets de l’OUA à Monrovia ou à Freetown (FricTown…) par certains régimes à la Moussa Traoré, à la solde des gazo-pétrodollars de certains Etats rentiers du Maghreb, n’ont pas résisté à la profondeur et l’épaisseur historiques des liens multidimensionnels qui unissaient et unissent le Maroc au Mali.
Aussi, ces retrouvailles montrent manifestement à quel point la voie de la sagesse du Royaume a été payante pour les deux pays. Par respect à tout ce qui a uni et continue de lier les peuples malien et marocain, le Royaume du Maroc a fait preuve de beaucoup de sagesse et de lucidité et a donc, par la grâce de Dieu, su ménager l’avenir. Présentement, l’Histoire lui rend royalement justice.
Parmi les reconnaissances de la fantomatique RASD, la plus durement ressentie au Maroc fut celle du Mali, un pays avec lequel le Royaume a eu des relations solides et permanentes. Après les indépendances en Afrique, les deux pays ont entretenu d’excellentes relations historiques; au moment de la constitution du groupe de Casablanca pour la création de l’OUA, les rapports entre le Roi Mohammed V et Modibo Keïta étaient non seulement très étroites mais ont même frisé la complicité selon les observateurs.
Dans la tourmente du gel des relations maroco-maliennes, dans les cercles familiaux maliens souvent et à chaque fois que la question marocaine est posée, le vœu du Roi MohammedV est rappelé ; le Souverain qui, dans sa chambre d’hôpital et peu avant sa mort, réitérera son souhait de placer le futur Roi Hassan II sous la protection de Modibo Keïta. Ce dernier accéda à sa volonté et veilla jalousement sur les intérêts de son désormais protégé. C’est Modibo Keïta, avant tout le monde, qui a soutenu Hassan II pour régler le contentieux territorial opposant l’Algérie au Royaume chérifien.
La force tranquille du Royaume qui a rendu les pendules à l’heure
Contrairement à d’autres pays africains qui ont reconnu la chimérique RASD, le Maroc n’a pas rompu ses relations avec le Mali pour les différentes raisons évoquées précédemment. Néanmoins et jusqu’à la visite historique récente du Roi Mohammed VI pour l’investiture du nouveau chef de l’Etat malien Ibrahim Boubacar Keïta, ce n’est pas un secret, entre Rabat et Bamako le froid a, malgré tout, persisté dans les rapports entre les deux pays. Et pour preuve, la visite du Mali n’a jamais été dans l’agenda du Roi Mohammed VI ; une position royale catégorique qui n’a pas manqué de faire des remous politiques au Mali et donner du fil à retordre aux Présidents maliens, notamment Amadou Toumani Touré, qui a eu souvent à faire face à des sit-in de protestations des dignitaires religieux du Mali, qui n’admettaient pas qu’Amir Al Mouminine survole, lors de ses périples africains, le territoire national sans visiter le Mali. Ce profond et sincère attachement spirituel pour le Maroc n’a d’égal que cet engouement annuel de pèlerins maliens, qui, à l’instar de leurs coreligionnaires mauritaniens et sénégalais, font chaque année le déplacement au Maroc pour effectuer des pèlerinages maraboutiques à Sidi Ahmed Tijani et à la Zaouiya Kadiria à Fès, au sanctuaire de Moulay Abdeslam Ben M’chich à Larache ou à la Zaouiya de Cheikh Maâ El Ainaïne à Semara.
Malgré la position du régime de Moussa Traoré contre l’intégrité du territoire du Maroc et pour sauvegarder ses liens historiques séculaires avec le Mali, le Royaume du Maroc a continué à maintenir ses relations d’amitié avec le Mali. Ainsi, des centaines d’étudiants maliens sont admis chaque année dans les universités marocaines. Dans le domaine de la santé, le Maroc assiste le Mali sous la forme d’évacuations sanitaires, sans les tracas du visa de l’espace Shengen ; de nombreuses personnalités, artistes, sportifs ont été ainsi soignés au Maroc. Egalement, lors de la dernière visite du Roi Mohammed VI au Mali, dans un élan de solidarité avec le peuple malien, une mission médicale spécialisée a été déployée dans la capitale malienne et un soutien logistique et humanitaire a été acheminé par les moyens aériens des Forces Armées Royales. Un hôpital militaire de campagne a été ainsi mis en place dans le cadre de cette mission et restera ouvert à toute la population malienne qui pourra ainsi bénéficier de plusieurs modules spécialisés et d’importants lots de médicaments.
Le plus bel exemple de réussite de la coopération entre les deux pays est sans doute les secteurs financier et des télécommunications, avec la Banque de Développement du Mali (BDM-SA), où Marocains et Maliens ont prouvé que la coopération Sud-Sud peut être une belle réussite. Ou bien avec le groupe Maroc Telecom qui participe activement au dynamisme du secteur des télécommunications au Mali, avec sa prise de participations dans le capital de la société malienne Sotelma, apportant ainsi une contribution significative au bien-être des populations et au développement économique et social du pays.
Malgré l’importance et la vitalité de ces domaines de coopération, le Mali et le Maroc peuvent et doivent se retrouver et peuvent faire encore plus, surtout en ces temps où l’Afrique fait l’objet de convoitises non seulement économiques, mais terroristes sous couvert de l’Islam, avec des idéologies religieuses importées et étrangères aux pays musulmans en Afrique. Alors que la tradition et la pratique de l’Islam en Afrique, au Mali comme au Maroc, ne font qu’un. Elles se nourrissent des mêmes préceptes du “juste milieu”, comme elles se réclament des mêmes valeurs de tolérance et d’ouverture à l’autre et demeurent le fondement du tissu spirituel continu qui a lié les pays musulmans d’Afrique.
Que ces heureuses retrouvailles du Maroc et du Mali servent de modèle aux autres pays africains et de rempart stratégique pour la stabilité et la sécurité spirituelle du continent et aider ainsi les peuples d’Afrique à faire face aux menaces du péril obscurantiste, tout en donnant toutes ses chances au Continent noir de devenir un acteur majeur de l’ordre international en gestation en ce début du XXIe siècle.
