Idées
Manifeste pour la ville
Gouverner une ville,
c’est aussi se préoccuper de l’action des pouvoirs publics, demeurée en général
très insuffisante.
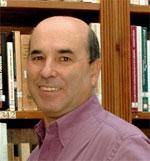
La semaine écoulée, deux jours durant, un aréopage de décideurs, d’élus et d’experts se sont donné rendez-vous au complexe de Skhirat. Au menu de la rencontre : l’ambition projet de tracer les grandes lignes d’une stratégie de développement urbain durable. Un impératif longtemps occulté. C’est que l’urbanisation devient de plus en plus un fait massif à multiples dysfonctionnements. Depuis quelques années, la population urbaine dépasse la population rurale. Parallèlement à la diffusion du fait urbain sur la plupart des régions du Maroc, l’armature urbaine nationale est devenue plus dense. En l’espace de cinquante ans, le nombre de villes a quadruplé. Depuis 1982, cette armature est devenue relativement équilibrée grâce à l’apparition de nombreuses villes moyennes qui comblent un vide qui a longtemps existé entre les grandes métropoles, d’une part, et la variété de centres modestes, d’autre part. L’inscription des villes dans l’espace et le contrôle de l’expansion de l’urbanisation constituent évidemment un sujet de préoccupation pour les décideurs. Leur souci fondamental est de saisir les évolutions démographiques et la diversité des trajectoires selon les agglomérations. D’autant que la lecture des territoires à travers le partage canonique ville/campagne se trouve mise en question par le tiers espace né de la périurbanisation. Et que la mondialisation conduit quant à elle à la nécessité d’accompagner les grandes villes dans le processus toujours plus ouvert des échanges. Pour qu’elles puissent exercer un effet d’entraînement sur le reste du territoire national. A une autre échelle, la géographie des villes nouvelles suscite bien des inquiétudes sur leurs dotations en équipements et les difficultés de mobilité qu’elles peuvent susciter chez les habitants. Les évolutions ou transformations des villes ont entraîné d’importants renouvellements dans leur gestion. Leur physionomie a beaucoup changé. En est-il de même des politiques d’urbanisme ? Gouverner une ville, c’est aussi se préoccuper de l’action des pouvoirs publics, demeurée en général très insuffisante. Elle reste marquée par l’inadaptation de la production des logements sociaux accessibles à des populations aux revenus modestes et, également, par un niveau de sous-équipement en infrastructures de base. Les différenciations sociales et spatiales tendent de plus en plus à structurer l’ensemble des territoires urbains. L’intercommunalité n’a pas été suffisamment encouragée pour pallier aux difficultés dues à l’émiettement communal. Le renforcement du lien social implique aussi la participation des habitants aux affaires de la cité. Or, l’évolution de la démocratie locale pâtit de réelles insuffisances.
La nouvelle gouvernance des villes exige un changement de perspective. Le temps n’est plus au diagnostic, déjà bien cadré. La réflexion stratégique a annoncé ses préconisations: une modernisation de l’action publique, des politiques sectorielles qui se territorialisent, des voies d’action innovantes où le local interpelle le central, la mise en place des dispositifs institutionnels de pilotage et de coordination. C’est du blindé, de l’incontestable. Il est tout de même étrange que des composantes de la politique urbaine actuelle n’aient pas l’objet de débats : comment peut-on réfléchir sur la stratégie à mettre en œuvre en évitant d’évaluer la pertinence de la politique des villes nouvelles, ou les résultats du programme des villes sans bidonvilles ? Ces dernières années, l’Etat a engagé des grands chantiers de mise à niveau du tissu urbain. Ces opérations de rénovation ou de réhabilitation constituent aussi des composantes d’une «politique urbaine». Cette dénomination est toutefois équivoque dès lors que les opérations ne s’appliquent pas à toutes les villes ni à toute la ville et qu’elles visent des actions autant sociales qu’urbanistiques. Etrange aussi que des parties prenantes du développement urbain aient brillé par leur absence dans ce colloque. Une Primature aux abonnés absents, des ministres invités qui pratiquent la chaise vide. Le développement urbain inéluctable est effectivement à haut risque ! La politique urbaine ne recouvre-t-elle pas une grande diversité d’interventions relevant à la fois de l’urbanisme et de l’aménagement urbain, de l’action sociale, de la prévention de la délinquance et de la sécurité ? Une première caractéristique de la politique urbaine est donc d’être pluridimensionnelle. Au sein de l’Etat, elle est avant tout interministérielle. Elle devrait reposer sur des actions de tous les ministères, coordonnées par des structures qui lui sont propres. Cette dimension interministérielle ne s’est pas encore affirmée. Il n’existe pas de comité interministériel des villes présidé par le Premier ministre ou son représentant et auquel participent un grand nombre de ministres. Une politique urbaine est aussi multipartenariale : du fait de la décentralisation notamment, l’Etat ne peut pas agir seul dans la plupart des domaines concernés. Aussi la politique urbaine repose-t-elle en partie sur la participation des collectivités locales (régions, provinces, communes) et sur celles de divers organismes tels que la CDG et le FEC. Elle devrait aussi s’appuyer localement sur le milieu associatif qui sert de relais vers les populations concernées, dont la participation, qui est désormais une priorité affichée de la politique de la ville, conditionne le succès des actions entreprises. D’où l’importance d’un cadre contractuel qui associerait les acteurs concernés et s’inscrirait dans l’horizon temporel de contrats de plans. La rencontre de Skhirat a amorcé peut être un tournant dans la lisibilité d’ensemble de cette politique publique d’une particulière complexité technique et politique. Son ambition sera-t-elle sacrifiée sur l’autel de la discordance ?
