Idées
L’évaluation des programmes d’appui à la PME
Nul ne contestera l’importance de la mise en place d’une forte «culture de l’évaluation» au sein des ministères et des agences chargés des politiques et des programmes visant les PME
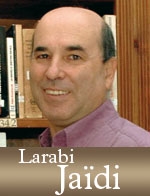
Le poids qu’occupent les PME dans le tissu productif est incontestable. Entités souvent familiales, unités organisées ou simples ateliers, autonomes ou sous-traitantes, ces entreprises sont un levier essentiel de la compétitivité de l’économie nationale. Leur vitalité ne masque pas pour autant leurs fragilités. Elles ont des difficultés à investir, ne se lancent pas avec vigueur sur les marchés étrangers et empruntent peu les chemins ardus de la performance managériale et technologique. Pourtant, l’intérêt porté par les pouvoirs publics au développement des PME ne date pas d’hier. On ne compte plus le nombre de programmes d’aide pour le développement de ce type d’entreprises. Avec peu de résultats. L’évaluation de l’impact de ces programmes s’impose.
En 2002, le «livre blanc» du département des Affaires générales identifiait les obstacles administratifs et réglementaires, de l’accès aux marchés et aux facteurs de production, et proposait une politique en faveur de la PME. Un programme public de mise à niveau et de modernisation de la PME a été mis en place par l’Agence nationale pour la petite et moyenne entreprise (ANPME) pour la période 2008-2012. Le Plan Emergence faisait de l’intégration des PME à la dynamique du programme un enjeu majeur pour la réussite de la politique industrielle. Des moyens spécifiques ont été mobilisés en faveur de ces entreprises, notamment par le biais des programmes Imtiaze, Moussanada, les contrats de croissance, les fonds de garantie pour l’investissement en fonds propres, les fonds publics-privés… Des fonds d’appui à la mise à niveau ont été mis au point dans le cadre de la coopération avec l’Union européenne, l’Allemagne, la France, en soutien aux entreprises pour leur permettre d’améliorer leur compétitivité. La Caisse centrale de garantie et Dar Ad Damane ont déployé des dispositifs d’appui financier aux entreprises. Des lignes de financement spécialement dédiées aux PME ont été mises en place par le système bancaire…
Clairs du point de vue de leurs raisons d’être, de leurs objectifs et des bénéficiaires visés, ces programmes ont été conçus pour apporter un soutien à de larges groupes de PME en les aidant à améliorer leurs compétences managériales, à obtenir un financement à des conditions raisonnables, à surmonter les effets des dysfonctionnements du marché. Parallèlement à ces actions et toujours dans le souci d’améliorer la productivité et la compétitivité des entreprises, des efforts importants ont été déployés pour la valorisation des ressources humaines des PME tant au niveau de l’encadrement par des actions de reconversion et de formation continue qu’au niveau de la main-d’œuvre. Enfin, dans le même ordre d’idées, des actions ont été entreprises afin d’assurer la conformité des produits nationaux aux exigences de qualité internationales et faciliter ainsi leur écoulement sur les marchés extérieurs souvent exigeants.
Des moyens considérables ont été affectés à ces programmes. Cependant, les évaluations de l’efficacité globale de leurs dispositifs sont rares.
Quand on s’intéresse à l’impact de ces actions sur les performances des PME, on arrive à la conclusion suivante : Même si les aides publiques ont permis quelques créations ou réalisations, elles sont restées tout de même globalement inefficaces. Les PME sont unanimes pour confirmer que le système est trop compliqué, les interlocuteurs multiples, les procédures d’obtention trop complexes. Il existe de nombreux acteurs dont le rôle est d’accompagner le développement des entreprises, mais la pluralité des guichets, la multiplication des strates au niveau des administrations rendent paradoxalement ces structures moins accessibles. Cette observation est à mettre en rapport avec la complexité de l’environnement et de l’acte d’entreprendre. Elle renvoie à l’inefficacité de l’interface qui existe entre les responsables d’entreprises et les gestionnaires de ces programmes. Elle révèle aussi qu’il n’existe pas de démarcation stricte dans l’esprit des bénéficiaires entre subvention, don, fonds alloué, assistance ou appui.
Les pouvoirs publics ont un grand intérêt à engager une réflexion évaluative des politiques à l’égard des PME. Tous les programmes doivent être évalués. Des critères devraient être dégagés pour apprécier les mesures prises: le bien-fondé des mesures ; la valeur ajoutée nette d’un programme; son efficacité par rapport à d’autres programmes qui permettraient d’atteindre les mêmes objectifs; sa pertinence dans la correction des défaillances identifiées ; l’efficience des interactions des mesures avec d’autres actions gouvernementales ; la rentabilité des programmes dans la réalisation de leurs objectifs spécifiques. Idéalement, l’évaluation devrait être prévue dès la conception des programmes, être conduite par des organes indépendants, et donner lieu à des recommandations en vue de renforcer la base des connaissances factuelles et analytiques qui sous-tendent la définition des politiques afin que les décideurs puissent agir en connaissance de cause. Nul ne contestera l’importance de la mise en place d’une forte «culture de l’évaluation» au sein des ministères et des agences chargés des politiques et des programmes visant les PME. L’évaluation est un moyen de garantir l’efficacité de ces programmes et dispositifs, de les adapter à l’évolution des conditions d’un environnement en mouvement.
