Idées
L’esthétique de la laideur
Après plus de cinquante ans d’indépendance, cette volonté d’un retour à un passé qui n’a jamais existé est non seulement une atteinte à la mémoire sociale et collective, mais aussi un renoncement à‚ l’espérance et aux ambitions que l’on nourrit pour le futur.
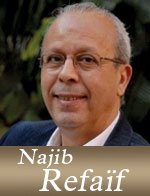
Si l’esthétique est définie comme la science du sentiment, son contraire doit être considéré assurément comme une totale insensibilité. Une vaste ignorance. Dans tous les domaines de l’art, dans la peinture comme dans l’architecture, l’esthétique est en effet une sensation, une vision et une façon d’être dans le monde. Mais qu’avons-nous fait pour passer, par exemple, dans nos villes et nos campagnes, d’une esthétique du beau à une laideur érigée en mode de vie ?
Lorsqu’on prend sa voiture ou le train pour aller d’une ville à une autre, au nord comme au sud, on est incapable de distinguer telle périphérie de Sidi Kacem de telle sortie de ville à Meknès. Si l’on prend ces deux agglomérations c’est simplement pour ne pas s’éloigner de la capitale et de ses environs, lesquels, non plus, n’échappent pas à cette confusion, pour peu que l’on quitte le littoral. Les mêmes maisons ou immeubles inachevés aux toits hérissés de fils de fer, les mêmes façades en briques rouges aux fenêtres grillagées et non finies vous accompagnent et défilent tout le long de la route sur des kilomètres de désolation, d’anarchie architecturale, de terrains vagues jonchés de sacs en plastique et d’immondices nauséabondes et variées.
Si l’extérieur offre cette vision dévastée, l’intérieur est souvent à l’avenant. La ville rejoint souvent la campagne dans une «rurbanité» qui fait que la ruralité bouscule l’urbanité dans une promiscuité où la notion d’architecture n’a plus de sens. Où sont ces villes reconnaissables dès l’entrée ? Ces centres urbains aux immeubles identifiables à leur style architectural ?
Ces rues jalonnées de telle espèce d’arbre ou de végétation ? Jusqu’au début des années 80, on pouvait encore savoir où l’on habitait. Cela ne fait pas des siècles, et pourtant on a l’impression d’avoir changé d’époque, d’être passé de l’âge de la pierre posée à l’âge de la brique cassée. En effet, on appelait «âge de la pierre posée», entre nous dans la presse, ces nombreuses cérémonies de pose de la première pierre inaugurale pour la construction de tel projet ou telle bâtisse. Quelque temps après, le petit muret dans lequel on avait introduit le tube en métal sera vite cassé pour laisser s’ériger un tout autre projet : ici un immeuble laid et là le siège d’une administration superflue. Ce fut souvent les projets culturels, ou à caractère social, qui en faisaient les frais.
Preuve que la culture et donc l’esthétique, cette science du sentiment, comptait et compte, hélas encore, pour quantité négligeable dans les calculs des promoteurs et autres bâtisseurs de la laideur.
Autre promenade en ville et autre constat tout aussi effarant. L’accoutrement de la population est en effet un sujet d’étonnement. On trouve de tout : des jeunes habillés et coiffés comme tous les jeunes d’aujourd’hui à travers le monde et d’autres en «qamis» pakistanais et son «séroual» et arborant une barbe selon le degré de pilosité de chacun, voire selon son niveau dans la radicalité religieuse. Chez les dames, on n’a jamais vu autant de filles et de femmes aussi mal fagotées depuis l’indépendance du pays. Où sont les élégantes djellabas d’antan aux couleurs pastel et à la coupe parfaite ? Place à des bizarreries vestimentaires qui vont du mariage forcé entre le jean halal et la chemise longue et ample surmontée de l’inévitable fichu ou foulard porté comme un étendard et un signe de ralliement. D’autres font encore plus dans la mocheté en optant pour des couleurs qui sont la négation même de celles-ci : un marron au ton cancrelat ou un gris noir lugubre. Ces tons anxiogènes sont le lot de toute la garde robe et en toute saison et nulle place à la fantaisie ni à la féminité. Bref, un remède contre la joie de vivre et un hymne spectral à la laideur. On peut multiplier à foison les exemples et les paradoxes de cette expression de la laideur sociale dans d’autres domaines et dans les us et les coutumes d’aujourd’hui. Vaste programme pour les sociologues de chez nous qui seront en peine d’analyser ces phénomènes intempestifs. D’autant que toutes ces transformations sont relayées au quotidien et instantanément par les médias tous supports confondus, par des vedettes en vogue et surtout par certains leaders de l’opinion et de la politique qui portent, triomphalement aujourd’hui, ce paradigme de la laideur comme un étendard. Et c’est certainement à tort que nombre d’entre eux pensent qu’on peut substituer impunément une certaine conception de l’éthique à l’esthétique en tant que science du sentiment, c’est-à-dire, comme disent les philosophes éclairés, «un principe justificatif de l’existence».
Après plus de cinquante ans d’indépendance, cette volonté d’un retour à un passé qui n’a jamais existé est non seulement une atteinte à la mémoire sociale et collective, mais aussi un renoncement à l’espérance et aux ambitions que l’on nourrit pour le futur.
