Idées
L’esprit de la concurrence
Pourquoi l’élan réformateur du Conseil de la concurrence ne trouve-t-il pas tout l’appui souhaité auprès des milieux économiques ? Les organisations professionnelles transversales ou sectorielles n’ont pas manifesté un grand intérêt pour le conseil à sa création.
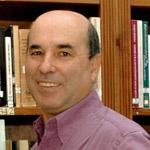
Est-il besoin d’énumérer les vertus de la concurrence et son apport à la loyauté des transactions économiques ? La liste sommaire qui suit semble désormais intégrée à la culture économique universelle : incitation à l’effort et à la productivité, élimination des gaspillages et des rentes de situation, adaptation des productions aux besoins des usagers, production à moindre coût, etc. Mais si ces vertus sont incontestables, pourquoi l’élan réformateur du Conseil de la concurrence ne trouve-t-il pas tout l’appui souhaité auprès des milieux économiques ? Les organisations professionnelles transversales ou sectorielles n’ont pas manifesté un grand intérêt pour le conseil à sa création. C’est que durant les années où le contrôle des prix était en vigueur, les entreprises de nombreux secteurs avaient pris l’habitude de coordonner leurs pratiques de fixation des prix. Dans la plupart des branches, l’administration préférait négocier les réajustements des prix des biens et services avec les organisations professionnelles représentatives des branches qu’avec des producteurs individuellement. En conséquence, les entreprises regroupaient leurs informations sur la structure de leurs coûts. Ensuite, elles formulaient des demandes uniformes d’augmentation de prix par le biais de ces organisations ou déposaient des requêtes isolées mais identiques pour leur propre compte. En ce sens, le système de contrôle des prix entravait la pratique de la concurrence. La libéralisation des prix intérieurs a donné plus de latitude aux opérateurs économiques pour faire des prix une arme de conquête des parts de marché, mais les concertations au sein des organisations professionnelles ont perduré. L’hibernation du conseil sur ses dix premières années n’est pas étrangère à cette distance du patronat à l’encontre d’une institution dont on comprenait mal l’opportunité et le rôle. Dans l’esprit du patronat, la sortie d’un régime de contrôle des prix ne pouvait conduire à l’entrée dans une nouvelle phase de surveillance des marchés. Il fallait donc éviter d’adopter des dispositifs qui limitaient la possibilité d’accords implicites sur les prix ou limitaient le champ de la concertation au sein des organisations professionnelles, d’autant plus que le démantèlement des accords de libre-échange exposait le marché intérieur à une rude concurrence. Ce n’est que récemment que les organisations professionnelles manifestent plus d’écoute au discours du conseil, prêtent plus l’oreille à ses appels à collaboration. Si la frilosité et la crainte à l’encontre de cette institution se dissipent, la posture affichée n’est pas encore clairement affirmée. La question de la concurrence ne peut prétendre accéder à la même priorité que la réforme fiscale, l’environnement de l’investissement ou de l’allégement des coûts des facteurs. Tant que cet organe de surveillance des marchés démontre son utilité par la condamnation des abus des positions dominantes, il force le respect. Encore qu’il est préférable de résoudre ce genre de conflits, réels ou potentiels, par des conciliabules ou des négociations amicales entre parties concernées. La roue tourne et, dans le monde des affaires, il est conseillé d’éviter de s’opposer frontalement aux puissants. Tant que cet organe peut réagir pour dénoncer la concurrence déloyale de l’informel, de la contrebande, il est fortement appuyé, voire sollicité… même si ces questions ne relèvent pas réellement de ses compétences. Tant qu’il peut lever le voile sur l’opacité des marchés publics, objet de litiges récurrents, on ne peut que l’encourager dans ses initiatives. A condition qu’il désigne du doigt l’administration et son manque de transparence. Par contre, ses avis sur les ententes entre soumissionnaires seraient moins compris. Quant à fourrer son nez dans les pratiques anticoncurrentiels du monde des affaires, alors là, prudence, prudence, prudence… Pourtant, des indices d’ententes sont souvent relevés dans des secteurs de l’économie nationale. Beaucoup plus, il est vrai, sur les marchés concentrés que sur les marchés concurrentiels. Mais, l’économie marocaine n’est-elle pas relativement concentrée ? Il y a quelques années, une comparaison des coefficients de concentration des quatre premières entreprises entre le Maroc et les Etats-Unis avait montré que cet indicateur est plus élevé au Maroc, et dans plusieurs secteurs. Une situation propice aux ententes sur les prix ou sur les marchés. La pratique est ancienne. Ici comme ailleurs. Adam Smith soulignait déjà, à la fin du XVIIIe siècle, que «les gens du même métier se rassemblent rarement, même pour se divertir et prendre de la dissipation, sans que la conversation aboutisse à une conspiration contre le public ou à quelque invention pour augmenter leurs prix». Avec la libéralisation de l’économie, ces pratiques peuvent prendre une dimension parfois inquiétante. Le pouvoir économique devrait manifester un soutien plus tranché, plus vif à la démarche du conseil. A l’image de ce qui se passe dans d’autres contrées, on souhaiterait que les organisations professionnelles nationales soient plus présentes dans les débats sur les textes de loi sur la concurrence, sur le projet de réforme du conseil. Qu’elles expriment des observations sur les droits conférés aux Autorités de la concurrence, sur les modalités d’exercice de leurs missions. Qu’elles fassent part de leurs critères d’appréciation des abus des positions dominantes, des concentrations ou toutes autres pratiques déloyales. En somme, que l’esprit libéral dont se prévaut le monde des affaires soit en conformité avec la culture des idées libérales.
