Idées
Les prévisions économiques : des écarts à expliquer
Aujourd’hui, l’à¢ge de la prévision facile est désormais dépassé, le paysage s’est transformé et exige des approches plus sophistiquées.
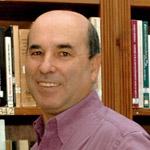
En cette période de l’année, les prévisions sur la croissance envahissent le débat économique et politique, la vie des entreprises, voire les projets des ménages, mais sont-ils fiables et sont-ils utiles ? On critique beaucoup les prévisionnistes pour leur relatif optimisme. Des fois ils cherchent à tempérer l’optimisme des chefs d’entreprise, qui auraient tendance à penser que la crise était définitivement terminée. Dans d’autres, ils essayent au contraire d’aller à l’encontre de l’extrême pessimisme ambiant. Ils mettent comme condition une modification de la politique économique suivie par le gouvernement. Mais quand cette condition n’a pas été entendue, la prévision ne se réalise pas. On les critique aussi sur leur tendance à se tromper. Leurs arguments de défense sont imparables. Premier argument: les données qu’ils utilisent. A leurs yeux, elles sont toujours plus tardives qu’ils ne le souhaitent, ce qui rend incertain le simple diagnostic de la situation présente. Les données sont aussi et surtout insuffisantes dans certains domaines, en particulier les stocks. Deuxième argument, les prévisionnistes reprochent aux utilisateurs de ne pas accorder suffisamment d’importance aux réserves qu’ils émettent. Leurs prévisions dépendent de certaines conditions, relatives notamment à la politique économique et monétaire choisie par les dirigeants. La médiatisation a souvent tendance à occulter ce message.
Reste à expliquer les écarts de prévision d’une source à une autre. Cette différence des prévisionnistes n’est pas toujours comprise par l’opinion. Ne travaillent-ils pas avec les mêmes données, auxquels ils appliquent les mêmes raisonnements ? Oui, mais les méthodes de prévisions peuvent différer d’un organisme à l’autre. Certes, tous disposent d’un très grand nombre de données statistiques : les comptes nationaux, trimestriels ou annuels, l’indice de la production industrielle, l’indice des prix de détail, les différentes masses monétaires, les taux d’intérêt, les taux de change, les enquêtes régulières auprès des chefs d’entreprise. Les prévisionnistes suivent l’évolution de ces indicateurs, qui leur permettent de juger de la situation présente de l’économie. Ils essayent ensuite, en fonction de l’image qu’ils ont du fonctionnement de l’économie, d’en déduire les évolutions les plus probables. Les organes officiels disposent d’instruments qui ont bouleversé les pratiques des prévisionnistes : les modèles macro-économiques. Ces modèles, qui diffèrent dans leurs configurations, leurs hypothèses, permettent d’assurer aux prévisions une cohérence interne globale. Les différences s’expliquent aussi par le fait que les prévisionnistes accordent également une grande importance aux faits hors statistiques. Les déclarations, les témoignages, les conversations et le doigt mouillé ont ainsi une grande importance, souvent masquée par l’appareillage utilisé, prétendant à la rigueur scientifique.
Aujourd’hui, l’âge de la prévision facile est désormais dépassé, le paysage s’est transformé et exige des approches plus sophistiquées. D’une part, dans une économie ouverte, il n’est plus possible de traiter l’environnement extérieur comme exogène. Pour venir à bout de ce problème, la seule solution réside dans les modèles multinationaux. Les principaux organismes de prévision ont franchi le pas. Mais ces modèles sont par nature très lourds et leur coût de maintenance est très élevé. D’autre part, la prévision de loin la plus utile est celle qui anticipe les retournements. Les prévisionnistes doivent suivre de près des indicateurs censés anticiper sur les retournements. Certains sont par nature précurseurs, comme les entrées de commandes ou la durée du travail. D’autres indicateurs sont considérés comme précurseurs pour des raisons plus théoriques, comme les mises en chantier dans le bâtiment ou les agrégats monétaires. Or, pour la prévision des retournements, les modèles dont on dispose ne disent pas grand- chose. Enfin, la politique économique a perdu une partie de son efficacité et de son autonomie. D’abord en raison de l’interdépendance croissante des économies nationales. Ensuite du fait de l’existence de déficits publics qui réduisent à presque rien la liberté d’action en matière de politique budgétaire. D’où la nécessité d’un changement d’optique. Savoir quel sera le taux de croissance ou le taux d’inflation devient moins essentiel. Ce qui compte surtout, c’est de prévoir les conséquences d’une décision donnée. Si, par exemple, le déficit budgétaire est jugé trop élevé, il faut choisir entre différentes mesures propres à le réduire, et essayer d’évaluer l’impact de chacune. Mais, pour ce choix, il n’est nullement indispensable de savoir avec précision quel sera effectivement le déficit budgétaire, une prévision de toute façon hors de portée. De même pour les innombrables mesures destinées à ralentir la progression du chômage : le vrai problème est finalement de savoir si elles vont agir dans le bon sens et de manière durable, pas de prévoir le nombre de demandeurs d’emploi dans six mois ou dans un an. La prévision économique a encore un long chemin à conquérir pour s’affirmer à la fois comme un art et une science.
