Idées
Les prémices d’une gouvernance mondiale ?
L’idéal de la gouvernance mondiale est un processus
de coopération qui rassemble les gouvernements nationaux, les organismes publics multilatéraux
et la société civile
afin d’atteindre
des objectifs approuvés
d’un commun accord.
On en est encore bien loin.
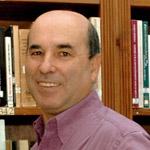
A la veille de la tenue du sommet des grands de ce monde, les tensions entre pays anglo-saxons et l’Europe continentale sur la relance et la régulation du capitalisme n’annonçaient pas un dénouement heureux du G20. Pointaient à l’horizon la menace de l’extinction du crédit, les risques de la montée du protectionnisme et l’aggravation de la situation des pays les plus pauvres, confrontés à la baisse simultanée des prix des matières premières, des transferts en provenance des diasporas, des investissements directs et de l’aide au développement. D’aucuns considèrent que les résultats du sommet ont démenti ces spéculations. Le sommet a pris quatre orientations pour essayer de sauver l’économie mondiale : de l’argent, de nouvelles règles, des institutions internationales renforcées et l’admission des pays émergents à la table des pays riches. Il a mis à l’index des paradis fiscaux, engagé des contrôles accrus pour les fonds spéculatifs, renforcé les moyens et pouvoirs des institutions internationales. Il a signé le grand retour du FMI et pris en compte la mondialisation dans les «organes» de décision.
Face à ce triomphalisme ne faut-il pas mettre un bémol ? Le G20 a certes réussi à exorciser le spectre de l’échec de la conférence de Londres de 1933 où l’incapacité des nations les plus développées à s’accorder sur des principes communs en matière de monnaie et de commerce a fini par provoquer l’emballement de la grande déflation. Mais dans l’euphorie, que de sujets n’ont été abordés que du bout des lèvres ou ont été carrément éludés. Celui d’avoir des finances publiques saines à long terme : les Allemands qui s’en inquiètent estiment que rien ne sert de faire des dépenses supplémentaires. Celui des taux de changes : c’était prendre le risque de ne rien obtenir sur la régulation. Le sommet n’a absolument pas traité d’une question essentielle qui est le déséquilibre majeur, insensé, entre la sphère financière et la sphère productive. Enfin, rien n’assure que l’avènement d’un «new FMI» n’aura plus rien à voir avec ce vieux machin, décrié pour ses politiques d’ajustements structurels qui ont fait tant de mal aux pays du Sud.
Si le sommet n’était pas celui de tous les actes et décisions attendus, il faut admettre qu’il a innové dans son approche et sa méthode. Le G20, ce n’est pas le G7. Il reflète un léger changement dans les rapports de force sur la planète. Depuis sa création, en 1975, le groupe des Sept rassemblait les grands pays industrialisés, le club vainqueur de l’histoire à la fin du XXe siècle. Devenu G8 avec l’intégration de la Russie, le sommet marquait le triomphe définitif de la démocratie libérale et de l’économie capitaliste. Dans ce cadre, les grands convenaient de discuter de leurs politiques économiques et des recommandations nécessaires au bon fonctionnement de l’économie mondiale. Avec le recul, le sommet apparaît surtout comme un outil permettant aux Etats-Unis de faire pression sur la politique économique de leurs partenaires européens et japonais. Soit qu’ils les somment, comme au début des années 80, de relancer leurs économies pour absorber les exportations américaines soit qu’ils s’entendent pour limiter les fluctuations du dollar, seul exemple de coopération réussie au sein du G7 (accords du Louvre en 1985 et du Plazza en 1987). Mais ni les dérapages des déficits publics américains au cours des années 80, ni l’explosion de leur déficit extérieur dans les années 90 n’ont donné lieu à une remontrance du G7 à l’encontre des Américains. La nécessité d’élargir ces rencontres de haut niveau à certains pays émergents (Corée du Sud, par exemple) ou à forte population (Inde, Brésil, etc.) pour leur donner plus de légitimité, ont amené la création d’un G20. Mais, au total, la coopération à l’échelle mondiale, en matière de politique économique, est restée jusqu’à présent très limitée.
Le besoin d’une nouvelle gouvernance mondiale s’est intensifié sous la pression des multiples crises qui ont éclaté en 2008 : crise financière contaminant l’économie réelle, crise de l’énergie et des matières premières sur fond de crise écologique annoncée, crise alimentaire débouchant sur de graves crises sociales dans les pays les plus pauvres. Cette conjonction d’événements suggère l’existence de graves dysfonctionnements au sein de la gouvernance mondiale et légitime, par conséquent, la question de sa redéfinition. Le dernier G20 a-t-il réussi à transcender les intérêts et les priorités divergents de ses membres pour définir un cadre mondial pour la lutte contre la déflation et la régulation future du capitalisme ? A-t-il marqué un tournant en fixant le cadre d’une stratégie coordonnée de lutte contre la déflation ? A-t-il acté la fin de l’unilatéralisme américain en resserrant les liens transatlantiques tout en engageant un dialogue stratégique avec la Chine et la Russie ? Difficile de statuer sur ces questions. En fait, le G20 ne pourra renouer, avec l’esprit de Bretton Woods, qu’en rénovant le multilatéralisme, en prenant acte de la nouvelle donne du XXIe siècle, placée sous le signe de la montée en puissance des pays émergents. L’idéal de la gouvernance mondiale est un processus de coopération qui rassemble les gouvernements nationaux, les organismes publics multilatéraux et la société civile afin d’atteindre des objectifs approuvés d’un commun accord. On en est encore bien loin.

