Idées
Les pays émergents en Afrique
aux côtés d’une complexe réalité politique, économique, sociale, environnementale, sécuritaire, coexiste une réalité nouvelle, celle d’une Afrique qui affiche des taux de croissance semblables à ceux relevés dans une Asie émergente.
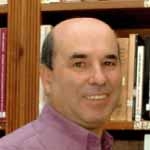
Le continent africain est de plus en plus courtisé par les pays dits «émergents». L’Afrique fait l’objet de visites récurrentes organisées au plus haut niveau politique par le Brésil, la Chine, l’Inde ou la Turquie. La part des émergents dans les échanges de l’Afrique a augmenté de 23% en 2000 à 40% en 2012. Ces pays ont apporté un quart des entrées d’IDE dans le continent pendant la période 2000-2012. Cette attractivité suscite une série de questions. Tout d’abord au sujet des stratégies africaines des pays émergents : en quoi diffèrent-elles de celles déployées par les acteurs traditionnels (UE, Etats-Unis) ? Ensuite, les pays émergents sont-ils en concurrence entre eux ou développent-ils des coopérations différenciées ? Enfin, en quoi la présence des émergents contribue-t-elle au développement de l’Afrique ?
Les raisons de cet intérêt pour le continent africain relèvent d’ordres multiples : la nécessité évidente des émergents d’investir de nouveaux marchés et leur appétit pour les importantes ressources naturelles de l’Afrique (hydrocarbures, cuivre, cobalt, charbon, fer, bois, uranium…); le foncier est aussi un enjeu : achat ou location de terres cultivables pour la fourniture de biens alimentaires et d’agrocarburants ; les émergents se placent aussi sur des gros contrats dans le domaine de la construction et des infrastructures. L’intérêt des émergents pour l’Afrique est aussi motivé par la recherche d’appuis ou d’alliances au sein d’instances multinationales ; le besoin d’étendre les périmètres d’influence ainsi que d’accroître leur visibilité et de renforcer leur reconnaissance internationale. A cela s’ajoute l’évolution de l’Afrique elle-même. En effet, aux côtés d’une complexe réalité politique, économique, sociale, environnementale, sécuritaire, coexiste une réalité nouvelle, celle d’une Afrique qui affiche des taux de croissance semblables à ceux relevés dans une Asie émergente, ce qui fait dire – peut-être de manière abusive – à des organisations internationales que le continent africain se trouverait en situation… d’émergence. En pratique, chaque pays investisseur intervient dans les domaines où il a développé une spécialisation dans son propre pays. Ainsi, la Chine échange depuis longtemps avec l’Afrique ; ses investissements dans le continent ont explosé ces dix dernières années. Près de la moitié des investissements sont dirigés vers le secteur minier. Le pétrole est le second secteur d’intervention. L’engagement dans l’agriculture est plus récent avec la prise de contrôle dans le foncier justifié par la contrainte de l’approvisionnement alimentaire.
La Chine reproduit le modèle asymétrique occidental de l’extraversion primaire. La réputation des entreprises chinoises se dégrade : non-respect des règles de sécurité ou des normes environnementales. Certains chantiers ont été annulés sous la pression syndicale. Les investissements indiens se sont diversifiés et ne se limitent plus aux pays anglophones de l’Afrique de l’Est et aux Etats riverains de l’Océan indien. L’Inde s’intéresse aussi aux matières premières africaines (charbon, pétrole, uranium) mais ses entreprises ont une envergure supérieure à celle des firmes chinoises. Les géants indiens (Tata, Mahindra Mhaindra, Cipla, Iffco, Bharti) sont présents dans les secteurs de l’automobile, des véhicules utilitaires et tracteurs, le médicament générique et les produits de soins de beauté, l’agroalimentaire, la téléphonie, les infrastructures. Le Brésil utilise ses liens historiques, linguistiques et culturels avec les pays lusophones comme levier d’une action économique qui s’accompagne d’une diplomatie dite «solidaire». Les entreprises brésiliennes interviennent surtout dans le domaine agricole, de l’agrocarburant et de l’irrigation. De leur côté, les entreprises turques, offrant des standards occidentaux mais à des coûts plus compétitifs que ceux de la concurrence européenne, interviennent dans de nombreux secteurs: de l’agroalimentaire, du textile, du bâtiment et des travaux publics (BTP) ou les banques. L’agence d’aide au développement turque (Tika) a étendu ses activités. Ankara a procédé au triplement du nombre de ses ambassades sur le continent, à la création d’écoles pour diffuser la langue et la culture turques. Les pays africains recherchent la coopération avec les pays émergents car elle est non seulement perçue comme plus avantageuse et moins entravée de conditionnalités politiques que celle des pays de l’OCDE mais aussi parce que les entreprises des pays avancés ont souvent été motivées par une approche prédatrice dans l’exploitation des ressources locales. Les relations économiques de l’Afrique avec les pays émergents restent encore sur le registre de l’échange inégal. Sur le plan des échanges commerciaux, les pays africains demeurent des réservoirs de produits primaires (pétrole, métaux ou matières premières agricoles). En retour, ils sont des déversoirs de produits manufacturés. Une évolution de ces relations se dessine grâce au renforcement de l’implantation des entreprises des pays émergents, que ce soit sous forme d’investissements directs ou de joints ventures, même si la remontée en gamme des produits vers des activités à plus haute valeur ajoutée semble encore soumise à de fortes contraintes concurrentielles.
