Idées
Les paradoxes de Doing Business
Même si l’étude de la Banque mondiale nous est globalement peu favorable, il est possible d’utiliser certains de ses résultats pour corriger certaines idées défavorables sur notre pays.
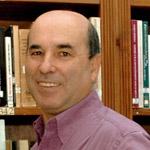
La version 2011 de Doing Business met à nouveau à jour la stagnation du Maroc dans le classement sur l’environnement juridique et administratif des affaires. Le Maroc occupe le 114e rang, entre le Liban et l’Argentine. Ce mauvais classement s’expliquerait notamment par une position en matière de protection des investisseurs et de la fiscalité (nombre de paiements, complexité des procédures et même niveau de prélèvement en pourcentage du profit des entreprises). Nous enregistrons une régression sur les délais et les coûts des droits d’enregistrement ainsi que dans le domaine du droit du travail (rigidités en matière d’embauche, heures travaillées). Notre image est par contre moins mauvaise en matière de création d’entreprise (coûts, délais, capital requis), d’obtention de crédit et de procédures concernant le commerce international même si elle ne brille pas d’un éclat particulier.
L’étude de la Banque mondiale analyse des blocages administratifs à la croissance. Les indicateurs présentés évaluent les réglementations publiques et la protection des droits de propriété, ainsi que leurs effets sur les sociétés, en particulier sur les petites et moyennes entreprises nationales. Les indicateurs sont utilisés pour identifier quelles réformes ont fonctionné, à quel endroit et pour quelles raisons. Ce travail s’inscrit dans le courant de littérature qui s’intéresse au lien entre droit et performance économique et il recourt à la méthodologie des indices composites. Une méthodologie d’un usage répandu, mais qui soulève de nombreux problèmes dont essentiellement celui de la pertinence de l’agrégation des informations de base: ces indices agrégés expliquent-ils les phénomènes dont ils ont l’ambition de rendre compte, tels que le niveau de vie, l’attractivité ou la croissance économique ? Conduisent-ils à des classements stables ou au contraire très sensibles à la méthode d’agrégation ? De telles questions sont aussi examinées à propos d’autres exemples d’indices composites, ceux du World Economic Forum. Des travaux montrent que ces indices ne rendent que très imparfaitement compte des performances économiques des pays et que les classements qui en sont dérivés sont instables.
Un débat oppose les économistes sur la pertinence des indicateurs de synthèse. Certains y sont favorables, expliquant que tout indicateur synthétique est forcément biaisé, mais que si les critères sont convenablement choisis, la méthode peut fournir des indications intéressantes sur la manière dont le classement du pays évolue et sur les raisons principales de ces évolutions. Ceux qui y sont hostiles insistent sur la difficulté à obtenir une pondération correcte des critères, sur les biais introduits par la manière dont ces critères sont mesurés, sur l’hétérogénéité d’un instrument de mesure mélangeant des critères objectifs et qualitatifs, etc. La juste position est un peu intermédiaire entre ces deux points de vue. Le travail de comparaison réalisé par la Banque mondiale est sans doute le plus sérieux techniquement de tous ceux qui présentent des classements de pays dans les domaines de la compétitivité, de l’attractivité des investissements ou de la liberté des transactions. Sa méthodologie est à la fois précise et explicitée, elle s’appuie sur un nombre élevé d’indicateurs, dont chacun est accompagné d’analyses précises et documentées.
Même si l’étude de la Banque mondiale nous est globalement peu favorable, il est possible d’utiliser certains de ses résultats pour corriger certaines idées défavorables sur notre pays. Mais l’essentiel n’est pas là : à supposer même qu’une méthode de calcul de grande qualité permette d’évaluer de manière fiable la compétitivité ou l’attractivité globale d’un territoire donné, l’utilisation pratique d’un tel outil dans le cadre d’une décision concrète d’investissement, ou pour orienter la politique de promotion vers un type d’investissement donné, est en fait extrêmement limitée. En effet, les indications globales qui sont fournies par ce type d’approche ont un caractère beaucoup trop général pour s’adapter aux cas particuliers de chaque type d’activité et de chaque projet. Par exemple, un pays globalement mal doté en laboratoires de recherche peut disposer, dans une seule ville ou région, d’un pôle d’excellence spécialisé capable d’attirer des investisseurs sur un créneau précis. Les approches «macro» ne fournissent pas d’outils utilisables pour représenter, au-delà d’une image générale très globalisante, très floue, voire déformée, du territoire concerné, la diversité de ses potentiels. Les classements synthétiques traduisent nécessairement les préconceptions incarnées dans les choix élémentaires et dans les pondérations. Les indicateurs élémentaires reflètent, à leur tour, certaines réalités tout en occultant de nombreuses autres, ou reflètent les opinions de secteurs choisis de l’économie et de la société – orientées par les formulations retenues et avec le risque calculé de confondre opinions et réalités. Ce «benchmarking» multidimensionnel exprime pour une part des réalités, mais pour une autre part les préconceptions incarnées dans les équations retenues. Aussi, l’usage inconsidéré de ce chiffrage unique ou du rang synthétique du pays nous semble à la fois un peu dangereux par la sur-médiatisation dont ils font l’objet et par le relatif simplisme du message diffusé. Le «benchmarking» ne peut pas se substituer à l’analyse économique, il lui est complémentaire. Il crée ses propres savoir-faire dont le Maroc ne doit pas faire l’économie : collecte, création et mise en œuvre d’un grand nombre d’informations comparatives, liens avec les analyses économiques et politiques…
