Idées
Les OMD, l’INDH et Lula
Chronique de Larabi JAIDI.
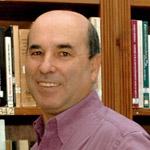
Q uelle relation entre ces trois références me diriez-vous ? En apparence aucune. Mais à y voir de plus près, elle est bien établie. Toutes se sont donné d’ambitieux programmes de réduction de la pauvreté. Elles ont eu le mérite de mobiliser des ressources et des acteurs dans une perspective de développement. Les unes et les autres ont cherché à innover dans les démarches pour sortir des déclarations de bonnes intentions, inventer de nouveaux mécanismes pour atteindre des objectifs chiffrés, dans des échéances précises. Le hasard de l’agenda politique a fait qu’en cette période, chacune de ces références établit son bilan final ou à mi-parcours pour de nouvelles perspectives. La mise en comparaison peut aider à tirer des enseignements.
Le Sommet planétaire contre la pauvreté a été un passage en revue, cinq ans avant 2015, des efforts fournis par la communauté internationale, pour la réalisation des OMD. Pour ce bilan au 2/3 du parcours, on peut convenir que des efforts ont été faits dans les domaines de l’éducation, la promotion du genre et l’amélioration de la santé maternelle et infantile. Ceci dit, c’est de l’euphémisme que de dire qu’on est loin du compte. Il est malheureusement acquis que de sérieux retards ont été pris pour honorer les engagements aux yeux du monde. Au jour d’aujourd’hui, près de 3 milliards d’hommes et de femmes vivent avec moins de 2 dollars par jour. 1500 femmes meurent chaque jour, du fait des complications de grossesse ou lors de l’accouchement. De l’aveu même du patron de la diplomatie mondiale Ban Ki-Moon, «nous observons des progrès mitigés en direction de ces objectifs et … de nouvelles crises menacent l’effort mondial pour réduire de moitié la pauvreté extrême». Il s’alarme en relevant que quelque 20 milliards d’aides promis par les donateurs, pour le compte de l’année en cours, n’ont pas été accordés. Hier comme aujourd’hui, la communauté internationale annonce des milliards d’aides mais ne consent pas toujours à passer à l’acte. Elle ne se contente que d’assurer le service minimum en faveur des pays en développement. La justice internationale est encore une vue de l’esprit. Changer la donne d’ici 5 ans demande que les pays concernés mobilisent leurs propres ressources, définissent des politiques adéquates et disposent de la volonté politique nécessaire.
Dans ses engagements sur les OMD, le Maroc officiel présente un bilan en demi-teinte. Il considère qu’il a déjà atteint les valeurs cibles dans la lutte contre la pauvreté et la faim: la pauvreté à un PPA serait presque éradiquée, les pauvretés alimentaire, absolue et relative seraient sensiblement réduites. Dans d’autres domaines, la vitesse des avancées réalisées annonce la réalisation des valeurs cibles avant l’horizon 2015: la généralisation de l’enseignement de base, la réduction de la mortalité infantile, l’accouchement en milieu surveillé, l’éradication des maladies contagieuses et l’élargissement de l’accès à l’eau potable.
Le défi serait de faire face à la lenteur des tendances affichées dans d’autres domaines : l’alphabétisation des jeunes et l’égalité des chances de scolarisation entre les sexes, la mortalité maternelle, l’équité de la répartition sociale des niveaux de vie. Dans la perspective de pérenniser les acquis et de réaliser l’ensemble des OMD d’ici 2015, la politique publique met en avant la nécessité de renforcer l’INDH. En principe, un tel cadre d’action devait permettre d’éviter les lourdeurs administratives en vue de produire, dans le cadre d’une démarche partenariale, des réponses concrètes par la voie de projets plus ou moins intégrés touchant des territoires et des catégories d’individus. Mais, en pratique, le dispositif reste largement empirique. Il a répondu, du moins dans sa première phase, d’abord et avant tout à une logique de l’urgence. Il a reposé très largement sur la mise en place d’actions exceptionnelles, des interventions complémentaires, réparatrices de l’action publique. La question de la convergence avec les autres programmes publics montre combien les modalités de l’institutionnalisation actuelle de ce dispositif laissent à ce jour encore en suspens la question de son ancrage durable et lisible dans les champs de l’action publique en matière de développement social. Autrement dit, le nouvel élan de ce dispositif est tributaire de son réajustement et de la mobilisation convergente et future des acteurs publics, politiques et sociaux. Manifestement c’est cette capacité de mobilisation qui a été la marque de réussite de l’expérience brésilienne dans la lutte contre la pauvreté. Luiz Inacio Lula Da Silava, l’ancien ouvrier tourneur, ayant accédé aux plus hautes fonctions de l’Etat, va bientôt tirer sa révérence. Sous sa législature, la pauvreté a reculé de façon très significative au Brésil. La politique de la pauvreté a été érigée au rang de priorité. Un programme d’une grande ampleur : 17 milliards d’euros, soit 1,4% du PIB, un ministère de développement social et de lutte contre la faim, le troisième le mieux doté du pays après la Prévoyance et la Santé. 12,4 millions de ménages ont accès à la Bolsa familia (Bourse familiale), une allocation mensuelle versée aux familles les plus pauvres, à condition que leurs enfants soient scolarisés et qu’ils disposent d’un carnet de vaccination à jour. Un programme qui a joué un rôle crucial dans la diminution du travail des enfants. La malnutrition infantile a baissé de 62% entre 2003 et 2008. L’augmentation du salaire minimum : + 74% (inflation déduite) entre 2003 et 2010 n’a pas pénalisé l’emploi. Bien au contraire, sur la même période, 12 millions de postes ont été créés dans le secteur formel. Couplée à un accès facilité au crédit pour les classes populaires, cette politique a permis de doper la consommation intérieure, devenue l’un des principaux moteurs de la croissance brésilienne. Pourtant, au grand dam de l’aile gauche de ses supporters, Lula a suivi une politique macroéconomique résolument orthodoxe. Mais l’austérité budgétaire que s’est imposé son gouvernement ne l’a pas pour autant dispensé de mettre en œuvre des réformes sociales vigoureuses. Sa popularité est restée sans faille, son mythe n’a pas pris de ride. Son bilan plaide pour lui. Un résultat certes lié à une conjoncture économique favorable mais aussi à des politiques volontaristes et adaptées.

