Idées
Les malaises de la France
La France s’est ressaisie pour éviter de confier quelques- unes de ses régions au Front national. Mais ne nous détrompons pas, la poussée du populisme sur la scène française est réelle.
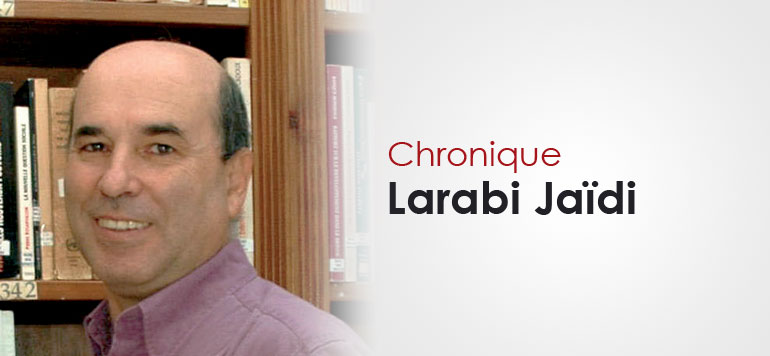
Elle est révélatrice du malaise français. Un malaise sur plusieurs fronts : identitaire bien sûr mais aussi démocratique, social et géopolitique. En effet, la montée du Front national reflète un malaise identitaire ambiant auquel il propose une vision «rassurante» de l’identité nationale façonnée par l’histoire et un ensemble de valeurs culturelles transmises par héritage. Le Front national se singularise par un discours sur l’imminence de l’extinction identitaire de la France. Face à cette menace, ce courant politique offre une vision de l’identité fermée aux influences étrangères et conçue comme une membrane de protection vis-à-vis de l’extérieur. Par conséquent, cette identité est fragile puisque sans cesse menacée d’altération au contact des autres. Cette vision identitaire, aussi séduisante pour une partie de l’opinion publique que trompeuse, se nourrit de diverses difficultés de la France.
Le malaise de la France est aussi un malaise démocratique reflet de la crise de la représentation. La coupure entre les citoyens et les élus est devenue un constat récurrent. L’augmentation continue de l’abstention est la meilleure illustration de ce mal qui s’exprime au quotidien dans le rapport des Français avec leurs institutions et leurs représentants. Les Français se montrent très critiques à l’égard du fonctionnement de la démocratie dans leur pays. D’après un récent sondage de Sofres, près des deux tiers des Français (64%) considèrent que «la démocratie fonctionne mal en France», un sur quatre (24%) jugeant même qu’elle fonctionne «très mal». Seuls 36% des citoyens pensent que le fonctionnement démocratique est satisfaisant, avec, dans le détail, 4% des répondants uniquement qui le qualifient de «très bon». D’autres indices témoignent que les perceptions restent majoritairement négatives comme l’érosion continue de la confiance à l’égard de l’institution présidentielle en France. Toute la classe politique française est affectée. Les partis politiques jouissent ainsi d’une très mauvaise image, davantage que les institutions elles-mêmes, qui sont pourtant souvent décrédibilisées. La profondeur du malaise social est aussi un autre aspect de la France d’aujourd’hui. Une société en état de fatigue psychique, de stress. Les Français ont le sentiment que la qualité des relations sociales s’est dégradée. Une société qui d’un côté a une méfiance généralisée envers les élites, tenues pour responsables d’une dégradation générale, de l’autre, «des logiques corporatistes», où chaque groupe professionnel essaye de tirer au mieux parti du bien public. La France se demande si l’ascenseur social continue à offrir des chances de promotion aux méritants, ou s’il est bloqué au bénéfice des élites. Le malaise européen de la France est aussi d’un autre genre. La France a fait un pari : transformer l’Europe communautaire en un multiplicateur de la puissance française dans le monde, un substitut à l’empire colonial perdu. Les élargissements successifs ont contribué à réduire le poids relatif de la France et ses ambitions. Chacun sait que la France est un pays fondateur de la Communauté européenne du charbon et de l’acier (CECA, 1951) puis de la Communauté économique européenne (CEE, 1957). Le général de Gaulle y ajouta même un objectif : faire de la construction européenne un moyen de ligoter l’Allemagne fédérale et de contester les velléités hégémoniques des Etats-Unis. L’UE fut longtemps fantasmée à Paris comme une caisse de résonance de ses desiderata. Lentement mais sûrement, l’Allemagne est parvenue à ses fins. Elle voulait une Europe élargie et libérale, elle l’a obtenue. A chaque étape, elle a su faire coïncider les progrès de l’Europe avec ceux de son émancipation nationale et de son retour sur la scène internationale. Côté français, cette situation produit un profond malaise. La France est moins puissante politiquement dans l’UE parce qu’elle est moins puissante économiquement en Europe. La France a perdu la centralité qui était sa caractéristique en Europe. Centralité géographique, perdue à la faveur des élargissements successifs qui ont déplacé vers le centre-est le centre de gravité de l’UE. Centralité politique, à travers les jeux d’alliances, où la position de la France est devenue plus inconfortable.
Dans ce contexte, les Français sont archi-pessimistes quant à l’avenir de leur pays. La question, c’est de savoir si la société française peut conserver son dynamisme d’antan, sa vitalité, ou si, paralysée par la peur de l’avenir, elle aura tendance à se recroqueviller. L’islam sert de «révélateur» des problèmes d’identité politique et sociale de la société pluraliste française. L’altérité de l’islam, perçue et construite comme un danger, appelle ces sociétés à y répondre de manière rationnelle plutôt qu’émotionnelle. En rendre compte permettra à la fois de ne plus reporter ce malaise sur une minorité et sa religion. Face à l’opération de séduction conduite par le Front national, les libéraux et les socialistes sont confrontés à cette tâche de déconstruire cette conception de l’identité en critiquant le substrat ethnique qui la définit, mais encore de faire valoir une vision de la France fière d’elle-même, de son héritage et, plus encore, de son action et des valeurs politiques qui la singularisent.

