Idées
Les leçons des coulisses de Bercy
Qu’il s’agisse du ministère de l’économie et des finances ou d’autres ministères, l’opacité n’est plus de mise, elle autorise tous les écarts
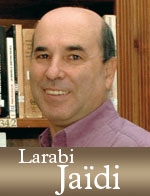
Les récents échanges tendus entre notre ministre des finances et les parlementaires ont montré que l’exigence de transparence à l’égard de l’utilisation des moyens financiers mis à la disposition des pouvoirs publics se faisait de plus en plus pressante. Ce n’est plus le cas en ce qui concerne les rémunérations payées sur deniers publics, et dans lesquels sont dénoncées l’opacité caractérisant la gestion des traitements et rémunérations accessoires des fonctionnaires. C’est encore plus largement le cas de l’usage fait des comptes spéciaux du Trésor. Notre administration a hérité de l’administration française une partie de ses pratiques de fonctionnement. Il est utile d’avoir à l’esprit les mesures de réformes prises par l’administration française, plus particulièrement celles des finances pour s’affranchir de quelques-uns de ses travers.
Dans son ouvrage «Les coulisses de Bercy : le cinquième pouvoir», Jean Arthuis, ministre de l’économie et des finances de la France à la fin des années 90, levait un coin de voile sur le fonctionnement de cette citadelle, «prodigieux réservoir de compétence et symbole de l’autorité péremptoire». Dans son passionnant témoignage, il a éclairé les coulisses obscures et déconcertantes d’un des plus flamboyants ministères de l’Etat français. Conscient que les salaires dans la fonction publique restent un sujet tabou, convaincu que Bercy doit prétendre à l’exemplarité dans la transparence des rémunérations et les primes de son personnel, il demande à son arrivée à la tête de ce département la liste des 250 bénéficiaires des plus hautes rémunérations versées par son ministère. Il lui a été répondu, à son étonnement, qu’un tel document n’existe pas. Il est contraint de rappeler sa commande une dizaine de fois pour obtenir enfin, après de longs mois d’attente, un document imprimé sur papier spécial non photocopiable, comprenant une liste de bénéficiaires et de leur rémunération, primes incluses. Il a fallu encore attendre des années pour que le Conseil constitutionnel demande formellement la réintégration de ces fonds dans le budget.
Sur un registre similaire, en 2001, Lionel Jospin, Premier ministre français, demandait à François Logerot, Premier président de la Cour des comptes d’établir à son attention une note relative au régime des fonds spéciaux. La note a recommandé la réintégration de la partie des crédits des fonds spéciaux sur lesquels s’imputent des rémunérations accessoires ou des dépenses de fonctionnement dans des chapitres ordinaires du budget général. Cette réintégration permettrait d’assainir le débat sur la transparence de ces fonds et d’apporter plus de clarté dans la gestion de l’appareil gouvernemental. La note recommandait aussi que la nécessité pour un Etat de pouvoir conduire dans le secret l’action de protection de la sécurité intérieure et extérieure de la collectivité nationale n’est pas l’objet de sérieuses contestations, pas plus en France que dans les autres démocraties. La justification d’un régime budgétaire et comptable dérogatoire appliqué à une partie des crédits dont bénéficient les services chargés des missions de renseignement n’a d’ailleurs jamais été mise en cause dans les débats parlementaires.
On peut convenir à la lumière de ces deux cas qu’un réexamen du périmètre des fonds spéciaux s’est s’imposé. Force est de constater qu’au Maroc cette révision n’a jamais été entreprise, malgré les recommandations des organismes internationaux, les critiques périodiquement reprises par les médias. Mais le contexte actuel de la réforme de la loi organique des finances rend cette révision sans doute plus nécessaire. Tout d’abord, il n’y a aucune raison que la protection et le secret dont bénéficient les opérations liées à la sécurité (et plus généralement aux intérêts supérieurs de la Nation) couvrent également la totalité des dépenses sur fonds spéciaux. La distribution de rémunérations complémentaires non déclarées constitue une irrégularité choquante dès lors qu’il s’agit de compléments de rémunérations versés à des agents publics, sur fonds publics, en dehors de toutes règles et de tous contrôles. Ensuite, à la nécessité d’une meilleure transparence s’ajoute l’intérêt qui s’attache à combattre la suspicion persistante quant à l’utilisation possible des fonds spéciaux pour financer directement ou indirectement des activités de nature politique. Enfin, le reclassement des lignes budgétaires des crédits répond à l’exigence d’une modernisation de la gestion publique, dont le projet de la nouvelle loi organique relative aux lois de finances marque une étape importante. Ses dispositions nouvelles ont pour but de renforcer les droits d’information et de contrôle du Parlement. Qu’il s’agisse du ministère de l’économie et des finances ou d’autres ministères, l’opacité n’est plus de mise, elle autorise tous les écarts. Le débat ne doit plus porter sur les dysfonctionnements de l’administration mais sur les grands enjeux de société. La politique a besoin de vérité. C’est alors que le changement devient possible.
Au nom d’une double exigence de secret et de souplesse de gestion, les dérogations aux règles budgétaires et comptables qui caractérisent le régime des fonds spéciaux, et qui découlent des modalités de gestion sont très importantes ; leur champ d’application est conçu de manière très large et excède ce qui apparaît strictement nécessaire. Les délégataires du Premier ministre (ou des ministres pour la part qui leur est allouée) cumulent en fait les fonctions d’ordonnateur et de comptable comme le permet une gestion purement privée.
Le célèbre rapport Jouahri rédigé en 1983 est introuvable. Son contenu n’est sans doute plus d’actualité.

