Idées
Les jeunes en mal d’emploi
malgré l’insertion du Maroc dans l’économie mondiale, l’emploi est de nature locale. Il existe des marchés locaux et non pas un seul marché global. C’est en ce sens qu’il faut passer à des plans d’action locaux de l’emploi impliquant les divers acteurs locaux.
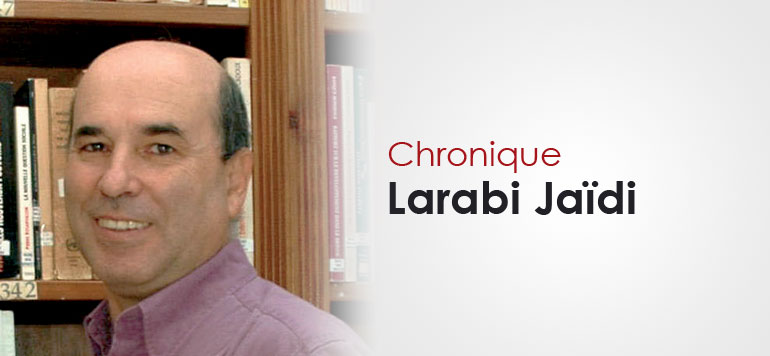
La situation des jeunes, aujourd’hui, et leurs perspectives d’avenir constituent une préoccupation essentielle. Les raisons de s’en préoccuper sont manifestes : de nombreux jeunes quittent le système éducatif sans avoir acquis les qualifications ou les compétences dont ils auraient besoin dans l’économie et la société. La situation apparaît préoccupante pour les jeunes non scolarisés comme pour les diplômés. Pourtant, diverses politiques publiques pour faire face à la montée du chômage des jeunes ont été mises en œuvre.
L’importance des ressources publiques consacrées aux dispositifs et actions en faveur de l’emploi des jeunes requiert une évaluation comparée de leurs impacts à l’aune des objectifs qui leur sont assignés. En effet, d’importants efforts ont été déployés pour donner un contenu à ces dispositifs. Il s’agit en particulier de l’encouragement des jeunes à créer leurs propres entreprises et de l’appui à la formation – insertion des jeunes diplômés dans la vie active. Ces dispositifs ne visent pas à indemniser les victimes du chômage (dépenses dites passives) mais à compléter la politique macro-économique dont l’objectif principal est de soutenir la croissance (dépenses dites «actives»). Quatre types d’objectifs justifiant la mise en œuvre de ces objectifs : rendre la croissance plus riche en emplois ; aider les entreprises à améliorer la qualification des emplois par la formation continue; lutter contre la «sélectivité» du marché du travail en centrant certaines mesures sur des publics cibles réputés moins employables. Le mécanisme privilégié par les dispositifs ciblés ou d’ordre général de la politique de l’emploi est essentiellement la réduction du coût relatif du travail et principalement le travail qualifié des diplômés. Les politiques actives de l’emploi semblent centrées sur le segment du marché du travail des diplômés de niveau supérieur. Elles portent sur les deux principaux fronts du marché du travail que sont la demande et l’offre. Du côté demande de travail, leur finalité consiste en la promotion de la demande en provenance du secteur privé. Les mesures prises à cet égard concernent à la fois l’auto-emploi et l’insertion par les stages dans des entreprises existantes. Du côté offre de travail, les actions menées visent à améliorer l’employabilité des jeunes diplômés en cherchant à combler le déficit de leurs formations et à les rapprocher d’autant des besoins des entreprises. Au-delà du fait qu’elles s’adressent à des jeunes diplômés, les politiques mises en œuvre sont peu ciblées, ce qui participe de leur inefficacité, notamment en augmentant les risques d’opportunisme des candidats mais surtout des entreprises. Ces politiques qui se focalisent sur le marché du travail des jeunes diplômés font abstraction des interactions qui existent entre celui-ci et le marché du travail des sans-diplômes (et de ceux ayant un faible niveau d’instruction). Or, de telles interactions existent à l’évidence et un certain degré de substituabilité existe entre ces catégories, d’autant que les entreprises peuvent parfois préférer un sans-diplôme avec une expérience professionnelle à un diplômé sans aucune expérience et doté d’une formation théorique loin de ses préoccupations. Les politiques actuelles négligent d’autres composantes de la population jeune qui se trouvent dans des situations difficiles pour des raisons autres que le diplôme. Il s’agit là des problèmes de discrimination sexuelle, de sous-emploi, d’emploi informel, de handicaps et des diverses formes de travail inadéquat ou indécent.
Les politiques publiques d’emploi souffrent de la dispersion et du manque de coordination entre ses différents intervenants publics. C’est ainsi que nombre d’actions, axées sur la relation formation-emploi, sont distribuées entre divers ministères et départements.
Les conséquences d’une telle inertie sont lourdes, la première d’entre elles étant l’absence de coordination entre différents acteurs publics, un problème qui engendre une grande inefficacité des dispositifs mis en œuvre. Elles se font sentir aussi dans le manque de suivi et d’évaluation au sein des instances impliquées et concernées par les différentes mesures appliquées. C’est en ce sens que la création d’un observatoire de l’emploi est de grande importance. Mais, là encore, de nombreux projets annonçaient la création d’un tel observatoire, sauf que ces annonces n’ont pas été suivies d’effet.
La dimension locale et territoriale n’est pas prise en compte dans les politiques d’emploi. Or, malgré l’insertion marocaine dans l’économie mondiale, l’emploi est de nature locale. Il existe des marchés locaux et non pas un seul marché global. C’est en ce sens qu’il faut passer à des plans d’action locaux de l’emploi impliquant les divers acteurs locaux, publics (y compris les universités et instituts de formation et les Centres régionaux d’investissement) ou non (y compris les ONG) afin de réfléchir et d’agir de concert, tout en s’appuyant sur les réalités locales. A cet égard, le nouveau code du travail instaure, en plus d’un Conseil supérieur de l’emploi, des Conseils régionaux et provinciaux. Ces instances n’existent pas encore dans les faits. Une forte coordination s’avère nécessaire entre le ministère de l’emploi (Direction de l’emploi), l’ANAPEC et les Directions de l’aménagement du territoire et des collectivités locales qui semblent favorables à une politique territoriale de l’emploi. Les dispositifs et mesures pour l’emploi des jeunes ont connu de nombreuses variations au cours de ces dernières années, ce qui traduit une volonté de les adapter en permanence aux besoins de la population active. Pour améliorer leur lisibilité, il convient de les stabiliser. C’est aussi la condition de leur efficacité.

