Idées
Les femmes entre le politique et le domestique
même lentement et même si rien n’est jamais définitivement acquis,
la société évolue en faveur
des femmes. La lenteur s’explique probablement par l’importance des enjeux :
il s’agit du cÅ“ur du pouvoir. Mais elle est aussi en partie due aux limites
des politiques publiques dans ces domaines.
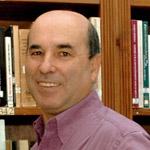
La marche des femmes marocaines vers l’égalité est trop lente. Le temps de mesures plus volontaristes n’est-il pas venu, afin de promouvoir leur place dans la société ? Notre société est constitutionnellement fondée sur la notion d’égalité des droits. Pourtant, tous les chiffres indiquent que les inégalités entre hommes et femmes persistent à un niveau élevé. Les femmes nées au début des années 60 n’ont bien sûr pas eu les mêmes parcours scolaires que celles qui arrivent aujourd’hui dans le monde du travail, mais le niveau de formation des jeunes hommes dépasse toujours celui des jeunes filles. De plus en plus de professions se sont ouvertes aux femmes mais le haut de la hiérarchie du pouvoir (postes de direction, conseils d’administration…) leur demeure largement fermé, dans le privé comme dans le public. Les femmes sont rémunérées en moyenne un quart de moins que les hommes. Pour partie, cette différence s’explique par la nature des emplois occupés par les femmes, le plus souvent moins qualifiés, donc moins bien rémunérés. Le chômage frappe davantage les personnes qui ont le moins de cartes en main : les jeunes et les femmes. Un contexte peu favorable à une plus grande répartition du pouvoir, même si les femmes ont continué à progresser en faisant valoir leurs diplômes.
Dans les foyers, les tâches sont encore bien peu partagées. L’activité domestique représente plus de huit heures par couple et par jour. Le temps qu’y consacrent les hommes est insignifiant. La tâche la moins gratifiante dans laquelle les hommes s’impliquent consiste à faire les courses et du bricolage. Dans tous les autres domaines, la part réalisée par les hommes ne bouge quasiment pas : ils ne font pas plus le ménage, la cuisine ou la vaisselle et ne s’occupent pas davantage du linge. Pourquoi si peu d’évolution ? La famille demeure une instance de reproduction dans le temps des rôles entre filles et garçons, en leur attribuant des places bien différenciées. De l’école au monde du travail, en passant par les médias, un ensemble d’institutions façonnent les rapports entre les hommes et les femmes. De nombreux mécanismes symboliques tentent de faire passer pour naturelles des différences qui placent les femmes en situation de dominées. Le décalage est donc grand entre l’idéal d’égalité et la réalité quotidienne. Les transformations ne peuvent être que lentes, parce qu’elles touchent des éléments essentiels de l’organisation de notre société. La situation dominée des femmes est le résultat d’un long processus d’intériorisation, souvent symbolique, qui les conduit à considérer comme légitime la domination masculine. Les hommes, eux, cèdent difficilement un terrain que leur socialisation pousse à considérer comme naturellement conquis. Pourtant, même lentement et même si rien n’est jamais définitivement acquis, la société évolue en faveur des femmes. La lenteur s’explique probablement par l’importance des enjeux : il s’agit du cœur du pouvoir. Mais elle est aussi en partie due aux limites des politiques publiques dans ces domaines.
La persistance et l’ampleur de l’inégalité des sexes font rebondir le débat autour de politiques publiques plus actives. Depuis le début des années 80, la cause féminine est quasiment présente dans l’agenda politique au Maroc. Elle réapparaît, aujourd’hui, sous la forme de la représentation de la femme dans les élections communales de juin prochain. Pour certains, le système des quotas n’est pas sans inconvénients : le principe d’égalité exige, en effet, qu’on ne prenne pas en compte les particularités individuelles. Un tel système ouvrirait aussi la voie à des demandes de la part d’autres catégories de population également sous-représentées. Pour d’autres -et j’en fais partie-, le prix à payer semble relativement faible au regard de l’enjeu. La féminisation de la classe politique paraît bien être la clé d’une meilleure prise en compte de la situation des femmes. Le débat sur la représentation politique des femmes ne doit pas masquer celui aussi fondamentale des politiques publiques favorisant l’égalité entre hommes et femmes. L’allocation des financements publics devrait être examinée à la lumière de son impact sur l’insertion des femmes dans le marché du travail. Rien n’a été fait pour réduire la charge de la double journée (professionnelle et domestique) des femmes, l’une des raisons de leur faible investissement dans la sphère politique. Le système du quota en politique peut déboucher sur des changements sociaux de fond. S’il permet aux femmes de mieux faire entendre leur voix. Il restera beaucoup à faire, que ce soit dans le monde professionnel ou dans l’univers domestique. Car la superwoman qui mène de front une carrière professionnelle exaltante et une vie familiale épanouie est plus présente dans les publicités que dans la réalité. Mais le rééquilibrage des pouvoirs ne doit pas empêcher de s’interroger sur les inégalités qui existent entre les femmes. A commencer par l’inégalité des positions sociales. Au bout du compte, l’égalité réelle suppose de s’attaquer non seulement à la domination masculine, mais aussi au poids des hiérarchies sociales.
