Idées
Leçons pour une rupture
La rupture. Ce terme fort du discours royal à l’occasion du quarantième anniversaire de la marche verte résume une page de l’histoire et annonce une nouvelle approche du développement des provinces sahariennes.
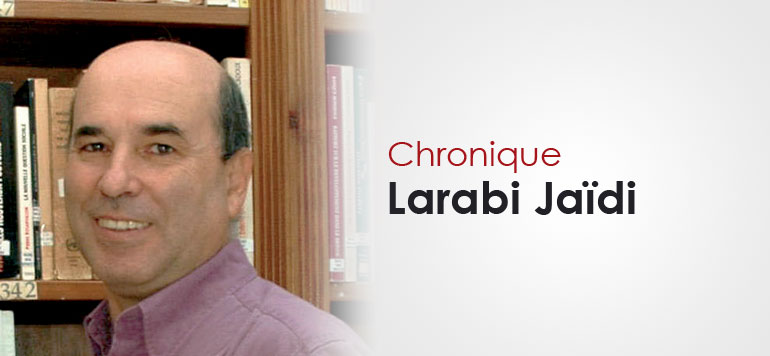
Un nouveau modèle de développement se dessine en perspective. Cela signifie que des leçons ont été tirées de ce presque demi-siècle d’une politique d’intégration qui a concrétisé des acquis indéniables mais qui a aussi souffert d’effets pervers générés par une gestion centralisée, sécuritaire et clientéliste du développement de ces territoires. Aujourd’hui, le Maroc s’apprête à injecter des ressources considérables pour parfaire l’intégration de ces provinces. L’Etat a joué un rôle majeur dans la structuration et le développement du territoire, par l’intermédiaire d’investissements et d’aides publiques de grande ampleur. Des ressources publiques importantes ont été affectées au développement des provinces du Sud, faisant de ces régions le 3e récipiendaire d’investissements publics par habitant (1,5 fois la moyenne nationale). L’impact quantitatif de cette politique publique se lit dans les statistiques relatives aux réalisations en équipements. Qu’il s’agisse du réseau routier, des infrastructures aéroportuaire et portuaire, du logement, du réseau d’eau potable, de l’électrification, de l’assainissement ou encore l’accès à l’éducation et à la santé, le taux de couverture dans toutes les provinces sahariennes est bien supérieur à la moyenne nationale.
Néanmoins, des inégalités territoriales indiquent que le développement économique n’a pas été accompagné par un aménagement harmonieux du territoire. Le développement local en cohérence avec les vocations et potentiel économiques des régions et provinces reste toujours à l’ordre du jour. Il en est de même du désenclavement du territoire et de l’amélioration de la connectivité nationale et internationale. Au-delà des investissements, le territoire a été également le premier bénéficiaire d’aides sociales. Ces investissements et aides publics ont eu un impact très positif sur le développement social du territoire, aujourd’hui dans le top 3 national des indicateurs sociaux (IDH, taux d’alphabétisation et taux de pauvreté). Ils ont également permis d’assurer une croissance économique soutenue de 5 à 6% par an. Un bémol: le niveau élevé de chômage, en particulier auprès des jeunes Sahraouis détenteurs de formations moyennes et élevées (33% et 41%), est symptomatique des limites du modèle de développement actuel, et constitue de surcroît l’un des principaux facteurs de tension sociale. Par ailleurs, les mécanismes d’aide sociale et d’assistanat ont créé des réflexes de rente chez les populations locales.
Dans la longue durée, l’action publique de l’Etat a révélé des défaillances dans la gouvernance des programmes publics, qui se sont manifestées notamment dans l’absence d’une vision globale, d’unité d’action et d’une ouverture sur la société civile. Aujourd’hui, la réflexion stratégique a abouti à l’élaboration d’un programme sur dix ans permettant d’orienter l’action de l’Etat, des établissements publics, du privé et des collectivités locales selon une vision globale essentielle à la conduite efficace des politiques publiques de l’Etat dans les provinces du sud. Il est néanmoins nécessaire de définir un lieu de concertation et de délibération entre l’Etat et les acteurs économiques et sociaux pour la mise en œuvre de ce plan, un lieu de pilotage à long terme de la politique de développement de ces territoires. Hier, l’Etat se voulait le garant d’une offre en termes de renforcement des capacités infrastructurelles par l’action publique impulsée et gérée par le haut. Mais, paradoxalement, l’action publique dans les provinces du sud a souffert du défaut d’un exécutif fort, qui fixe des objectifs clairs en termes de politiques interministérielles et d’optimisation des moyens de la gestion publique.
Aujourd’hui la déconcentration s’impose pour développer, au plan local, les synergies interministérielles et éviter ainsi que la spécialisation ministérielle n’érige des barrières entre les administrations. Hier l’Etat pesait d’un poids capital sur les collectivités locales qui n’avaient aucune maîtrise des règles du jeu. Aujourd’hui la régionalisation donne de nouvelles compétences aux instances élues et appelle à leur responsabilisation. Hier, l’Autorité locale s’appuyait et reproduisait un système notabilaire, relais par lequel s’établissait le rapport à la société locale. La sélection des élites locales était fondée sur leur statut et leur capacité à mobiliser les membres de leur tribu. Ils bénéficiaient en contrepartie d’avantages accordés par l’administration. Les conduites clientélistes ont fini par affaiblir l’autorité légitime des institutions. Les partis politiques se sont réduits à des machines électoralistes à la recherche d’accès aux ressources publiques. Ils ont perdu leur fonction d’instances de socialisation politique. Aujourd’hui, ce mode de gouvernance a révélé ses limites. La capacité de mobilisation des notables devient de plus en plus limitée face à de nouvelles résistances sociales, surtout de la jeunesse, malgré la persistance du clientélisme.
Ainsi, aujourd’hui, il ne s’agit pas tout simplement de fixer des objectifs quantitatifs de développement. L’enjeu du nouveau modèle réside dans sa capacité à rendre ses orientations et programmes plus lisibles pour l’ensemble des acteurs économiques et sociaux; d’anticiper les stratégies individuelles et d’élaborer avec l’ensemble des acteurs concernés des politiques globales et cohérentes et veiller à ce qu’elles soient mises en œuvre avec continuité et régulièrement évaluées, d’éclairer les enjeux porteurs de risques et de travailler à une meilleure intelligence des évolutions économiques et sociales.

