Idées
Le printemps arabe, la gauche marocaine et la conduite des réformes
Les véritables défis actuels de la gauche résident dans son unification afin de focaliser ses efforts, non pas sur des querelles de positionnement, mais sur la mise en place d’une véritable stratégie de changement social.
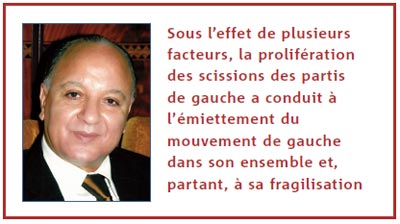
Le sursaut des jeunes marocains du 20 Février interpelle fortement les partis politiques et, plus précisément, la gauche marocaine. Son rôle dans la conduite des réformes revendiquées est, aujourd’hui, historique si elle parvient à se dessaisir à la fois de ses «déviations carriéristes» ainsi que de son «jeunisme démagogique». La résurgence des sociétés civiles dans le monde arabe, l’espoir et les inquiétudes que ce réveil suscite quant à ses implications politiques, économiques et sociales sur le quotidien des citoyens, interpellent les élites politiques, notamment de gauche au regard de leur responsabilité historique dans le changement social.
Au-delà de l’euphorie engendrée par le vent de libertés qui annonce un printemps arabe, l’enclenchement du processus de réformes devant y conduire semble plus problématique. La démocratie, et plus précisément la liberté et l’égalité des chances qui la fondent, ne peuvent être décrétées à travers le changement de textes de loi. De même, la liberté qui n’améliore pas le quotidien des citoyens conduit rapidement à la désillusion. La démocratie est un vecteur d’efficience institutionnelle qui est supposé générer le mieux-être des populations. Aussi, la revendication de la liberté par les populations au sein du monde arabe aurait-elle toutes les chances de déboucher sur un processus vertueux si elle est l’expression d’une vision claire de changement social portée par des forces politiques de progrès. Dans cette perspective, l’existence d’un système de négociation institutionnelle qui fonctionne constitue un atout pour une transition pacifique vers la démocratie.
Ainsi les possibilités de construction démocratique offertes dans le monde arabe dépendent des capacités institutionnelles des forces politiques de changement en présence. En Egypte et en Tunisie, la pression pour le départ des deux présidents n’a pas encore abouti à un changement des régimes politiques en place. Dans les deux cas, l’inexistence d’un système de régulation institutionnelle de l’action politique et la faiblesse des forces politiques alternatives semblent compliquer le démarrage d’un véritable processus de construction démocratique. Dans les deux cas, le peuple continue d’exercer la pression nécessaire sur les gouvernants mais la conduite des réformes et la maîtrise du changement constituent le problème majeur.
Au Maroc, l’ancrage sociétal de la gauche a, contrairement à d’autres pays arabes, conduit à des luttes politiques continues en vue du développement des espaces de libertés publiques. Cette confrontation entre la gauche marocaine et le régime politique en place a abouti, à partir des années 1970, à l’institutionnalisation de l’action politique où la négociation entre les acteurs allait désormais conditionner l’évolution du système politique. Au cours des décennies 70 et 80, un tel processus de confrontation/négociation allait générer une évolution institutionnelle contrastée, où des avancées discontinues coexistaient avec des mouvements de reflux politique, en fonction des rapports de force.
Cependant, à partir des années 1990, l’institutionnalisation de l’action politique en cours, l’ébranlement du référentiel idéologique de la gauche à travers le monde et l’émiettement des principaux partis installaient la gauche marocaine dans une crise profonde d’identité.
Une crise due aussi à des considérations subjectives liées au processus d’émiettement politique qui a affecté la gauche marocaine, à sa compromission par le bilan d’une expérience non maîtrisée de l’alternance, et, enfin, à la déconnexion de son discours et de sa pratique politiques par rapport aux mutations sociales profondes d’un Maroc en pleine transition démographique.
1- L’ébranlement du référentiel idéologique de la gauche
L’effritement du «monde socialiste», à la suite de l’éclatement de l’URSS, de la chute du mur de Berlin et de la déviation capitaliste de la Chine, au profit d’un renforcement sans précédent de l’économie capitaliste mondiale a apporté un démenti cinglant aux prévisions marxistes-léninistes et aux fondements idéologiques qui faisaient la force de la gauche à travers le monde.
2- Le déficit de la démocratie interne et l’impatience du «jeunisme de gauche»
Au Maroc, sous l’effet de plusieurs facteurs, la prolifération des scissions des partis de gauche a conduit à l’émiettement du mouvement de gauche dans son ensemble et, partant, à sa fragilisation. PADS, CNI, PSU, Parti travailliste, Voie démocratique, FFD sont tous des partis politiques sortis des entrailles soit de l’USFP, soit du Parti communiste marocain (PPS).
Certes, la réflexion n’a pas été suffisamment axée sur les causes explicatives d’un tel processus de segmentation du mouvement de gauche. Mais, l’évocation, très fréquente, de la «surcapacité du régime» à diviser le mouvement politique d’opposition ne semble pas résister à l’analyse endogène de la genèse de la plupart des nouveaux partis de gauche. Le déficit de démocratie interne au sein des partis d’origine, combiné à l’impatience d’un «jeunisme de gauche» expliquent, également, cette tendance à la «diaspora» de la gauche marocaine.
En effet, et paradoxalement, bien avant l’avènement de l’alternance, la gauche marocaine avait subi de nombreuses scissions. Au sein de l’USFP, la raison majeure est liée à la dominance numérique et idéologique, d’un mouvement politique en faveur d’un compromis avec le pouvoir en vue d’une plus grande participation institutionnelle du parti à la gestion des affaires publiques. Les opposants à un tel scénario, adeptes de réformes constitutionnelles préalables à toute participation, ne trouvaient pas les vecteurs organisationnels nécessaires à leur pleine expression, car la direction du parti interdisait l’existence de tendances opposées au sein de l’USFP. Face à l’impatience croissante des éléments opposants, le déficit de démocratie interne conduira à une véritable diaspora de la gauche marocaine.
Certes, la responsabilité est à rechercher dans les pratiques démocratiques au sein du parti. Mais elle est aussi partagée par le «jeunisme de gauche» des opposants qui, en dépit de leur sincérité politique, sont restés prisonniers d’une vision de gauche, doctrinalement confortable, mais déconnectée par rapport aux mutations de la société et à la réalité du pouvoir au Maroc.
Cette lecture ne vise nullement à justifier la pertinence historique de l’alternance ni la compromission de la gauche sur laquelle une telle expérience a débouché. La lecture proposée essaie de montrer, au contraire, que si l’avènement de l’alternance s’expliquait par l’urgence historique d’un compromis, entre la gauche et le régime politique, afin d’éviter une crise économique, politique et sociale qui allait déstabiliser le pays, l’expérience de l’alternance a souffert de l’absence d’un projet de réformes de gauche, et surtout de l’absence de courage et de clarté politiques face aux tentatives de compromission notamment depuis 2002, où la participation de la gauche au gouvernement n’avait plus de sens politique.
Aujourd’hui, les grands partis de gauche sont érodés par une participation au gouvernement qui les associe dans la mise en œuvre d’une politique libérale de droite où leur impact, en tant que force de gauche, devient insignifiant.
Les positions politiques de ces partis sont de plus en plus motivées par des «stratégies carriéristes» de leur direction, ce qui les éloigne davantage de leurs bases traditionnelles et du projet de changement social qui fondait leur légitimité.
Les autres partis de gauche naissants se sont installés dans un «confort intellectuel» mais sans un véritable impact sur le changement social. Dans leur vision politique, objectifs et stratégie sont confondus. Les réformes constitutionnelles qui devraient conduire à l’avènement de la monarchie parlementaire constituent un simple objectif. La stratégie ainsi que la pratique politiques qui sont supposées aboutir au renforcement des institutions, voire à l’émergence d’un Parlement fort et efficient, ne sont nullement initiées par la nouvelle gauche marocaine. Bien plus, leur discours comprend des revendications contradictoires :
– d’une part, la dénonciation des élites politiques présentes au sein des institutions, dont le Parlement;
– et, d’autre part, la nécessité de transférer une partie du pouvoir du Roi au profit du Parlement et du gouvernement.
Or, si les élites compromises souffrent d’une incapacité institutionnelle, la monarchie serait une aubaine car elle garantit l’efficience et la stabilité à un système politique, certes déséquilibré, mais qui souffre des retards enregistrés par la mise à niveau des élites et des institutions. Dès lors, les véritables défis actuels de la gauche résident dans son unification afin de focaliser ses efforts, non pas sur des querelles de positionnement, mais sur la mise en place d’une véritable stratégie de changement social.
