Idées
Le malentendu linguistique
il n’est pas aisé de lancer un débat sur la langue sans que cela ne touche l’ensemble des structures identitaires. D’où la circonspection dont doivent faire preuve ceux qui ont mal engagé les termes
du débat
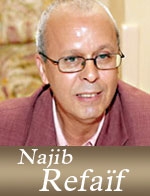
Il y a quelques semaines on s’inquiétait, ici dans cette même chronique, du peu de cas que l’on faisait d’une question fondamentale dans le débat autour de l’enseignement: celle de la langue arabe et du dialecte marocain ou «darija». On avait titré alors sur la faible teneur d’un débat à bas débit, mais fort heureusement, les choses se sont enclenchées très vite et sur un rythme effréné, tant et si bien que ledit débat a pris, et continue à prendre à ce jour, une toute autre tournure. D’emblée, certains ont choisi l’invective et cloué au pilori ceux qui avaient jeté le pavé dans la mare. D’autres se sont barricadés derrière le sempiternel argument de l’identité arabo-islamique de la société marocaine. La dimension religieuse ne pouvait pas échapper aux termes du débat lorsque les défenseurs de la pureté de la langue arabe puisent leurs arguments dans le Coran. Une façon de dire que le débat est clos, circulez il n’y a rien à discuter. Mais si les crieurs ne proposaient rien d’autres à part leurs courroux et leurs insultes, le camp de ceux qui sacralisent la langue au point de l’embaumer et de la conserver dans son bel écrin n’a pas eu, pour enrichir le débat, d’autres arguments que l’expression extatique de son idolâtrie. Mais voilà que sont arrivés, peu à peu sur le terrain, des gens réfléchis, des intellectuels avisés, des universitaires ou des chercheurs qui ont l’avantage, et parfois la légitimité, de parler des choses en connaissance de cause. Et c’est ainsi que ce débat enfermé au départ dans une lutte verbale qui a hystérisé le débat au point de le rendre inaudible et souvent infâme, a été sauvé par des sorties médiatiques de haute teneur dans la presse écrite, dont l’intervention du penseur et historien marocain Abdallah Laroui, et également celle de l’anthropologue et chercheur Abdallah Hammoudi. On renvoie pour plus de détails aux publications, Al Ahdath al maghribya et Al Ittihad al Ichrtiraki, tout en signalant qu’aucun de ces deux intellectuels, tous deux de formation bilingue, n’a appuyé la thèse de l’enseignement de la darija dans le système éducatif au Maroc.
Maintenant que le débat est ouvert et que ceux qui ont, peu ou prou, une certaine légitimité et surtout une compétence pour y prendre part et l’enrichir sont sortis de leur silence ou de leur réserve, on serait mieux inspiré de le préserver de toute récupération politique ou idéologique. Certes, ces dimensions sont inhérentes à la question de la langue et de l’identité dans toutes les sociétés de par le monde. Nombre de courants idéologiques et maints régimes politiques dans le monde arabe, tout au long de son histoire tumultueuse, se sont construits, ont mis et continuent encore de mettre l’arabité et l’islamité au centre de leur credo. De ce fait, la langue est certainement à la fois le vecteur et le réceptacle de ces deux composantes. Voilà pourquoi il n’est pas aisé de lancer un débat sur la langue sans que cela ne touche l’ensemble des structures identitaires. D’où la circonspection dont doivent faire preuve ceux qui ont mal engagé les termes du débat. Car, en effet, certains ont eu l’impression que l’on opposait une langue écrite, riche, unifiée, référencée et séculaire contre un dialecte populaire, oral et diversifié. Ce malentendu linguistique devrait être levé avant de poursuivre un débat qui a le mérite de mettre à plat les maux qui affaiblissent une langue d’enseignement, et, au-delà, tout un système éducatif mis à mal depuis quelques décennies.
Il reste à savoir ce que l’on va faire de tout ce que ce débat va charrier tout au long de son déroulement, si déroulement il y aura. Il faudra bien qu’une entité, une institution ou un conseil de concertation le prenne en charge afin de faire des choix, ceux-là forcément politiques. Mais il est rare ou difficile qu’une langue obéisse à d’autres lois que la sienne, car elle se définit elle-même comme «la forme linguistique idéale qui s’impose à tous les individus d’un même groupe social». Certes, la puissance publique a l’autorité et la légitimité de l’intervention, mais les langues sont souvent soumises à d’autres puissances, celles du temps qui passe, de l’usage que l’on fait de la langue et de la transformation de cette dernière. Comme le cycle d’un être vivant, toute langue, disait un auteur, «vit, respire, souffre, s’exalte et succombe en se transformant».
