Idées
Le goût de déplaire
un intellectuel, indépendant par définition, était soit en prison, soit en exil, soit six pieds sous terre, ou enfin et c’est le moindre mal, chez lui à compulser des livres et des grimoires. les plus esthètes d’entre eux, et on en connaît un ou deux spécimens, cultivent pour leur plaisir et celui de certains, ce que baudelaire appelait : «le goût aristocratique de déplaire»
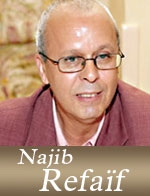
Parmi les postulats que les intellectuels nourris de l’esprit des Lumières avancent, on trouve celui qui soutient que «les hommes, êtres rationnels et autonomes, sont capables de construire un monde meilleur». C’est du moins ce qu’on peut lire dans les livres lorsqu’on lit des livres. Et c’est ce que tel historien de renom ou tel philosophe de plateaux de télé soutiennent tout en faisant un constat aux antipodes de cet esprit des Lumières. Juste après ces émissions ou pendant leur déroulement, sur d’autres chaînes d’information en continu, c’est un déferlement de ravages, de tueries, de magouilles politico-financières, de conflits de territoires, d’attentas terroristes et tant d’autres faits et gestes inhumains qui vient démentir les propos tenus sur les plateaux et renseigner sur le véritable état du monde actuel. Un état déplorable et rendu tel par des hommes plus ou moins rationnels et autonomes. Alors, est-ce à dire que l’esprit des lumières a fait long feu, si tant est qu’il eût soufflé un jour sur la terre des hommes ?
D’où il est légitime de se poser d’abord cette question : A quoi sert un intellectuel dans un monde qui se passe de ses connaissances, de ses conseils ou de ses mises en garde ? Dans le vocable d’intellectuel, on ne se contente pas ici de la définition classique et réductrice qui exclut toutes les autres catégories de savants ou de chercheurs en sciences dites dures, ou, plus récemment, en économie. Ceux que l’on appelle «intellectuels spécifiques», et qui apportent à la fois leurs contributions scientifiques et leur prises de position politiques ou sociales, sont de plus en plus incorporés dans ce statut à part accolé à une catégorie d’individus. Ailleurs, en Europe et notamment en France où ce statut a été attribué par les uns aux autres et les autres à quelques-uns, un intellectuel est adoubé par ses pairs ou par les médias. C’est une conscience vigilante, une sentinelle veillant au respect des droits, de la liberté et de la justice. Par l’écrit, la parole ou l’engagement selon une pensée et des opinions, l’intellectuel dérange, enquête et enquiquine les pouvoirs en place. C’est du moins l’image qu’il s’est construite de lui-même et celle que le public s’en faisait. C’est donc une construction intellectuelle qui ne tardera pas à se disloquer, avec le temps et les disparitions successives de quelques figures tutélaires. Après l’engagement par les pétitions, lorsque le pouvoir en place se faisait une idée de l’intellectuel et faisait grand cas de son influence. Exemple de l’attitude que l’on prête au général De Gaule refusant que l’on procédât à l’arrestation de Sartre en admonestant son ministre de l’intérieur : «Voyons ! On n’arrête pas Voltaire !». Une répartie qui grandit et l’intellectuel et le président de la république. Aujourd’hui, on parle de la démission de l’intellectuel ou de son silence. Comme s’il occupait une fonction officielle dans la cité ; ou comme une espèce disparue de la surface de la terre. Mais cela n’empêche pas nombre d’entre eux de continuer à survivre à travers les médias, notamment la télé, et d’autres de s’autoproclamer comme les nouvelles sentinelles d’un nouvel ordre intellectuel. Plus rares et plus conséquents, certains intellectuels font de rares apparitions à la faveur d’une publication avant de retrouver leur solitude et leur réflexion.
Jusqu’à présent on n’a pas invoqué le principe de proximité en citant le cas des intellectuels dans nos contrées arabes. Et pour cause, puisqu’on est parti de l’esprit des Lumières. Mais cela ne signifie pas que la figure de l’intellectuel arabe est absente ou éloignée de la définition classique en vigueur ailleurs. Le fait est que celle-ci, comme toute construction intellectuelle, s’inscrit dans une histoire politique et culturelle particulière : celle du monde arabo-musulman et ses différents aléas et vicissitudes. Exagérant à peine en passant en revue et en accéléré les dernières séquences de l’histoire contemporaine du monde dit arabe, produit de certains régimes politiques qui y ont sévi, on peut tracer la topographie exacte et la place de l’intellectuel de la tribu : un intellectuel, indépendant par définition, était soit en prison, soit en exil, soit six pieds sous terre, ou enfin et c’est le moindre mal, chez lui à compulser des livres et des grimoires. Les plus esthètes d’entre eux, et on en connaît un ou deux spécimens, cultivent pour leur plaisir et celui de certains, ce que Baudelaire appelait : «Le goût aristocratique de déplaire».

