Idées
Le Conseil économique et social, véritable instance de régulation sociale ?
Le Conseil économique et social permet de revoir la multiplicité d’instances de concertation qui se sont chevauchées jusqu’à faire oublier qu’il est constitutionnellement positionné sur ce terrain.
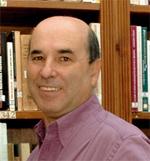
En dépit de quelques progrès sociaux, le Maroc reste confronté à une série de défis. Le chômage persiste à un niveau inacceptable, l’adéquation entre la formation et l’emploi reste insatisfaisante et, désormais, les bouleversements de la globalisation de l’économie mondiale, des évolutions des mœurs et des modes de vie se précipitent, accélérés par les échanges et les comparaisons internationales. Chacun perçoit plus ou moins clairement ces défis.
Au-delà des divergences démocratiques dans la recherche de solutions, il semble bien que notre pays doive moderniser sans plus tarder les méthodes de concertation et de dialogue social qui lui permettront de répondre aux enjeux des temps nouveaux.
Dans ce contexte, l’annonce de la future institutionnalisation du Conseil économique et social (CES) apporte une lueur d’espoir sur les nécessaires visibilité et efficacité du dialogue social. Aujourd’hui, en l’absence de règles et d’une instance dédiée à ce dialogue, un trop grand nombre d’acteurs prennent part au jeu, sans rôle clairement défini : le gouvernement, le Parlement, le patronat, les syndicats, la presse, les associations, l’opinion…
Dans chacun de ces grands ensembles, des stratégies multiples de représentation sont elles-mêmes ouvertes par tel ou tel sous-ensemble. La multiplication à profusion des instances de concertation est davantage le reflet d’une faiblesse, voire d’une impasse, que la manifestation d’une véritable densité des relations. Tous les acteurs du champ du changement social s’entendent sur un certain nombre de constats communs. Les relations entre le gouvernement et les partenaires sociaux connaissent régulièrement des périodes de tension et d’incompréhension réciproque.
De façon récurrente, chacun accuse son interlocuteur de ne pas respecter les règles du jeu: les syndicats reprochent au gouvernement de ne pas faire respecter le droit ; les syndicats et/ou le patronat suspectent les autres parties de collusion avec le gouvernement (et réciproquement) ; les syndicats reprochent (discrètement) à la presse d’être manipulée ou de pousser à la surenchère ; les médias sont parfois amenés à quitter leur posture d’analyse pour devenir des acteurs mêmes du dialogue.
Le gouvernement accuse les partenaires sociaux de ne pas être à la hauteur des enjeux… Dans ces périodes de tension, les relations s’effritent : chacun repose la question de la légitimité de l’autre. Certains estiment que les organisations syndicales ne sont plus en état de négocier, c’est-à-dire d’être en capacité d’aller jusqu’à la contractualisation et qu’il convient donc de s’en tenir avec eux à une simple concertation ; d’autres ne considèrent plus l’Etat comme un partenaire susceptible de dialogue.
Dans cet univers flou, l’évolution sociale pourrait laisser penser que la conflictualité est en baisse. Il n’en est rien. La plus faible occurrence des grèves est pour partie compensée par la croissance du nombre d’actions revendicatives. La conflictualité est devenue éruptive, elle se traduit de plus en plus dans les manifestations spontanées. Ainsi, au Maroc, les syndicats, porteurs d’intérêt collectif, se trouvent-ils désormais concurrencés par de nouvelles formes de représentation.
L’image publique des différentes composantes de la société civile est contrastée et oppose schématiquement le secteur des partenaires sociaux, considéré hâtivement comme sclérosé et en déclin, et le secteur associatif, dont l’expansion est régulièrement soulignée. Les corps intermédiaires prennent ainsi de multiples visages, quitte à permettre l’émergence d’acteurs incertains, mais en apparence plus cohérents car souvent porteurs d’un unique combat, ce qui facilite leur portée médiatique.
En fait, la représentation de la société s’est diversifiée. Dans le même temps, les modalités d’intégration des individus à la société se sont complexifiées, une complexité qui s’accompagne de l’émergence d’identités moins durables et moins construites que les identités nationales ou syndicales, parfois fondées sur un projet commun (associations solidaires…), d’autres fois fondées sur une altérité commune (associations de victimes, de malades…) ou sur une situation partagée (associations de chômeurs, d’étudiants…). Dans ce contexte, le Conseil économique et social ouvre l’opportunité de revisiter la multiplicité d’instances de concertation qui, souvent, se sont chevauchées jusqu’à faire oublier que le conseil est constitutionnellement positionné sur ce terrain.
Dans la perspective de sa formation, deux questions doivent être préalablement résolues. La première porte sur sa composition : son assemblée, ses collèges ou les groupes en son sein devraient refléter la diversité et la richesse de la société civile organisée, dont les partenaires sociaux constituent des composantes importantes. La seconde concerne son rôle : plus qu’un lieu de négociation, la mission première du conseil est celle du dialogue entre les différentes composantes de la société civile et de l’élaboration de propositions partagées.
Pour rendre plus fort et plus cohérent l’exercice du dialogue, il serait utile d’instaurer un rendez-vous annuel, permettant aux partenaires d’échanger sur leurs diagnostics, leurs objectifs et leurs calendriers respectifs. Cet échange pourrait être précédé par un discours annuel du Premier ministre devant le Parlement, ouvrant un débat sur l’état social de la Nation et coïncider avec la présentation du rapport annuel du Conseil économique et social qui intégrerait des éléments de bilan du dialogue social. Peut-on rêver ?
