Idées
L’Amo confrontée à l’impératif de régulation
Chronique de Larabi Jaïdi
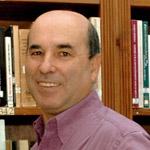
L’assurance-maladie n’est pas encore à son premier déficit qu’elle suscite déjà de vives controverses…Il est naturel d’anticiper les risques de dérive d’un système de couverture des soins. Il est déraisonnable de les dramatiser. La situation financière que connaîtra l’Amo à moyen terme n’est pas de toute gravité. Que signifierait un éventuel déficit de 1,5 ou 2 milliards de dirhams face aux dépenses décuplées de la Caisse de compensation ? On sait que l’une des solutions utilisées, ailleurs, pour traiter le déficit d’un système de couverture des soins est de «découpler» les dépenses de santé des dépenses d’assurance-maladie, seules prises en charge par la collectivité. Elle consiste à considérer que les individus sont libres de consacrer la part de leur revenu qu’ils déterminent eux-mêmes à leur santé et que l’Etat n’a pas à intervenir dans ce choix. Il ne revient à la puissance publique que de contrôler les dépenses supportées par la collectivité. Il suffit alors d’ajuster le taux de prise en charge à l’évolution des dépenses pour maintenir l’assurance-maladie en équilibre. Une telle politique a prouvé, comme on le voit dans de nombreux pays, qu’elle n’infléchissait pas la progression des dépenses de santé, conduit donc à un «désengagement» de l’assurance-maladie sans que celle-ci ne se recentre sur les dépenses les plus utiles. Nous n’en sommes pas encore là dans une expérience marocaine, à peine à ses premiers pas. Mais il faudrait bien admettre, dès les premiers âges d’un système appelé à être pérenne, qu’une assurance-maladie n’est jamais spontanément équilibrée. En l’absence de mécanisme de régulation efficace, un tel équilibre ne serait d’ailleurs que fortuit. En effet, les déterminants des dépenses de santé sont totalement indépendants de ceux dont dépendent les recettes. Celles-ci ne sont fonction que de l’évolution de la masse salariale quand celles-là dépendent des facteurs variés et complexes : le progrès technique, la démographie, l’offre de soins, la rémunération des producteurs de soins, les comportements face à la maladie, les épidémies. Il n’y a donc aucune raison pour que recettes et dépenses connaissent spontanément des évolutions parallèles. Seuls des mécanismes de régulation, qui agissent sur le volume des soins prodigués et sur les prix unitaires des actes, permettent d’ajuster la progression des dépenses à celle des recettes. Dans de nombreux pays, le mode de traitement des déséquilibres financiers, qui a prévalu jusqu’à un certain temps, par l’augmentation des recettes s’est avéré insuffisant. Ce sont les dépenses qui ont dû être maîtrisées. Les multiples tentatives de redressement de l’équilibre de l’assurance-maladie ont mêlé diverses mesures : des mécanismes de prix administrés, des augmentations de la participation de l’assuré aux dépenses de santé, des restrictions de l’offre de soins, des systèmes d’enveloppe, le déremboursement de certains médicaments. Malgré ces mesures, la politique de régulation peine à atteindre ses objectifs d’équilibre. L’opacité du système de soins contribue à expliquer cette difficulté. Les gestionnaires peuvent faire état de présomptions de dépenses inutiles ou de gaspillages, mais ne possèdent pas le moyen de les mesurer ou de les localiser précisément. Cette opacité a occulté l’existence de variations considérables dans les pratiques médicales dont la mise en évidence aurait nécessairement conduit à remettre en cause des situations établies : le libre choix du médecin par le malade, la liberté d’installation, le paiement direct, la liberté de prescription, le secret médical…
L’un des enseignements de l’expérience internationale est qu’il n’existe pas de système parfait, pas de recettes miracles. Il serait illusoire de prétendre proposer un système clés en mains, et d’entendre résoudre d’un coup de baguette magique un problème auquel sont confrontés tous les pays. L’un des enjeux essentiels de l’avenir de l’Amo consiste donc à introduire dans notre pays des mécanismes de régulation modifiant les comportements pour favoriser ceux qui concourent simultanément à une plus grande qualité des soins et à l’élimination des dépenses inutiles. Ces instruments peuvent être rangés en deux catégories : ceux qui peuvent être instaurés et maniés unilatéralement par la puissance publique; ceux qui ne peuvent fonctionner que dans le cadre d’une action concertée avec les professions de la santé. Il va de soi que ce sont les instruments de cette deuxième catégorie qui doivent être privilégiés. Mais, là aussi, il faudrait admettre que l’autodiscipline au sein des professions de santé devrait contribuer à maîtriser les limites des outils techniques de régulation. Après tout, le code de déontologie prescrit bien au médecin de prodiguer les soins, les plus éclairés certes, mais également les moins coûteux. En réalité, l’auto-discipline ne s’est manifestée ni au niveau individuel ni au niveau des organisations professionnelles. La profession devrait s’organiser pour diffuser, à travers des conférences de consensus, des stratégies thérapeutiques ou diagnostiques ayant le coût le moins élevé. Le fonctionnement d’un système d’assurance-maladie n’est pas un chantier qu’on ouvre une fois pour le refermer définitivement, les travaux faits. Cette réforme est sans doute, de toutes celles nécessaires dans le domaine économique et social, la plus difficile à entreprendre.
Ceci tient à la multiplicité des acteurs, à l’opacité du «marché» sur lequel ils interviennent, à l’imprécision des prérogatives. Mais aussi, et surtout, à la nature à la fois éthique, médicale, économique, politique et financière des problèmes traités. Ce constat de la difficulté de la tâche ne doit cependant pas faire oublier l’exigence d’une anticipation des risques.
