Idées
L’Aménagement du territoire : retour à la case départ ?
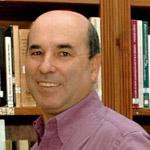
Parce que convaincus de la place essentielle que doit occuper l’Aménagement du territoire (AT) dans notre société, le gouvernement d’alternance avait milité, en son temps, pour l’institutionnalisation d’un département ministériel en charge de cette mission. La création du ministère de l’AT répondait à la nécessité pour un gouvernement trop souvent confronté à l’urgence, de pouvoir se référer à une structure de réflexion qui lui permette d’éclairer les choix dans le domaine du développement durable. Le Maroc avait besoin d’organiser son territoire pour assurer sa cohésion et sa compétitivité. L’héritage historique marqué par une forte centralisation économique et politique a toujours imposé des politiques publiques pour aménager le territoire. Pendant longtemps, le souci de la gestion sécuritaire du territoire l’a emporté sur la volonté de développement. Le nouveau contexte, la montée des risques ne pouvaient plus se satisfaire de régulations répressives, marchandes et individuelles. Les évolutions fondamentales requéraient des nouvelles orientations pour l’action publique : la mise en œuvre démocratiquement et aux bons niveaux des politiques intégrées qui permettront un développement durable des territoires, la gestion des risques économiques sociaux et environnementaux potentiellement créateurs de situations non maîtrisables par le local ou résultant de situation d’inégalités de situation inacceptables.
Les efforts déployés par le ministère de l’aménagement du territoire, de l’eau et de l’environnement, à travers ses cadres, ses responsables ont permis d’assurer les conditions favorables à l’instauration d’un débat autour des questions déterminantes pour l’avenir de notre pays. Ils ont mis en place des outils (charte, schémas nationaux et régionaux) qui constituent de véritables cadres de référence permettant d’apporter des éclairages sur les dysfonctionnements existants. Avec le changement de l’équipe en charge de ce département, ces efforts sont passés par perte et profit. L’Aménagement du territoire fait désormais partie de l’histoire des politiques publiques.
On peut concevoir qu’une administration nouvelle change l’orientation politique d’un département ministériel, préconise de nouveaux choix. C’est la règle de la démocratie. Mais qu’elle fasse table rase d’une politique structurelle, de ses institutions et de ses plans d’action, c’est difficilement concevable. Qu’elle considère que la politique d’aménagement du territoire n’a plus de raison d’être est une hérésie. Qu’elle voit dans l’urbanisme une politique suffisante en elle-même pour faire face à tous les défis des mutations ou des dysfonctionnements des espaces de vie est une ineptie. Mais le pire est que les géniteurs de cette politique d’aménagement du territoire font partie de ce gouvernement qui enterre sans coup férir une politique en pleine maturation. Ils assistent et cautionnent cette gabegie sans lever le petit doigt. Comme s’ils admettaient que leur passage à ces niveaux de responsabilité était une erreur d’aiguillage. Que leur projet n’était destiné qu’à la consommation du public. Quant au Parlement, n’en parlons pas ! Il est ailleurs, loin même des bancs d’interpellation. Démission, silence complice ou changement de cap, peu importe! Le citoyen a droit à l’information. Qu’en est-il aussi de ce Conseil supérieur de l’aménagement du territoire constitué après tant de batailles ouvertes ou dans les coulisses. Arrêtons-nous sur ses recommandations : création d’une commission interministérielle permanente de l’aménagement du territoire, de commissions régionales, d’un centre national et surtout le renforcement des capacités du ministère. Des recommandations restées lettre morte. Pourtant le Conseil s’est tenu sous la présidence de la plus haute autorité du pays ; il a bénéficié – si l’on en croit les motions adoptées à l’unanimité- de l’adhésion massive de l’ensemble des acteurs du secteur public et semi public, de la sphère politique, syndicale, professionnelle et universitaire et de toutes les composantes de la société civile. Toutes ces voix comptent-elles pour rien ? A ce que je sache, l’Etat n’est pas une entreprise privée qui modifie sa stratégie en fonction du propriétaire du capital. Il a sa spécificité. Sa mission ne s’arrête pas à un rapport d’affinité entre personnes. Les structures gouvernementales sont en principe rationalisés et garantissent la continuité du service public. Cette responsabilité confère à ceux qui l’assument des obligations fortes de respect des engagements envers la société, sources de crédibilité de l’Etat. Obligations ensuite vis-à-vis de ses missions, car la légitimité de l’Etat s’appuie en premier lieu sur sa capacité à garantir le fonctionnement de l’intérêt général. Obligation enfin de favoriser la modernisation territoriale du pays indispensable à la maîtrise de ses équilibres et de sa cohésion. Refuser son délitement impose à la puissance publique de privilégier les politiques d’aménagement du territoire, de lutte contre les exclusions qui sont aujourd’hui des responsabilités premières de l’Etat. Les orientations de la nouvelle équipe traduisent une rupture certaine, avec une tendance aggravante: elles s’inscrivent dans une politique délibérée de renoncement à l’acquis. Cette rupture ne peut que déboucher sur la démobilisation des personnels, une aggravation de la crise des territoires et une insatisfaction grandissante de la population.
