Idées
L’Afrique ambitieuse et plurielle
la «Marque Maroc» dans un paysage africain en constante évolution a besoin de l’élaboration d’une stratégie d’influence pour scénariser et diffuser ses atouts, ses valeurs et son message spécifique
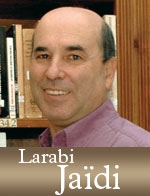
La récente tournée royale en Afrique subsaharienne consolide les acquis réalisés dans la coopération entre le Maroc et des pays africains depuis le début du nouveau règne. Qu’une nouvelle véritable politique du Maroc se dessine progressivement sur le continent ne fait guère de doute. Affaires économiques, sécurité et diplomatie ont dominé ces nouvelles rencontres. Deux facteurs en témoignent et la structurent: l’histoire, parce qu’elle a durablement imprimé sa marque politique, culturelle et commerciale ; les opportunités économiques récentes, parce qu’elles mettent en évidence le potentiel d’échange et de coopération. Ces deux facteurs se combinent pour dessiner la vision d’un partenariat aux perspectives prometteuses.
Le Maroc est encore dans les premières phases de construction d’une stratégie de partenariat sur le continent. Aussi est-il tenu de se départir de toute posture condescendante, de comprendre les enjeux de pays africains sur les questions majeures inscrites sur l’agenda du dialogue, de saisir les mutations économiques en cours pour développer des relations en fonction d’intérêts économiques et stratégiques partagés. Nous regardons encore trop l’Afrique comme le continent de la souffrance et de la pauvreté, des handicaps structurels, de la «mal gouvernance», des zones de conflits. Celle aussi d’un nouveau terrorisme. Si cette Afrique est bien réelle, une autre est en mouvement, ambitieuse par ses ressources naturelles et financières, ses nouveaux marchés, son urbanisation accélérée, ses récentes classes moyennes et ses élites compétentes. Si l’économie doit s’imposer plus encore comme un atout, un puissant vecteur commun d’influence, les bases de cette pénétration traversent plusieurs leviers que nous devrions davantage affirmer et mieux coordonner. Parmi d’autres, nos actions de formation et de santé doivent être davantage soutenues, notre création culturelle doit s’engager dans des coproductions couvrant les domaines du cinéma, de la musique, mais aussi de la littérature, de l’art contemporain, de l’architecture… Si le Maroc doit développer en profondeur sa relation avec les pays africains, il ne peut pas regarder le continent comme un seul vivier de business potentiel. Le Maroc n’est pas un acteur comme les autres en Afrique. Il est un pays africain. Il ne peut négliger les proximités culturelles et politiques, ni les liens religieux plus anciens, il doit valoriser un exceptionnel capital culturel et historique commun. Notre paradigme commun, c’est un mix unique fait d’histoire partagée, d’aide au développement, de sécurité, d’immigration, de diasporas, d’investissements économiques, d’interventions humanitaires, de présence sécuritaire mais aussi de sport et de culture…, autant de paramètres qui doivent être associés pour créer un partenariat global de croissance et de progrès réciproques. Le Maroc doit parler avec les leaders certes mais il doit surtout promouvoir le dialogue avec les opinions publiques africaines à travers une diplomatie multidimensionnelle et ouverte. Il s’agit d’établir des mécanismes pour des échanges associant les membres des institutions élues, les administrations, les opérateurs, les universités et la société civile.
L’Afrique est plurielle. Pourquoi le Maroc est-il si dramatiquement absent au-delà du «pré carré» francophone ? Une absence dans les pays anglophones ou lusophones qui décollent est une flagrante méprise. Du fait de son prisme francophone, la diplomatie marocaine est faiblement connectée à ces pays. L’Etat n’est pas le seul responsable, même si on lui reproche d’être davantage un «retardateur» qu’un «éclaireur». A quelques exceptions près, par complexe linguistique, par confort, par habitude, nos entrepreneurs en Afrique francophone ne regardent pas ce qui se passe au-delà du bout de leur nez. Il faut que le Maroc se branche sur les économies à fort potentiel humain, principalement l’Afrique du Sud, le Nigéria, le Ghana et l’Ethiopie. Des pays qui ont des ressources et des besoins.
Face à la formidable progression de la présence des pays émergents, la Chine en tête, l’Inde ensuite, mais aussi le Brésil, la Turquie, les pays du Golfe, Israël ou même certains pays du Maghreb, le Maroc se cherche et hésite : entre la consolidation de relations personnalisées et la «normalisation» des rapports, le souci de conserver une politique d’influence bilatérale dans un pré carré et l’affermissement des liens avec de nouveaux partenaires politiques et commerciaux, entre tolérance à l’égard des régimes autoritaires et soutien à la démocratisation des pays-amis, entre aide-programme et partenariat-projet, etc. Notre diplomatie a besoin d’ambassadeurs combattants, au sens noble du terme. Motivés par le sens de l’intérêt général, portant haut le renom de leur pays. Ceux qui vont au front, pas ceux à la recherche de paisibles postes de fin de carrière. Nos ambassades ont besoin d’un personnel aguerri à un environnement complexe. Des profils de compétence en adéquation avec les tâches de leurs missions, capables de contribuer au rayonnement du pays par la capacité de négociation, la force de conviction. Pas des «passagers clandestins» motivés par les avantages matériels, affectés à ces postes par simple promotion routinière, par copinage ou par sanction. Nous avons besoin d’ambassades qui disposent d’une logistique adaptée à l’ambition déclarée sans laquelle l’efficacité de l’action diplomatique est entravée en permanence.
En somme, la «Marque Maroc» dans un paysage africain en constante évolution a besoin de l’élaboration d’une stratégie d’influence pour scénariser et diffuser ses atouts, ses valeurs et son message spécifique. Une stratégie qui dessine les contours de ce que devrait être une relation adaptée, adulte, autour d’un partenariat fondé sur des intérêts respectifs assumés. Cette stratégie africaine portée à son optimum pourrait constituer un élément structurant pour l’avenir de notre politique étrangère.
