Idées
L’accidentologie, une démarche à promouvoir
L’hécatombe est poussée à la hausse par l’évolution du parc automobile, des distances parcourues, et d’autres facteurs infrastructurels ou comportementaux. Les pouvoirs publics ont pris conscience de la gravité de cette situation et ont décidé de frapper fort.
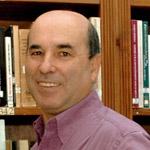
Chaque année, le Maroc compte environ 4 000 tués sur les routes, et plus de 100 000 blessés. En 2009, notre pays a enregistré 69 348 accidents corporels. Le niveau de gravité des accidents est très élevé avec 5,77 tués pour 100 accidents. Avec ces résultats, le Maroc se situe parmi les pays dont la performance dans la sécurité routière laisse à désirer. Les grands axes du problème sont connus des décideurs publics. Les politiques introduites depuis quelques temps (limitation de vitesse, ceinture de sécurité Plan stratégique intégré d’urgence en 2003, la révision à la hausse des amendes forfaitaires, l’équipement des routes en radars fixes, etc.) ne sont pas parvenues à arrêter ni même diminuer sensiblement la courbe des accidents. Les progrès sont plus difficiles. L’hécatombe est poussée à la hausse par l’évolution du parc automobile, des distances parcourues, et d’autres facteurs infrastructurels ou comportementaux. Les pouvoirs publics ont pris conscience de la gravité de cette situation et ont décidé de frapper fort. Controversé dans ses dispositifs, courageusement défendu par le ministère du transport, le nouveau code de la route introduit un ensemble de dispositifs (permis à points, permis de conduire professionnel, usage de l’alcootest, moyens mécaniques de contrôle, sanctions draconiennes) qui ont vocation à pallier les insuffisances du code actuellement en vigueur. D’aucuns considèrent que la mouture de cette nouvelle base juridique et légale de la circulation routière ne sied pas à un pays dont les institutions sont gangrenées par la corruption et l’incivisme, les pratiques de contournement de la loi. Tout résidera dans la capacité des institutions à veiller à la mise en œuvre, efficace et juste, de la nouvelle loi. Toujours est-il que la refonte de l’ancien code s’imposait. Pour une raison essentielle : les accidents de la route ont des conséquences coûteuses. Lorsque ce coût s’accumule sur des années, il devient exorbitant pour la société… Ce coût des accidents de la route reste, aujourd’hui encore, assez mal évalué. Il est estimé au minimum à 11 milliards par an. Un chiffre impressionnant, constamment revu à la hausse. Pour calculer ce chiffre, on prend en compte les frais médicaux, les coûts matériels (véhicules, etc.), les frais généraux (assurances, justice, etc.). Il n’intègre pas la perte de production des tués ainsi que la perte de capacité productive de leurs enfants (s’ils en avaient eus par la suite), sans oublier les préjudices esthétique ou d’agrément.
Dans cette évaluation, on se trouve aujourd’hui confronté à un manque d’exhaustivité des données. Les indicateurs les plus utilisés pour mesurer les conséquences des accidents corporels concernent principalement la mortalité et l’accident lui-même. Ils sont insuffisants pour estimer les conséquences sanitaires chez les blessés. La banque de données constituée à partir des procès-verbaux transmis par les services de la police et de la gendarmerie royale apporte une connaissance à propos de ce qui est observé sur le lieu de l’accident. Le suivi de la prise en charge des blessés dans le système de soins ne fait pas l’objet d’un recueil de données pour connaître les suites chez les accidentés. L’accidenté de la route pris en charge par le système sanitaire n’est plus identifié en tant que tel, mais seulement en fonction de sa pathologie. Ainsi, la connaissance du devenir des victimes d’accidents de la route, de la gravité de leurs pathologies, à moyen et à long termes s’avère difficile. Ces lacunes font obstacle à une estimation rigoureuse du coût des accidents de la circulation routière. Il y a un besoin d’un éclairage nouveau sur la réalité des accidents corporels et de leurs conséquences. Dans cette perspective, la recherche en sécurité routière est devenue un élément essentiel pour progresser dans la lutte contre l’accidentologie. Discipline multiforme, elle porte sur le véhicule pour le rendre plus fiable et mieux visible afin de prévenir l’accident, mais aussi, et de plus en plus, de renforcer la protection en cas de survenue d’un accident. Elle se consacre aussi à l’étude des comportements et habitudes des individus ; un domaine essentiel puisque la conduite est avant tout dictée par un comportement humain. Elle s’étend à l’infrastructure pour identifier ce qu’on appelle les «points noirs» en sécurité routière, c’est-à-dire les endroits les plus dangereux, afin de résorber les risques. Ces axes de recherche, bien qu’essentiels à la compréhension des accidents routiers et à leur prévention, restent peu développés au Maroc. Aujourd’hui, pour exploiter les importantes marges de progrès existant en matière de sécurité routière, ne conviendrait-il pas d’organiser une vraie programmation de la recherche dans ce domaine, donner les moyens à la recherche publique en sécurité routière, impliquer l’ensemble des acteurs, dont le ministère de la santé, les acteurs locaux ou certains acteurs privés (notamment les assurances), qui ont des informations essentielles à délivrer ? Une approche renouvelée de l’accidentologie routière paraît être une condition pour assurer le succès du nouveau code de la route. La qualité de l’évaluation des coûts économiques et sociaux des accidents de la route, l’efficacité de la lutte contre l’insécurité routière seraient ainsi accrues par une coordination renforcée entre chercheurs et acteurs de terrain.
