Idées
La richesse, terra incognita des statistiques
C’est moins le scandale que constitue la pauvreté que la crainte du danger qu’elle représente potentiellement pour le maintien de l’ordre social inégalitaire qui l’engendre qui motive les politiques soi-disant destinées à soulager la misère. En omettant de tourner un regard critique vers le haut aussi bien que vers le bas de l’échelle sociale, la politique publique s’interdit de se donner pour objectifs la solidarité et la cohésion sociales.
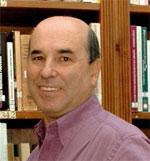
Depuis quelques années, notre système statistique déploie des efforts pour mesurer le seuil de pauvreté, identifier les pauvres, saisir leurs profils, leurs lieux de résidence…
Louable effort, motivé sans doute par la volonté de mettre à la disposition des décideurs les instruments nécessaires à un ciblage pertinent de la politique de lutte contre la pauvreté. Mais il est curieux d’observer que les statisticiens et économistes manifestent peu d’intérêt pour les riches.
Leur farouche volonté de se préserver de tout regard extérieur ne peut justifier cette attitude. Alors, absence de curiosité ? Refus de tourner un regard critique vers le haut ? La richesse existe, cela ne fait pas de doute ; elle est perceptible, même si c’est de manière très partielle et confuse.
Elle est ostentatoirement étalée. Mais elle intéresse peu, semble-t-il, statisticiens et économistes, voire les spécialistes des sciences sociales. A tel point que des questions simples comme : qu’est-ce qu’être riche aujourd’hui ? combien de riches y a-t-il au Maroc ? qui sont-ils ?… restent largement sans réponse. Il y a à cela de puissantes raisons.
Une première tient à la nature même de la richesse dans les sociétés en développement. Tant que celle-ci était essentiellement immobilière, faite de la possession de biens fonciers ou de propriétés bâties, ses détenteurs étaient aisément identifiables : on savait qui possédait combien d’hectares. Aujourd’hui, la richesse est essentiellement financière et mobilière. Abstraite, comme la valeur dans laquelle elle se résout, elle est aussi anonyme et se cache aisément dans le secret des comptes en banque, des portefeuilles financiers et des coffres-forts.
C’est que, contrairement à la pauvreté, la richesse n’a pour l’instant fait l’objet d’aucune tentative synthétique de définition capable de rendre compte de sa nature multidimensionnelle. Si la notion de seuil de pauvreté est assez communément admise (même si elle prête à discussion), la définition d’un seuil de richesse paraîtra sans doute encore incongrue à plus d’un. La nomenclature des catégories et groupes socioprofessionnels de la Direction de la statistique est, de même, particulièrement mal adaptée à cerner les riches.
La bourgeoisie se trouve par exemple éparpillée entre les agriculteurs exploitants, les artisans, commerçants, chefs d’entreprises, les cadres et professions intellectuelles supérieures, mais aussi les inactifs, parmi lesquels sont classés les rentiers. Ce déficit conceptuel n’est en fait que la marque d’un manque général de curiosité des chercheurs à l’égard des riches.
Les arguments quelquefois avancés pour le justifier ne sont pas sérieux : les riches ne seraient pas nombreux, si peu nombreux même qu’ils ne seraient pas significatifs statistiquement. Mais depuis quand l’importance politique, économique, sociale, etc., d’un groupe, sa place et son rôle dans la société, se mesurent-ils à son importance numérique ? La pauvreté serait scandaleuse, non la richesse.
Et les études qui y sont consacrées se justifient toutes, implicitement ou explicitement, par leur souci d’éclairer les politiques destinées sinon à la résorber, du moins à la soulager. Louable intention, mais qui masque (mal) en fait une conception curieuse et sélective du scandaleux. Il est sans doute scandaleux qu’aujourd’hui, au Maroc, des personnes soient contraintes de tenter de survivre avec seulement quelques dirhams de ressources par jour.
N’y a-t-il pour autant nul scandale à ce que, en même temps, quelquefois à quelques centaines de mètres de là, un individu puisse «flamber» plusieurs millions de dirhams en une seule soirée ? Le scandale n’est-il pas dans la coexistence de ces deux situations et plus encore dans la relation intime qui les lie? En fait, c’est moins le scandale que constitue la pauvreté que la crainte du danger qu’elle représente potentiellement pour le maintien de l’ordre social inégalitaire qui l’engendre, qui motive les politiques soi-disant destinées à soulager la misère.
Et les études qui ont pour fonction d’éclairer ces politiques leur permettent d’être plus efficaces, c’est-à-dire de mieux encadrer institutionnellement les populations pauvres. Le processus de paupérisation des uns, inscrit dans les structures profondes d’une société inégalitaire, peut ainsi perdurer et avec lui le processus d’enrichissement des autres. En omettant de tourner un regard critique vers le haut aussi bien que vers le bas de l’échelle sociale, la politique publique s’interdit de se donner comme objectifs la solidarité et la cohésion sociales.
