Idées
La politique économique otage des indicateurs ?
L’extrême sensibilité affichée par les gouvernements aux plus infimes variations conjoncturelles ne cesse d’étonner quand on connaît l’imprécision des statistiques. En exagérant à peine, on pourrait résumer ainsi le nouveau credo de l’économie quantitative :
peu importe que les données soient exactes, pourvu que tout le monde se réfère aux mêmes chiffres.
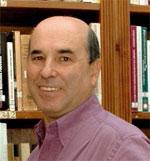
Lafragilité des indicateurs économiques compromet la fiabilité de la politique économique. Parmi tous les instruments, la politique monétaire est particulièrement vulnérable.
Dans son Histoire économique de la France entre les deux guerres, Alfred Sauvy raconte comment, en 1934-35, faute d’information économique adéquate, le gouvernement français n’a pas pris la mesure de l’écart d’environ 20 % qui s’était creusé entre les prix français et anglais, et s’était obstiné à défendre une parité surévaluée au lieu de dévaluer la monnaie. Sans raviver la polémique sur la politique de change suivie par le gouvernement marocain, on peut s’interroger sur la fiabilité des indicateurs qui servent de guide à la politique économique.
A l’évidence, le problème n’est pas propre au Maroc. La sous-estimation de l’inflation qu’entraà®nent les changements des comportements de consommation et les défaillances dans la construction de l’indice des prix est un phénomène général.
Le biais ainsi introduit dans la mesure de l’inflation se retrouve dans plus d’un pays, mais sans doute pas dans les mêmes proportions. L’incertitude sur un sujet aussi sensible suffit à semer le doute sur l’orientation d’ensemble de la politique économique, en particulier lorsque celle-ci fait du contrôle de l’inflation sa priorité. Parmi les différents instruments de la politique économique, la politique monétaire est certainement la plus vulnérable à cette fragilité des indicateurs économiques.
Ceci est particulièrement vrai dans le domaine de l’action conjoncturelle o๠les conséquences d’un diagnostic erroné peuvent s’avérer lourdes de conséquences. L’évaluation des tensions inflationnistes à l’Å“uvre dans l’économie est en effet déterminante pour la conduite de la politique monétaire. La banque centrale définit sa politique discrétionnaire de régulation des taux d’intérêt à court terme en fonction des tendances présentes et attendues de l’inflation. Dans ces conditions, une sous-estimation de l’inflation se traduira par un relâchement excessif de la politique monétaire, qui aura pour effet de conduire à une «surchauffe».
Certes, les différents indices des prix (à la consommation, à la production, etc.) ne sont pas les seuls indicateurs considérés par la banque centrale. Celle-ci s’appuie aussi sur les mesures disponibles des tensions sur les capacités de production.
Or, ces mesures sont aussi sujettes à caution. L’évaluation des tensions sur les capacités suppose en effet que soit estimé le potentiel de croissance de l’économie, lequel dépend de la croissance de l’investissement, de l’offre de travail et de la productivité. L’estimation de l’investissement est problématique, du fait que certaines de ses composantes (services, immatériel) ne sont pas bien appréhendées par les comptes nationaux. Si les tensions sur les capacités de production sont surestimées, cela conduira la banque centrale à durcir trop tôt sa politique monétaire.
De même, la mesure du potentiel de croissance de l’économie sera influencée par l’estimation du taux de chômage dit de plein emploi, autrement dit du niveau de chômage en deça duquel il n’est pas possible de descendre sans accélérer l’inflation. Généralement, ce taux se situerait, d’après les estimations économétriques, entre 5 et 6 % de la population active.
De façon significative, la décrue du chômage, relevée par les enquêtes emplois, au cours de la phase actuelle n’a pas entraà®né d’accélération de la hausse des salaires et des prix. Ce qui laisse penser une fois de plus que les besoins d’emplois sont très largement sous-estimés par la mesure officielle du taux de chômage et qu’une partie importante de la population adulte, dite inactive, serait désireuse de travailler si l’opportunité lui en était donnée, ce que ne reportent pas les enquêtes sur l’emploi. La sous-estimation de l’inflation et la surestimation des besoins d’emplois ne perturbent pas seulement la politique conjoncturelle.
Elles faussent les conditions de l’arbitrage implicite entre inflation et chômage dans l’orientation de la politique économique à long terme. Enfin, l’extrême sensibilité affichée par les gouvernements, les médias et les marchés aux plus infimes variations conjoncturelles ne cesse d’étonner quand on connaà®t l’imprécision des statistiques concernant l’inflation, l’investissement ou l’emploi. De sorte qu’en exagérant à peine on pourrait résumer ainsi le nouveau credo de l’économie quantitative : peu importe que les données soient exactes, pourvu que tout le monde se réfère aux mêmes chiffres .
