Idées
La phobie du déficit budgétaire
Préserver la confiance des créanciers, des marchés et du public est le signe d’une gestion saine du budget. Celle-ci ne peut être réductible à un déficit zéro.
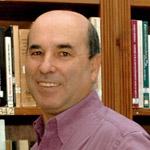
Alors que les pays sortent de la crise économique et financière avec des finances publiques dont la situation s’est fortement dégradée, le débat sur la «soutenabilité» des déficits budgétaires est relancé. C’est que la pensée orthodoxe assimile la gestion des finances publiques à celle d’un père de famille prudent qui s’efforce de ne pas vivre au-dessus de ses moyens, voire d’épargner pour préparer l’avenir et se prémunir contre les mauvaises surprises. Cette vision a pourtant une conséquence fâcheuse quand survient une dépression. Celle-ci entraînant une chute des recettes fiscales et donc un déficit public, les pouvoirs publics s’efforcent de rétablir l’équilibre budgétaire en réduisant ses dépenses et/ou en relevant les impôts. Ce faisant, il déprime plus encore l’activité. Il fallut la Grande Dépression des années 30 et la révolution scientifique initiée par John Maynard Keynes pour qu’on renonce au dogme fatal de l’équilibre budgétaire. On a fini par être convaincu que la pire des politiques consiste à assécher les liquidités et la dépense d’une économie en crise. Le seul fait de laisser filer le déficit public conjoncturel provoqué par la récession exerce un effet stabilisateur automatique: le recul de la demande est freiné par la baisse des impôts et la remontée des dépenses sociales. Depuis des années, tout le monde sait cela et tous les gouvernements ont recours à la politique budgétaire (y compris, voire surtout les libéraux, à l’instar des gouvernements Reagan, Major ou Bush). La crise actuelle vient de démontrer que le déficit peut avoir des effets vertueux pour sortir de la crise. Le déficit des finances publiques de nombreux pays de l’OCDE avoisine les 8% du PIB. Il y a trois, quatre ans, on aurait interprété ce comportement d’attitude suicidaire.
Cette interprétation serait confortée par l’hypothèse de l’«effet d’éviction» de la dépense privée par la dépense publique. Un déficit public doit en effet être financé. Quand l’Etat emprunte sur le marché financier, il réduit l’épargne disponible et fait monter les taux d’intérêt, ce qui déprime l’investissement. Il se peut qu’à court terme le déficit ait des effets stimulants sur l’activité; mais, au terme du processus, le supplément de production sera compensé par la chute des investissements privés. L’économie se retrouve alors avec un produit intérieur inchangé, l’inflation engendrée par les pressions sur la demande et un Etat endetté qui finira par lever plus d’impôts pour rembourser ses dettes. Les «nouveaux économistes» prétendaient même que le déficit public n’a aucun effet positif à court terme en raison des «anticipations rationnelles» des agents privés. Ces derniers savent bien que le déficit n’aura aucun effet net sur la richesse nationale et que les largesses présentes de l’Etat se traduiront, à terme, par des prélèvements supplémentaires. Aussi, dès l’annonce de la relance budgétaire, les agents privés réduisent leur dépense pour faire face aux impôts à venir. Mais il s’est avéré que l’hypothèse d’une éviction de la dépense privée par la dépense publique n’est pas vérifiée empiriquement et cela s’explique aisément. Une relance budgétaire intervient normalement dans une situation où les ménages et les entreprises réduisent leurs dépenses : il n’y a alors pas pénurie d’épargne, mais pénurie d’investissements. En empruntant les fonds que les agents privés n’osent plus investir, l’Etat ne les prive de rien : il prend seulement leur relais. Les dépenses publiques ne sont pas des substituts aux dépenses privées, mais des compléments doublement indispensables : d’une part, elles assurent la production des biens publics (éducation, santé, justice, etc.) et des infrastructures sans lesquelles aucune activité privée ne prospérerait ; d’autre part, elles réamorcent la pompe des échanges quand elle tombe en panne.
Soit, dira-t-on, mais l’Etat peut-il vivre au-dessus de ses moyens en dépensant plus que ses recettes ? Oui, bien sûr, comme tout le monde, et plus longtemps que tout le monde, mais pas éternellement. Globalement, le secteur des entreprises vit au-dessus de ses moyens en permanence pour la simple et bonne raison qu’il réalise une part essentielle des investissements tandis que l’épargne est très largement détenue par les ménages : il est donc globalement et structurellement déficitaire et emprunteur. Il ne viendrait pourtant à aucun économiste l’idée saugrenue d’imposer aux entreprises un «pacte de stabilité» et un retour vers l’équilibre budgétaire. Pourquoi raisonnerait-on autrement pour les budgets publics ? Ceux-ci peuvent être déficitaires sans danger, quand l’endettement public sert à financer des biens et des équipements publics indispensables, dont l’effet positif sur la croissance suscitera, à terme, les rentrées fiscales permettant de rembourser les crédits contractés. Bien entendu, comme dans les entreprises privées, il existe de mauvais déficits : ceux qui n’engendrent pas, à terme, la capacité de remboursement et qui contraignent à un endettement perpétuellement croissant (effet boule de neige). Une gestion raisonnable des finances publiques est celle qui favorise la reprise en atténuant les craintes d’inflation, permet à l’économie de retrouver une assise solide en évitant que la charge de la dette n’aboutisse à une crainte de défaut de paiement. Préserver la confiance des créanciers, des marchés et du public est le signe d’une gestion saine du budget. Celle-ci ne peut être réductible à un déficit zéro.
