Idées
La nouvelle épreuve du modèle allemand
Et de trois ! Angela Merkel a remporté pour la troisième fois consécutive la bataille électorale aux élections fédérales allemandes.
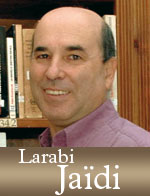
Et de trois ! Angela Merkel a remporté pour la troisième fois consécutive la bataille électorale aux élections fédérales allemandes. Résultat attendu mais néanmoins exceptionnel dans une conjoncture de crise qui ne favorise pas nécessairement la reconduction des coalitions au pouvoir. Compte tenu d’une revendication très forte de justice sociale et d’un climat social tendu, la CDSU-CSU et le SPD ont abordé les élections de septembre 2013 de manière très prudente. Nonobstant leurs différences, une lecture plus «sociale» du «modèle allemand» s’est dessinée dans les deux partis par rapport aux campagnes de 2005 et 2009. En 2005, la politique du SPD, bien que mal expliquée, a eu le mérite de sortir le pays de sa léthargie. Elle a porté ses fruits, permettant à l’économie allemande de regagner sa compétitivité. Mais elle a été contestée par une partie de la population pour ses conséquences sociales ; elle a coupé le SPD d’une partie de sa base, provoquant sa défaite électorale. La CDU-CSU d’Angela Merkel, qui avait fait une campagne très libérale, a remporté une victoire courte. Victoire renouvelée en 2009 et 2013 avec un large écart de voix. Qu’est-ce-qui explique cette réussite ? Devant les attentes des électeurs qui semblaient dire un «oui, mais…» à la réforme du modèle allemand, la coalition gagnante a proposé d’ajuster la politique de réformes afin d’éviter des ruptures dans le modèle social allemand et d’assurer un meilleur équilibre entre coûts et bénéfices des adaptations pour les différentes catégories de la population.
Si un concept pouvait résumer le modèle allemand, c’est celui de «l’économie sociale de marché». Ce modèle économique, appliqué à partir de 1948, est le résultat de la synthèse de certaines analyses économiques des années 1930 et du volontarisme des pères fondateurs de la RFA. Nombreux sont les économistes allemands qui ont décortiqué cette sorte de troisième voie entre capitalisme sans limites et communisme collectiviste, dont l’objectif est de combiner, sur la base d’une économie concurrentielle, l’initiative privée et le progrès social (Henrick Uterwedde, Hans Brodersen, Thomas Hanke…). Dans ce modèle, l’Etat est garant explicite de l’ordre économique et social, reposant sur le libéralisme, mais qui nécessite un Etat doté d’une forte autorité dans le domaine réglementaire.
Les programmes de la CDU et du SPD illustrent cette convergence. Pour la CDU, l’économie sociale de marché est caractérisée par «l’unité indivisible d’un ordre économique libéral et d’un ordre social solidaire», qui tire sa force du fait que «liberté et responsabilité, concurrence et solidarité forment un ensemble». Le SPD, de son côté, y voit «un modèle de réussite exemplaire» parce qu’il combine la force économique avec le bien-être de larges couches de la société. Si le poids respectif du social et du libéral fait l’objet de différenciations, force est de constater que les deux grands partis retiennent les mêmes éléments constitutifs de l’économie sociale de marché : «Culture de la stabilité et importance de la consolidation budgétaire, liberté des entreprises conjuguée à une responsabilité sociale, nécessité d’une culture entrepreneuriale et importance des PME, démocratie sociale via l’autonomie dans le domaine des conventions collectives, cogestion et participation des travailleurs, primauté des marchés mais légitimité d’intervention des pouvoirs politiques dans des domaines et sous des formes bien définies, sécurité sociale pour tous, guidée par les principes de la solidarité collective et de la responsabilité individuelle».
Dans le programme de la chancelière, la logique économique d’ensemble des réformes lancées est libérale : une baisse des impôts et des prélèvements pour réduire le coût du travail, émergence d’un nouveau paradigme pour la sécurité sociale : désormais celle-ci demandera davantage d’efforts individuels. La justice sociale se tourne plutôt vers l’égalité des chances que vers la redistribution. Quant au traitement du chômage, il repose désormais sur des conditions d’indemnisation plus strictes, des incitations fiscales et une meilleure efficacité du placement par les agences pour l’emploi. En cherchant un nouvel équilibre entre concurrence et solidarité, marché et réglementation, le CDU veut donner un autre profil à l’économie sociale de marché.
Ainsi, depuis 1948, le concept d’économie sociale de marché est une balise pour les gouvernements successifs. Par delà les adaptations aux changements structurels nécessitant de nouvelles réponses (fin de la reconstruction, chocs pétroliers, changement technologique, intégration européenne, mondialisation), par delà aussi les alternances politiques, il y a une certaine constance dans la quête d’un juste milieu entre une économie libérale, des régulations publiques et des mécanismes de redistribution sociale; entre le jeu du marché et de la concurrence et la pratique d’un partenariat social doté d’un espace de régulation autonome cherchant à canaliser les conflits et à dégager des solutions négociées. A quelques exceptions près, toutes les forces politiques, économiques et sociales se réclament de l’économie sociale de marché, tout en tentant d’imposer leur propre lecture dans le débat public. Le modèle présente donc des variantes. Il ne constitue pas un système achevé, mais un concept évolutif et modulable qui demeure toutefois un facteur important de cohésion politique et sociale outre-Rhin.
