Idées
La nébuleuse des revenus primaires
On ne peut conduire une politique de redistribution efficiente dans l’ignorance de la nébuleuse des revenus primaires. L’état actuel des statistiques conduit à concentrer l’observation sur ceux-ci pour mieux les appréhender.
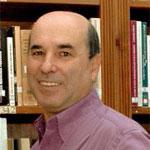
Le gouvernement souhaiterait s’attaquer au chantier de la redistribution des revenus. Louable intention. Sans doute dans la perspective de réduire sensiblement l’écart de revenus entre les riches et les pauvres. Mais comment peut-on définir les contours et les modalités d’une redistribution si les revenus primaires, c’est-à-dire ceux obtenus directement, par chacun d’entre nous, avant fiscalité et redistribution (impôts et taxes, d’une part, prestations sociales et allocations familiales, d’autre part) restent méconnus ?
Dans l’ensemble des revenus – et à plus forte raison, de toutes les formes d’enrichissement – les mieux connus sont sans aucun doute les salaires. Qu’ils soient publics ou privés, ils sont fixés par des statuts ou des contrats, encadrés par des grilles, souvent négociés au grand jour entre les syndicats et le patronat. Ils sont, surtout, déclarés à la fois par ceux qui les touchent et par ceux qui les versent au fisc et à la sécurité sociale, ce qui réduit à presque rien, en ce qui les concerne, la zone d’ombre.
Bien sûr, là aussi, il y a quelques précautions à prendre, sur des détails pas toujours négligeables. Par exemple, la prise en compte ou non des indemnités et avantages en nature. De plus, le panorama général des salaires mérite quelques regards plus appuyés sur certains points du tableau.
Ce n’est pas du détail que d’examiner de plus près le sommet de la pyramide. Dans notre pays, la rémunération du dirigeant est moins liée à la performance de l’entreprise qu’à la position de la personne dans la hiérarchie du commandement et des responsabilités. Mais, à ce stade, est-on vraiment un salarié ? Un léger brin d’inconnu borde déjà le monde des salaires, à cause des imperfections statistiques et du flou des «salariés-dirigeants». En entrant dans l’autre monde, celui des non-salariés, les frontières de l’inconnu deviennent encore plus obscures.
Armés pour tout projecteur d’une lanterne sourde, nous pénétrons dans une forêt inextricable. Les chemins s’y perdent aisément au détour d’un massif, le jour n’y pénètre qu’avec peine. Un forestier dirait qu’elle est inexploitable car les essences sont trop disparates, de l’arbuste chétif au géant dont la cime est inaccessible au regard, et qui profite du soleil refusé à plusieurs. L’on n’y marche même pas en pleine sécurité : à l’abri de cette sylve obscure, entre les racines emmêlées, grouillent des parasites qui ne sont pas tous inoffensifs. L’argent du recyclage est passé par là.
D’autant que les plus dangereux s’y font volontiers passer pour tout petits. On la dirait volontiers équatoriale, cette forêt des revenus, si l’équateur, par son nom même, n’évoquait… un partage équitable. Le croirait-on ? Il y a pourtant, là aussi, un garde forestier.
Sa casquette officielle plantée sur la tête, il s’essaie à la statistique avec la bonne volonté, émouvante et dérisoire, d’un explorateur au sabre de bois. Le cœur de la forêt, il n’a jamais eu vraiment l’imprudence d’y pénétrer. Mais comme il passe son temps à tourner consciencieusement autour de cette masse, il en connaît au moins les contours. Le peu qu’il sait est toujours bon à prendre ; pour circonscrire, en tout cas, l’inconnue. La forêt, c’est la masse indistincte de ce que la direction de la statistique appelle «les non-salariés».
Celle-là au moins est connue: plus de la moitié de l’ensemble des ménages. Ces ménages, la distinction classique en «catégories socioprofessionnelles» permet même de les répartir en trois sous-catégories, d’ailleurs aussi inégales que disparates : les «inactifs» qui, pour diverses raisons, ne participent pas – ou plus – à l’activité générale (retraités, rentiers, oisifs, handicapés, etc.) ; les membres des «professions indépendantes», dont le seul point commun est d’exercer une activité non agricole et non rémunérée par un salaire (commerçants, artisans, professions libérales, artistes, intermédiaires divers), les «exploitants agricoles», qui tirent leur revenu du travail de la terre sous forme de bénéfices directs, de fermages ou de profits divers, à l’exclusion des salaires.
Mais là s’arrêtent les certitudes, avec le dénombrement physique de cette population.
Au-delà, avec le revenu, le terrain devient spongieux et les lianes s’entremêlent. Le regard, pour l’instant, ne saisit que des masses. Qu’on en juge : le monde agricole est mal connu de la plupart des Marocains. L’agriculture est elle-même en effet un monde à part.
Que de fois n’a-t-on entendu, dans la bouche d’un ministre ou d’un responsable de l’agriculture, l’expression de «monde agricole» ou de «monde rural» ? On ne peut admettre trop vite que le niveau de vie des agriculteurs est similaire à celui de la population industrielle ou commerciale.
D’abord parce que des revenus bruts d’exploitation sont très disparates. Qu’y a-t-il de commun entre l’énorme exploitation céréalière ou betteravière, de type capitaliste avancé, apte à tirer de gros profits du soutien national des prix, et la petite exploitation polyvalente de type familial, qui continue à joindre, avec peine, les quatre bouts des saisons ? Les petits agriculteurs sont, par ailleurs, endettés, ce qui réduit d’autant leur véritable revenu disponible.
Il est vrai que les charges spécifiques de leurs exploitations sont en partie compensées par les faveurs fiscales dont ils bénéficient.
En somme, sur notre planète des revenus, il y a une face éclairée, celle des revenus connus, et celle, sombre des revenus cachés.
L’état actuel des statistiques conduit en effet à concentrer l’observation sur ceux-ci, qui ont relativement plus de chances d’être mieux connus, ou moins inconnus. On ne peut conduire une politique de redistribution efficiente dans l’ignorance de cette nébuleuse des revenus primaires.
