Idées
La mortalité des entreprises
Le cycle de vie des entreprises peut s’apparenter à celui des espèces vivantes.
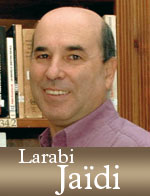
Le cycle de vie des entreprises peut s’apparenter à celui des espèces vivantes. En effet, les entreprises naissent, plusieurs ferment dès leurs premières années, certaines grandissent, en étant parfois cédées, elles atteignent leur maturité, puis elles vieillissent et finissent un jour par disparaître. Les entreprises sont des organismes vivants, et l’expression «démographie des entreprises» convient bien à cette réalité. En ces temps de crispation économique, de très nombreuses entreprises nationales se sont retrouvées dans une situation difficile, mettant en jeu leur survie même. Au cours du 1er semestre 2013, 1990 défaillances d’entreprises ont été enregistrées. Depuis 2010, le nombre de défaillances a augmenté de 11% en rythme annuel moyen. Deux secteurs en particulier ont été touchés par ces défaillances. Il s’agit d’abord du commerce, de la mécanique automobile, d’articles domestiques, et du bâtiment et travaux publics. Pourquoi ces difficultés? Comment certaines en sortent-elles renforcées, tandis que d’autres ne passent pas ce cap et se voient contraintes au dépôt de bilan ?
On peut schématiser comme suit le processus classique de dégradation de la situation financière des entreprises. Premières difficultés : certains indicateurs passent au rouge ; pertes de parts de marché, baisse de la marge brute, pertes récurrentes, baisse de la rentabilité des capitaux investis, augmentation de l’endettement. Confrontée à ces problèmes, la direction tend trop souvent à en imputer les raisons à des causes conjoncturelles ou accidentelles. La persistance des problèmes entraîne une perception croissante de la dégradation de la situation par les partenaires financiers de l’entreprise (fournisseurs, banques) et des réactions proactives de leur part : réduction des lignes d’encours fournisseurs et des concours bancaires, relèvement du coût de ces derniers. L’entreprise est alors engagée dans une spirale défavorable pouvant s’accélérer jusqu’à devenir incontrôlable.
Il est primordial d’anticiper suffisamment tôt les difficultés des entreprises par leur prévention, afin d’éviter qu’elles ne s’aggravent et qu’elles ne permettent plus d’échapper au traitement judiciaire. C’est en 1996 que le droit marocain a institué les premières règles relatives au traitement des difficultés des entreprises. Au droit de la sanction s’est substitué un droit qui met l’accent sur la nécessité de sauvegarder l’entreprise en tant qu’entité viable et génératrice d’emplois. L’appréciation n’est alors plus portée sur l’attitude du débiteur mais aussi sur les perspectives économiques de l’entreprise. Le livre V du Code de commerce relatif au traitement des entreprises en difficultés constituait sans nul doute une avancée dans le traitement des cas des entreprises qui éprouvent des difficultés dans la continuation de leurs activités. Il a eu le mérite d’introduire certaines dispositions novatrices constituant ainsi une rupture avec l’ancien système de la faillite. Parmi ces avancées, il y a l’instauration du système de la prévention, l’abolition de la procédure de la faillite et son remplacement par une procédure qui 
privilégie la sauvegarde et la continuation de l’activité. Mais, depuis son entrée en vigueur, le livre V a fait l’objet de plusieurs critiques. De l’avis des professionnels, le résultat de l’application de la procédure de prévention est décevant du fait de l’hésitation des entreprises à recourir aux nouveaux mécanismes de prévention prévus par la loi et de la mauvaise situation financière de l’entreprise proche de la cessation de paiement, rendant toute mesure de prévention impossible. «Le rôle du président du tribunal est réduit à sensibiliser le chef de l’entreprise sur la nécessité de déposer le bilan sans tarder ; pourtant le rôle préventif du tribunal de commerce est très important». En effet, les mécanismes légaux offrent aux juridictions commerciales des outils de prévention, mais c’est leur mise en œuvre qu’il convient d’améliorer. Les résultats de la procédure de redressement judiciaire ne sont pas non plus satisfaisants du fait du nombre important de l’ouverture des procédures de liquidation judiciaire et de la faiblesse du taux de réussite des plans de continuation.
La dernière réforme du Code de commerce a modifié un certain nombre de dispositions du Livre V du Code. Elle est censée octroyer des chances de garantie de la continuation de l’activité de l’entreprise en permettant un juste équilibre entre les intérêts des débiteurs et de leurs créanciers. Mais la réforme du code a déçu par l’absence d’initiative sur un certain nombre de questions, notamment par l’absence de renforcement des procédures de prévention contrairement aux objectifs annoncés. La prévention n’a pas fait l’objet de plus d’attention. Le droit marocain continuerait ainsi à se limiter aux procédures existantes au moment où une procédure préventive d’accompagnement de l’entreprise dont la situation pourrait la conduire à la cessation de paiement aurait pu être introduite dans le cadre du nouveau code. La loi reste favorable aux débiteurs et ne laisse que peu de place à l’intervention des créanciers et à une éventuelle participation de ces derniers. Il n’y a toujours aucune sanction à l’obligation d’alerte qui, pourtant, permettrait d’éviter à un certain nombre d’entreprises de se retrouver en cessation de paiement.
La réglementation du traitement des difficultés des entreprises au Maroc souffre toujours d’un manque de clarté et d’une insuffisance des procédures des modes de prévention, de traitement des difficultés des entreprises et des sanctions prévues à l’encontre des différentes personnes qui auraient pu contribuer à la cessation de paiement de l’entreprise. L’impact des difficultés des entreprises sur le tissu économique et social donne à une telle question un caractère prioritaire que le législateur se doit de prendre en compte afin de protéger l’économie nationale, de préserver l’emploi et d’accroître la compétitivité du marché marocain.

