Idées
La montée dans la chaîne de valeur
Il est devenu un lieu commun d’affirmer que l’accélération de la transformation structurelle de l’économie nationale exige une montée dans les chaînes de valeur mondiales.
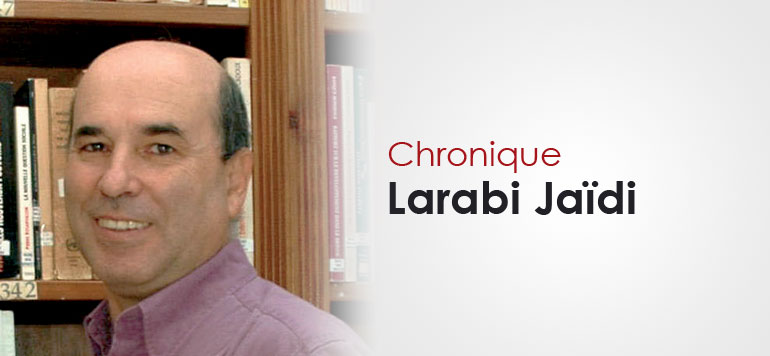
Capitalisant sur les acquis du Pacte Emergence, le programme d’accélération industrielle aspire à donner une nouvelle impulsion au secteur industriel en maintenant le cap sur les nouveaux Métiers Mondiaux et en valorisant les autres filières industrielles classiques. Le nouveau programme s’appuie sur l’approche des écosystèmes construits autour de grands donneurs d’ordre et visant une montée des chaînes de valeur dans les filières choisies. Un défi complexe mais pas impossible à relever.
Prenons deux exemples, l’un se référant au secteur de technologie avancée, l’automobile ; l’autre à une industrie classique, le textile. L’industrie automobile marocaine renforce son positionnement dans la chaîne de valeur mondiale de ce secteur, comme en témoignent ses performances de ces dernières années. Sa dynamique s’appuie sur le développement d’un tissu industriel diversifié autour de grands constructeurs en tant que locomotive de transformation du secteur, à travers l’intégration industrielle de nouvelles filières : emboutissage, tôlerie fine, traitement de surface, injection plastique, ingénierie, etc. Vingt nouveaux fournisseurs se sont installés pour fournir à la fois Renault, Somaca et le marché international de pièces inexistantes auparavant au Maroc. Le tissu de la sous-traitance se développe, mettant en place les jalons d’une chaîne de valeur du secteur automobile au Maroc. Mais gardons-nous de considérer que le développement du secteur peut atteindre des taux d’intégration avoisinant les 80%. Aucun pays ne fabrique l’intégralité d’une voiture à l’intérieur de ses propres frontières. La filière de l’industrie automobile est l’une des plus éclatées et des plus internationalisées. La division du travail au sein de cette industrie se redéploie sous de nouvelles modalités: la recherche technologique, le know-how, le brevet et la marque sont toujours le monopole de grands constructeurs ; le reste, la fabrication du moteur et des autres composants se répartit sur toutes les sphères du globe. Dans la chaîne de valeur de l’automobile interviennent trois segments: les constructeurs, les équipementiers de différents rangs et les assembleurs. Les constructeurs se sont engagés dans une vaste réorganisation des procédures d’approvisionnement ; la fabrication des produits tend à s’effectuer en commun. Les relations entre donneurs d’ordre et sous-traitants se modifient. Ces derniers peuvent imposer leurs conditions aux constructeurs. Des coopérations et des partenariats dans la recherche et la fabrication des pièces nobles se nouent entre concurrents.
Qu’en est-il de l’autre chaîne de valeur, moins technologique, celle des textiles ? L’industrie nationale est dans un cycle déclinant depuis une décennie: perte de poids dans la valeur ajoutée, diminution du nombre d’entreprises, exportations erratiques. Ses fragilités: faible intégration de la filière, forte concentration produits/marchés des exportations, faiblesse de l’innovation, dépendance d’un nombre très limité de donneurs d’ordre. La chaîne de valeur de l’industrie textile et de l’habillement est représentée par les différentes étapes d’élaboration des produits : les matières premières, la filature, le tissage/tricotage, l’ennoblissement, la confection et la distribution. Les filateurs marocains ont disparu sur les segments de l’habillement et de l’ameublement. Les mutations de l’industrie textile mondiale sont caractérisées par la montée en puissance des donneurs d’ordre et l’organisation de la complémentarité des activités en intégrant les potentialités offertes par le développement de l’approvisionnement international. Dans ces chaînes de valeur mondialisées, dominées par les clients, les lieux de création de valeur ajoutée reposent aussi bien sur les processus de production que sur des valeurs intangibles comme la mise en valeur d’une marque ou la qualité de la coordination des relations. Le secteur national se cherche un meilleur repositionnement dans la chaîne de valeur. Diverses stratégies ont été élaborées pour résister à la concurrence : maîtrise des coûts ; diversification de l’offre en faveur de produits de qualité et de textiles spécialisés ; amélioration de la productivité. Des objectifs qui devraient améliorer le positionnement du secteur sur le marché mondial, attirer de nouveaux acteurs en amont, faire émerger des locomotives nationales et renforcer la collaboration des exportateurs avec les acteurs de la distribution internationale.
A la lumière de ces deux exemples, on peut considérer que les chaînes de valeur mondiales peuvent permettre au Maroc d’instaurer les activités nouvelles et plus productives qui sont nécessaires à la transformation structurelle de son économie. Les stratégies sectorielles ne peuvent avoir comme objectif la création de filières qui couvrent tous les stades de la production, elles doivent s’efforcer de trouver la meilleure position pour le secteur concerné au sein d’une chaîne de valeur mondiale. L’externalisation et la délocalisation offrent à l’économie marocaine l’opportunité de gagner en efficience si elle renforce son attractivité. Le choix de l’insertion dans les chaînes de valeur mondiales remet en question l’approche classique en matière de compétitivité. Aujourd’hui, les exportations dépendent de plus en plus de la technologie, du travail et du capital incorporés dans les biens intermédiaires importés. La stratégie de positionnement efficace dans les réseaux mondiaux de production et d’innovation afin de renforcer la croissance et l’emploi consiste à investir dans les compétences, à mettre en place une infrastructure de qualité, à promouvoir l’établissement de liens étroits entre le monde des affaires et le monde de la recherche. Tout aussi importante, la qualité des institutions et des administrations peut peser lourd dans la décision d’une entreprise d’investir dans un pays donné. Le potentiel de montée en gamme dépend enfin de la gouvernance de la chaîne. La gouvernance se rapporte aux relations de pouvoir et de coopération entre les acteurs de la chaîne qui déterminent la façon dont les moyens et les ressources matérielles et humaines circulent au sein d’une chaîne.
