Idées
La furie algérienne
Une provocation de trop, des contradictions entre la parole et l’acte des officiels français, un doigt d’honneur aux généreux discours sur le partenariat d’exception entre l’Algérie et la France, de puissants lobbies opèrent pour donner au Maroc le statut d’une puissance régionale au détriment de l’Algérie…
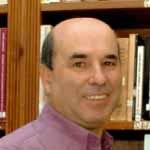
L’accord sur l’implantation du projet Peugeot-Citroën au Maroc a suscité des réactions virulentes, une véritable levée de boucliers médiatique en Algérie. Et pour cause, les autorités de ce pays croyaient que le constructeur français allait d’abord s’installer sur leurs terres. La cible de cette frustration: le Maroc, ce «rival» qui n’en finit pas de glaner des succès au grand dam de ses détracteurs. Hier c’était Renault, aujourd’hui c’est la marque du Lion qui donne ses préférences à l’Atlas plutôt qu’aux Aurès..
Certains milieux algériens n’arrivent pas à expliquer cette «aberration»: le marché algérien est le plus grand du Maghreb par sa surface financière, ses commandes publiques, son volume de population, son pouvoir d’achat. Il fait presque le triple des ventes annuelles marocaines de voitures particulières, les constructeurs français sont ses principaux fournisseurs et pourtant… rien n’y fait. Ils n’hésitent donc pas à accuser les constructeurs automobiles français de «pratiques déloyales». Certains en appellent même à des représailles, ou à l’application d’un principe de réciprocité à l’encontre de la France, si ce n’est de l’Europe entière. Pas d’investissements en Algérie, pas de marchés clament-ils… Dans ce concert de violences déchaînées contre le Maroc, quelques rares voix lucides reconnaissent les qualités qui font le leadership du Maroc en matière d’attractivité économique en comparaison avec l’Algérie. Ils pointent les défaillances internes au système algérien : la panne économique, la léthargie politique. Ils épinglent l’échec retentissant de la politique industrielle. Les ambitions de l’Algérie dans l’automobile remontent au début des années 1980 avec le projet de construction d’une usine de fabrication de véhicules de marque Fiat à Tiaret. Il s’est soldé par un échec. De reports en vrais-faux redémarrages avec de nombreux autres constructeurs (Renault, Peugeot, Wolkswagen, Ford), les projets de l’industrie automobile ont fini par ressembler à un serpent de mer. Avec le temps, l’impuissance est devenue évidente. Alors que le Maroc et la Tunisie, chacun selon ses capacités et ses choix, édifiaient patiemment avec les constructeurs étrangers une industrie d’assemblage ou/et de sous-traitance compétitives, l’Algérie a du mal à se positionner comme terre d’investissement. Elle ne représente pour les firmes occidentales qu’une grande surface commerciale où il est plus rentable d’écouler des produits finis que de les fabriquer sur place.
Une «aire de stationnement à ciel ouvert», pour paraphraser son ministre du commerce, Amara Benyounès. Nous sommes bien loin de cette arrogance du début des années 70. En ces temps révolus, Belaid Abdesslam, ministre algérien de l’industrie, qualifiait le Maroc de pays dont le potentiel économique est réduit à produire des tomates pour l’Europe et au mieux à installer des usines de montage et de boulonnerie destinés à son étroit marché intérieur. L’industrie industrialisante, la lourde, la vraie, celle qui propulse les pays dans la sphère des grandes nations industrielles, c’est l’Algérie qui la construit ; elle en fait la matrice de son modèle de développement intégré, endogène et indépendant. Un modèle tellement perverti dans sa mise en œuvre qu’il a fini par enfanter des éléphants blancs, des complexes sidérurgiques et mécaniques qui fonctionnent à 20 ou 30% de leur capacité, quand ils fonctionnent, bloqués qu’ils sont par une bureaucratie pesante, dans l’insouciance d’une économie de rente, qui ne vit que du et par le pétrole. Avec un prix du baril qui lui offre une réelle aisance financière et l’achat de la paix sociale, le gouvernement algérien fait peu pour attirer l’investissement étranger. Ses réformes, incomplètes et évoluant en dents de scie au gré des prix de l’énergie, ne sont pas vraiment prises au sérieux par la communauté internationale.
Nos voisins algériens entretiennent toujours cette chimère de prétendre produire une voiture de marque nationale, ayant un taux d’intégration à 100% et fabriquée par une entreprise sous un contrôle majoritaire de capitaux publics. Depuis des années l’industrie automobile mondiale est entrée dans une phase de profondes mutations qui a provoqué l’éclatement des schémas classiques. Le modèle d’une marque ne peut plus être construit dans son intégralité dans un seul pays. Dans la réorganisation des procédures de fabrication les constructeurs coopèrent avec des équipementiers dont ils stimulent la localisation. L’implantation de Renault, de Peugeot et des sous-traitants au Maroc est le résultat d’une politique industrielle épousant les mutations de la chaîne de valeurs mondiale, cherchant à optimiser les avantages relatifs, à en modifier le profil par un apprentissage technologique. C’est aussi le résultat d’une négociation où le Maroc n’est pas une simple partie prenante passive. Il fait valoir ses atouts et sa force d’attractivité. La position algérienne est encore moins compréhensible si nous l’approchons par référence au potentiel que peut offrir la région maghrébine. Dans la compétition industrielle mondiale, les pays le plus performants sont surtout ceux qui participent à la construction d’une cohérence productive régionale. Regardez comment les pays du Sud- Est asiatique ont su capter les firmes japonaises dans un espace d’influence qui sécurise sur une longue durée le potentiel de croissance de ces pays et crée une division du travail intra régional qui permet in fine de s’affranchir de l’influence économique du pays leader de la région. Dans ce processus l’enjeu est la gestion coopérative de l’interdépendance pour garantir une autonomie collective. Désormais, l’avantage compétitif se construit par la coopération inter-nations et intra-firmes. Alors continuer à raisonner à l’échelle de ses frontières fermées et ne voir dans les pays voisins que des concurrents est une courte vue. Jusqu’à quand nos voisins resteront-ils prisonniers de leur modèle prussien en déphasage avec l’histoire ? Jusqu’à quand resteront-ils autistes à l’appel d’une approche sereine pour la construction d’un avenir commun ?
