Idées
La force du sexe faible ou la faiblesse du sexe fort
Au Maroc, la santé des femmes est souvent, pour ne pas dire toujours, envisagée à travers des questions intrinsèquement «féminines» au détriment d’une approche plus générale des inégalités de santé et de mortalité des hommes et des femmes.
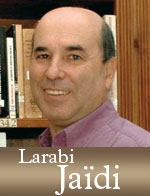
L’écart de longévité entre hommes et femmes au Maroc, comme ailleurs dans le monde, est toujours au bénéfice des femmes. Il est inversé par rapport aux autres inégalités sociales observées entre hommes et femmes. En matière de mortalité, le désavantage est donc nettement du côté des hommes. Dans ces conditions, peut-on parler, dans le domaine de la santé, d’inégalités entre hommes et femmes quand la «force du sexe faible» apparaît clairement face la «faiblesse du sexe fort»(*) ? La question centrale des inégalités genre en matière de santé apparaît sous un autre aspect quand on l’examine sous l’angle de la morbidité, qui révèle que les femmes paraissent en moins bonne santé que les hommes. C’est cette contradiction entre «surmortalité masculine» et sur-morbidité féminine, qu’il s’agit d’éclairer pour mieux renseigner la politique de la santé.
La contribution par âge et par cause de décès aux différences d’espérance de vie entre hommes et femmes est déterminante dans l’explication de cette contradiction. La littérature internationale comparée révèle aussi qu’une proportion non négligeable -près de la moitié- des décès masculins survenus avant l’âge de 25 ans sont des morts violentes, attribuables à des causes externes, contre moins du quart des décès féminins aux âges jeunes. On peut également distinguer une mortalité «évitable» qui correspond aux décès qui auraient pu être évités (théoriquement) par des pratiques de prévention envers les comportements à risque, tels que le tabagisme, l’alcoolisme, les conduites routières dangereuses, les comportements violents… Là aussi, la mortalité «évitable» représentait une proportion plus faible des décès prématurés féminins. Au Maroc, nous ne disposons pas d’enquêtes fines sur l’espérance de vie par tranche d’âges, mais on peut admettre que l’inégalité homme/femme est aussi manifeste au-delà des différences dans les degrés.
Une autre cause, l’exposition aux risques professionnels, est susceptible de participer à l’écart d’espérance de vie entre hommes et femmes. Les hommes exercent plus souvent des métiers physiquement pénibles et risqués dans des mauvaises conditions d’hygiène et de sécurité. Les maladies professionnelles reconnues sont certes en augmentation mais il est difficile de mesurer précisément la part des expositions professionnelles dans les causes de décès. Enfin, même si les métiers et les secteurs d’activité restent fortement ségrégés, exposant les hommes et les femmes à des risques professionnels différents, l’exemple du travail de nuit suggère cependant un rapprochement entre hommes et femmes pour certaines conditions de travail, dont les effets sont nuisibles pour la santé. Par ailleurs, l’avantage féminin devant la mort peut être nuancé par la prise en compte des incapacités liées au grand âge, auxquelles les femmes sont mécaniquement plus soumises que les hommes du fait de leur plus grande longévité. L’espérance de vie ne constitue pas nécessairement en soi un critère suffisant, si l’on tient compte du poids des incapacités et des limitations en fin de vie, qui constituent, pour les femmes, la contrepartie de l’avantage dont elles disposent du point de vue de la longévité. Le même raisonnement peut être appliqué au taux d’hospitalisation des hommes et des femmes, qui est une mesure indirecte de la gravité de leurs maladies et de leurs accidents. Les femmes sont davantage hospitalisées entre 15 et 45 ans, mais cet écart ne s’explique pas que par les maternités – accouchement et complications de la grossesse. Les femmes sont plus exposées aux atteintes de longue durée : les maladies de l’appareil respiratoire et cardiovasculaire, les tumeurs représentent une proportion plus forte des décès féminins. Cette sur-morbidité féminine serait l’expression du désavantage des femmes sur le marché du travail et au sein de la famille ; les femmes auraient aussi une plus grande disposition à prêter attention à leurs corps et à reconnaître leurs symptômes comme morbides, elles auraient tendance à «sur-déclarer» leurs problèmes de santé, ou à l’inverse les hommes auraient tendance à les sous-déclarer.
Au Maroc, les questions de santé-genre semblent encore en retrait, par rapport à celles portant sur les discriminations dans l’emploi, les salaires, le travail domestique, l’entreprenariat ou le code de la famille ou celles sur la participation politique et les libertés publiques. La santé des femmes est donc souvent, pour ne pas dire toujours, envisagée à travers des questions intrinsèquement «féminines» au détriment d’une approche plus générale des inégalités de santé et de mortalité des hommes et des femmes. C’est parce que les problèmes de santé font apparaître des différences ou des paradoxes entre hommes et femmes, par exemple entre surmortalité masculine et sur-morbidité féminine, qu’ils offrent une autre perspective pour étudier la construction sociale du masculin et du féminin dans le domaine de la santé. La longévité féminine s’inscrit aussi dans un rapport genre socialement et historiquement construit.
(*) Le titre de cette chronique est repris d’une étude de l’épidémiologiste Marie-Hélène Bouvier-Colle sur la mortalité féminine en France.
